ATELIERS D'ÉCRITURE - textes
Pour commencer, une brève profession de foi, qui m'avait été demandée pour accompagner des textes d'élèves :
Je suis née au-dessus d'une pâtisserie. Et à peine avais-je une heure que, dans cette chambre où j'étais venue au monde entre les mains d'une sage-femme au judicieux prénom d' Angèle, on se bouscula pour mettre quelques gouttes de champagne sur mes lèvres, afin de me porter bonheur.
Comment aurais-je pu, après une pareille entrée en scène, vivre en coulisses ? J'ai toujours voulu être en lumière, espérant devenir écrivain, comédienne ; voire : archéologue, pour mettre au jour, comme Angèle, des trésors enfouis.
Je suis finalement bibliothécaire. Mais aussi écrivain, parfois comédienne. Et, dans les écoles, les collèges, les lycées, la ferme et les musées où je vais en représentation d'écrivain, j'espère être également archéologue, pour accoucher les enfants des histoires secrètes qu'ils portent en eux.
Donc nous avons souvent écrit sur et à partir de lieux différents. Par exemple, à Sainte Opportune la mare, où nous étions allés visiter le musée de la pomme :
Pérennité*
Sainte Opportune la mare : son église, son café, sa mairie dans l'ancien presbytère, son musée de la pomme : une ligne dans les guides touristiques. Une ligne qui suffit, car les touristes viennent. Et aussi les enfants des écoles parfois. Mais les petits livres bleus, ou verts, qu'on glisse dans les boîtes à gants des voitures, les petits livres ne disent pas tout.
Ils négligent même l'essentiel, concernant mon village, celui dont je suis la patronne. Il n'est pas toujours opportun de se souvenir. Surtout de moi, dont on a laissé détruire la chapelle au sortir du bois.
Ce ne fut pas toujours une chapelle, je vous l'accorde, car dans les temps anciens, d'avant le christianisme, un modeste temple s'élevait là, consacré aux divinités sylvestres, aux nymphes des ruisseaux. C'était religion aimable, certes, mais les prêtres y mirent bon ordre. L'Homme devait se séparer de la Nature, et mériter ce Ciel où régnait Dieu, ce grand barbu qui riait rarement. On déconsacra, reconsacra l'édifice païen, y apportant des reliques. En l'occurrence l'os de mon petit orteil droit, et une mèche de mes cheveux. J'avais mené une sainte vie, terminant martyr à Rome. C'est du moins ce que racontèrent les prêtres. Mon pied et ma chevelure avaient sans doute échappé aux dents du lion, dans le Colisée.
En fait, je n'ai jamais existé, sous cette identité nouvelle. Je suis Opportune aussi bien que Daphné ou Syrinx, les belles nymphes. Et je suis la Fée du Bois également, puisque les fées luttèrent, un moment, contre l'emprise de l'Eglise. Bref, pour résumer : je suis l'esprit du lieu, de tous temps. Un esprit féminin, il va de soi, car la Nature est femelle. Présente depuis toujours, obstinément, et pourtant invisible.
J'étais ce matin sous l'arbre de la place, méditant, quand un car est arrivé, lâchant son chargement d'enfants. Je suis entrée avec eux dans le musée, car je suis la pomme, et la mousse du cidre. Mais la dame du musée me paraît toujours sévère, et je ne tiens jamais jusqu'à la fin de la visite. Je file au bois, attendant le troupeau scolaire entre les pierres tombées de ma chapelle. Si les promeneurs sont aimables, respectueux, je me glisse dans le cheval gris de la prairie, et je fais des grâces, mange l'herbe dans le creux des mains, me laisse caresser. Un peu plus bas, je deviens l'ânon nouveau, couché dans les boutons d'or, puis la grenouille du marais, sautant entre les tiges des iris jaunes. Au retour, je suis la cloche de l'église, sur la pause du déjeuner. Et le coq qui n'a jamais su l'heure puisqu'il s'égosille à la sieste plutôt qu' à l'aurore. Aujourd'hui je suis aussi l'encre des stylos, le silence recueilli de l'exercice. Daphné, Syrinx, Opportune, la Fée du Bois, l 'Inspiration : je suis tout cela, je vous assure. Agacée seulement du bruit des moteurs, des tondeuses, des taille-haie, tous ces tueurs de silence, ces brouilleurs d'Eternité.
Ah, que vienne la nuit, le repos des hommes, la lune blanche sur ma grande mare obscure, j'irai marcher sur les eaux...
(en atelier d'écriture à Sainte-Opportune-la-mare, avec une classe de 5° du lycée Fénelon d'Elbeuf)




A l'heure de paraître*
La grande nuit d'hiver avait comme englouti l'abbaye en cette année 1345.
La neige, tombée en abondance, éteignait tous les bruits. Même le cri de la chouette, si habituel. Le silence serait absolu jusqu'à la première messe, vers trois heures. Les moines dormaient dans leurs cellules, enfin solitaires après leur journée de vie commune. Ils dormaient d'un sommeil d'ange, ou voyaient leurs songes traversés de cauchemars s'ils craignaient le Diable. Mais ils dormaient tous, sauf un : frère Louis, qui attendait sa rencontre avec Dieu.
Le moment ne tarderait, il le sentait. Il était si vieux, tous ses os craquant comme les ailes de son cher moulin, là-bas, dans la plaine. Il mourait sans crainte, sans regrets, heureux d'avoir eu une belle et longue vie, dont il se promettait d'égayer saint Pierre dans un moment, quand le divin concierge lui ouvrirait les célestes portes.
« Je suis né un matin de mai, lui dirait-il, il y a bien longtemps ; dans la paille de l'étable où ma mère était occupée à traire les vaches. Né dans une étable, saint Pierre, n'est-ce pas, déjà, être proche de Dieu, qui fit paraître son fils entre le bœuf et l'âne, sous l'étoile ?
Moi aussi, je fus sous l'étoile, car le toit de mes parents manquait de chaume, par endroits. Nous étions très pauvres, et beaucoup de mes frères et sœurs moururent en bas-âge. Mais le doigt de Dieu était sur moi, et un jour que je jouais à la lutte avec le fils du seigneur, un moine de Jumièges me remarqua : voici un gaillard qui ferait un bon frino pour notre moulin tout neuf.
C'est ainsi que j'entrai au service du meunier, à Hauville. Au moulin de pierre, le plus beau, le plus solide.
J'ai tout de suite aimé ce travail. J'avais le dos solide, le muscle saillant. Les filles n'ont pas manqué autour de moi, saint Pierre, je dois bien l'avouer. Mais d'aucune je ne pris le bonnet, car ces créatures ne sont aimables que promises. Le mariage, souvent, les transforme en mégère. Ou les maternités les épuisent. J'avais vu passer la beauté de ma mère et je fus assez prudent pour n'épouser que le moulin.
Ah, les fêtes qu'on fit là-bas, après moissons, quand le temps avait été clément, la récolte abondante... Mon patron était un brin voleur, mais c'était l'usage, saint Pierre, et si j'ai parfois été complice c'est que je n'étais pas encore occupé de Dieu. La révélation me vint plus tard, un après-midi que, pour un court moment inactif, je traquais le lapin dans la plaine. Le lapin réservé au seigneur, je ne l'ignorais pas. Mais qui n'a jamais braconné, saint Pierre ?
Le vent soufflait en tempête ; et il me sembla alors, couché dans mon fossé, regardant mon moulin sous le ciel de plomb, il me sembla que Dieu me parlait, dans la grosse voix du vent.
De ce jour, je ne détournais plus une mesure de farine ni ne dépeçais un lapin. Et j'allais entendre, le plus souvent que je pus, la messe à cette abbaye de Jumièges où je m'approche de Vous aujourd'hui.
Mon patron se fit vieux, mourut. Les moines se réunirent et m'élirent pour le nouveau meunier. Je les servis bien, cinquante années. et ils me firent la grâce, ce demi-siècle passé, de m'accueillir parmi eux, malgré ma pauvreté. Je ne sus jamais chanter la messe, ni écrire sur leurs beaux parchemins, mais je leur fus utile quand une charrette cassait, quand une serrure fermait mal. Mes mains ont bien servi Dieu, après que mon dos se soit brisé au moulin. »
Disant cela, le frère Louis tendit ses mains vers le plafond de sa cellule, comme si Dieu, ou le céleste concierge, était là-haut à l'écouter. Une cloche sonna. Le gros de la nuit était passé. L'abbaye sembla s'ébrouer, comme une bête secouant sa pelisse de neige. Les premiers chants s'élevèrent dans la chapelle de la Vierge. Frère Louis mourut les mains ouvertes, le sourire aux lèvres. Et c'est ainsi qu'on le trouva, entré dans la lumière.

Et moi, qui, à trois heures, par une nuit d'hiver et de neige, recopie ce texte, je pense à cet ami trappiste - auquel fut dédié ce texte - et qui est, depuis, lui aussi (du moins je l'espère) entré dans la lumière. Il n'avait vécu ni au moulin de Hauville ni à l'abbaye de Jumièges, depuis longtemps ruinée, mais à Notre-Dame-des-Dombes, où il était entré dans sa vingtième année, et qu'il n'avait quittée que pour une abbaye alsacienne, 50 ans plus tard, quand Notre-Dame-des-Dombes, qui ne comptait plus que 9 moines, dut céder la place à une autre communauté religieuse. Je l'avais connu l'été de mes 16 ans, dans le château maison de retraite que dirigeait ma marraine, où il venait dire la messe. Nous nous étions peu revus, mais une régulière correspondance s'était établie entre nous, qui dura jusqu'à sa mort, en 2003.
Dans ce moulin de Hauville, une main anonyme a sculpté un graffiti représentant un moulin de bois. La main a disparu, et le moulin de bois, probablement dessiné d'après nature, par la petite fenêtre voisinant le graffiti. Les ressusciter par l'écriture, peut-être ?
Marinette
Elle est belle, Marinette, la fille du meunier. Mais elle n'est pas pour moi. Le père s'est enrichi, il pourra la doter. Elle épousera le forgeron, qui est propriétaire, ou peut-être même le fils du tabelion. Je partirai avant de voir cette noce, qui me ferait craquer le coeur, comme craque le toit du moulin quand nous le tournons au vent. Le moulin de pierre, qui appartient aux moines de l'abbaye, et où je suis devenu frino il y a trois ans.
Le père de Marinette, c'est au moulin de bois qu'il sévit : celui que j'aperçois par cette fenêtre quand j'ai le temps d'y jeter un oeil. Les ailes qui tournent semblent me narguer : passe, passe le temps, la fille va s'envoler. Et je resterai meurtri à jamais.
Non pas. Je ne demeurerai pas pour voir Marinette au bras d'un autre, Marinette portant les enfants d'un autre, Marinette abîmée, vieillie. Je partirai sur la mer. Je saurai monter les voiles, j'ai déjà un peu appris ici, quand je déploie les toiles. Les toiles qui claquent dans l'azur, giflant ma douleur. Et le petit battement du bois dans la trémie, c'est encore mon coeur qui cogne. Mon coeur est devenu le moulin. Ou le moulin est vivant. Je me demande parfois : est-ce possible? Est-ce que le Diable se mêle de mon histoire? Ou est-ce que je deviens fou à cause de Marinette?
La première fois que je la vis, j'étais sur l'âne, emportant des sacs de froment au seigneur. Elle se rendait au village aussi, mais à travers champs et prairies. Elle passait le ruisseau à gué, relevant un peu sa jupe, tenant ses soques entre ses mains. J'ai vu ses jolis pieds, ses chevilles, toute sa grâce de biche. Je fus comme foudroyé. L'apparition de la Vierge ne m'aurait pas plus troublé... Pardon Marie, j'irai à confesse.
Pour aujourd'hui, tandis que je suis seul près de ma fenêtre, tenant mon petit couteau, je dessine le moulin de mon coeur dans la pierre. C'est comme si j'écrivais mon amour pour Marinette. Mais je n'ai pas appris à écrire. Et quand bien même? Je ne pourrais avouer une passion qui m'est interdite. Quand j'aurai terminé mon oeuvre, je partirai. Et le dessin du moulin de bois restera ici, gravé pour toujours. Mon amour sera éternel.
Au musée de la marine de Seine, à Caudebec-en-Caux, ce fut le fantôme d'une femme, que j'installais dans une chaise-cabine ancienne, qui me fit remonter le temps :
Femme au jardin*
Les hommes sont partis. Quelle paix soudaine autour de la table vide. Je n'entends que le trottinement léger d'Amélie remettant de l'ordre. Je quitte la salle fraîche, où flotte encore l'odeur des plats, et, prenant mon ombrelle, j'ouvre la porte sur la canicule du jardin. Quel beau temps pour les régates. Parfois, en mai, il fait encore froid. Mais, cette année, le printemps ressemble à l'été, l'air est enivrant de lilas, et les pivoines sont gonflées de pétales comme une crinoline couvrant trois ou quatre jupons. Alfred m'a demandé, comme chaque fois : tu ne m'accompagnes pas, ma chérie ? Et comme d'habitude j'ai refusé, préférant ma rêverie molle dans la chaise-cabine, sous la pergola de glycine.
Quand je suis assise dans cette coquille de rotin protégeant mon teint pâle de blonde je me sens, totalement, en sécurité. Le monde extérieur, ses soucis, ses chagrins ne m'atteignent plus. Je ne suis qu'un réceptacle de sensations. Le paysage me pénètre, avec ses couleurs tremblées, ses parfums, ses bruissements d'ailes, ses bourdonnements d'insectes, et, au loin, la rumeur du quai, la rumeur des hommes. Parfaitement immobile, peu à peu, je deviens arbre, fleur, hirondelle rayant le bleu du ciel, fourmi sous l'écorce. Et quand je suis fondue dans cette matrice de la nature, j'en deviens aussi la mémoire. Sous mes paupières closes, je suis le grand fleuve des origines, si large, si sauvage, coulant ses boucles indolentes jusqu'à l'estuaire. Je suis l'eau, la terre. Et la première femme de la première tribu dans les cavernes de la falaise crayeuse. Je suis le feu qui protège des fauves. Et je suis aussi celle qui sort de la caverne, qui habite la première hutte du marais. Et celle, encore, qui verra la première voile viking. Dans ma chaise-cabine, alors, je frémis quelques siècles, livrée aux turbulences des hommes, de leur esprit de conquête, leurs guerres. Alors je fuis, alors je régresse, retournant à l'eau de ma genèse. J'y deviens Seine à nouveau, et île sur la Seine. L'île de Belcignac, disparue un jour, comme l'Ys des légendes. Et je suis encore, au fond du fleuve, tous les bateaux coulés, ceux des conquérants, des pêcheurs, et le Télémaque chargé des bijoux royaux. Je suis le plongeur fouillant la vase. Et je suis la sirène, le poisson, le ragondin creusant les berges sous les saules. Et je deviens la pierre du quai, le chemin de halage, le cheval tirant la gribane et passant devant la grille de mon jardin. Je me sens cette grille de métal froid. Le soleil doit achever sa courbe car je frissonne. J'ouvre les yeux.
C'est l'heure tendre du crépuscule. L'heure des hommes qui vont rentrer, apportant ici leur triomphe, leur joie bruyante, leurs peaux recuites, leur soif et leur faim. Je me lève, quitte ma chaise-cabine, rentre dans ma vie de femme, d'épouse, de maîtresse de maison. Cet après- midi des régates, j'ai traversé des millénaires.
Ecrire à partir d'un lieu peut donc être élire un objet pour support de rêverie. Mais dans un musée exclusivement consacré au peigne (Ezy-sur-Eure), lequel choisir ? Je les choisis tous, et même le peigne encore ...invisible : celui fabriqué en Asie, pas encore en vitrine, mais dans la voiture du conservateur qui venait de l'acquérir dans une salle des ventes.
Marine*
Ecrire à partir d'un lieu peut donc être élire un objet pour support de rêverie. Mais dans un musée exclusivement consacré au peigne (Ezy-sur-Eure), lequel choisir ? Je les choisis tous, et même le peigne encore ...invisible : celui fabriqué en Asie, pas encore en vitrine, mais dans la voiture du conservateur qui venait de l'acquérir dans une salle des ventes.La nuit est très belle, très calme. Pas même noire, mais bleue, à cause de la lune pleine et des étoiles si nombreuses, si brillantes sous cette latitude, à ce moment de l'année. Je suis de quart sur le pont, aussi tranquille que le flot. Il ne se passera rien, cette veille. Je peux, dans cette solitude, rêver d'Ismérie, ma fiancée. Trois ans que je suis parti sur ce grand voilier, certain qu'elle m'attendrait. J'ai encore devant mes yeux, en permanence, la dernière image qu'elle m'a laissée. Elle était debout, figée comme une statue, raidie contre le chagrin de la séparation. Elle avait promis : je ne pleurerai pas ; je sais que ru reviendras. Le bateau s'éloignait du quai, elle allait devenir, entre toutes ces femmes, ces enfants de marins, un point minuscule, que je ne distinguerai plus.
Alors elle a eu ce geste admirable : elle a ôté son petit bonnet, l'a gardé dans sa main droite, et, de la gauche, elle a détaché les épingles de son chignon, tous ses cheveux se sont épandus dans le vent. C'était comme une voile de bateau, une voile répondant à celle que j'avais dépliée avec mes compagnons. Grâce à ce geste j'ai pu savoir plus longtemps quel point elle était sur le quai. Et je devinais comme sa mère, près d'elle, devait crier au scandale, à l'indécence. Une jeune fille en cheveux, exposée aux regards de tous, comment était-ce possible ? Seules les prostituées, dans le quartier chaud du port, se comportaient ainsi.
Trois ans ont passé. Et je reviens vers Ismérie, ma promise, avec, dans mon coffre de marin, toute une collection de peignes. Peignes de nacre, d'ébène, d'écaille. Peignes d'Asie, d'Afrique, et de toutes les îles où j'ai accosté. Mes camarades se moquaient toujours de moi quand nous descendions à terre. Eux, ils cherchaient des femmes à caresser, des bouteilles à boire. Moi, je voulais des peignes. J'en ignore le nombre. Ismérie comptera. Et au jour de nos noces, pour tenir son voile, elle choisira le plus beau.
L'aube approche, et les oiseaux de la terre sont venus tournoyer autour du mât alors que la lune et les étoiles s'éteignaient, que la lumière du jour escaladait le ciel. Ce ciel à présent presque blanc. Ciel blanc comme le voile d'Ismérie, mer bleue comme ses yeux. Ma fiancée est épandue autour de moi, comme ses cheveux sur le quai, le jour où je l'ai quittée. Ma fiancée est mon voyage, mes mers lointaines, ma terre entière.

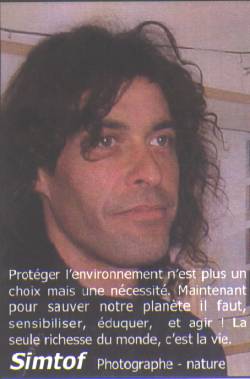
En 2004 Simtof a entrepris une grande campagne de nettoyage du littoral cauchois, après 6 mois et plusieurs dizaines de m3 de déchets ramassés au gré des marées, il a posé son sac aux Grandes Dalles (76540) pour y créer l'espace Simohé où vous trouverez toute l'année des expositions, un point-infos environnement et la possibilité de faire des Eco-randonnées.
Des tableaux peuvent aussi évoquer les voyages, l'attente, les retrouvailles, comme celui, daté 1910, de Paul Lombard, au musée des Beaux-Arts du Havre :
Retour
Le bateau est rentré. c'est comme le refrain d'une chanson, qui met sa musique insistante dans ma tête. le bateau est rentré, revenu de Chine et du Japon, royaume du Grand Mogol, île de Cipangu chers à Marco Polo. Et nous sommes encore, nous les femmes de l'attente, à rêver, comme au siècle du Vénitien rapportant des merveilles. La mer bleue, infinie, qui éblouit les yeux à l'heure terrible de midi, l'heure sans ombre, la mer bleue est la même, où nous avons guetté la voile, point imperceptible dont nous nous demandions s'il était un mirage. Je suis la première à l'avoir vu. Mais je n'osais crier : « Le voilà! » tant je craignais de me tromper. On ne voit jamais que ce qu'on espère. C'est Amalia qui a hurlé, son doigt soudain tendu vers l'horizon : « Là-bas! » J'ai frissonné, incrédule, des larmes plein les yeux. Le point minuscule a grossi, est devenu le bateau. Ce bateau que nous attendions : Libertad. Mes trois amies se sont précipitées à leurs vestiaires, leurs miroirs. Et elles ont couru au port, hier soir, alors qu'il accostait. La fête a duré une partie de la nuit. J'en ai entendu la musique, aperçu les feux de Bengale, depuis ce balcon où je suis de nouveau accoudée ce midi. Le bateau est rentré. Mes trois amies sont assises derrière moi, dans le faste de leurs chapeaux, leurs ombrelles, robes à brandebourgs. Et elles déploient, comme des étendards d'amour, les soies merveilleuses portées par les marins. Leurs bavardages, leurs petits cris, leurs rires me parviennent, mais comme à travers une brume. La brume de l'attente, entre la nuit froide du départ et la canicule du retour. Je suis avec elles. Et je suis ailleurs. Le bateau est rentré. Je me suis fermée aux amies. Mais, doucement, à l'intérieur, mon âme se déplie, se défroisse, comme la pivoine ouvrant sa coque verte sur les pétales écarlates, ou le Paon du jour crevant son cocon. Le bateau est rentré. Mon amour est à quai. Mon amour est dans la Grand Rue, qui mène à la maison. Mon amour est dans l'escalier. Pliez, pliez, mes amies, vos soies et vos ombrelles. Rentrez chez vous. Et qu'avec lui je m'enferme, le reste du jour, derrière les volets clos.
D'après un tableau de Paul Lombard (1910)
Musée du Havre
Des tableaux peuvent être aussi des portraits, d'une jeune fille, au château de Beaumesnil (lieu qu'on retrouvera dans le texte collectif de la rubrique Mellicie hallucine), ou de la belle Anne-Marie de Bosmelet, peinte par François de Troy en 1714 (musée des Beaux-Arts de Rouen, où on peut aussi admirer ce Repas de noces à Yport sur lequel j'ai tant écrit)
Le portrait*
Ah, la la, quelle barbe, cette journée ! Toutes mes copines sont contentes parce que nous serons absentes du collège, mais moi je ne verrai pas Jonathan, qui est en seconde C. Nous, les troisièmes A, nous allons au château de Beaumesnil, pour visiter puis écrire. Je ne sais même pas où c'est Beaumesnil. Tellement loin : l'autre département... Dans l'autocar, ça rigole, ça flirte, ça mange des Mars. Sauf la prof et l'écrivain, qui font assaut de culture, La Varende et Maupassant, j'entends les noms. J'entends tout. Même chaque tour de roue m'éloignant de Jonathan. Quand est-ce qu'on arrive ? Quand est-ce qu'on repart ? Si on revient avant 17heures, j'aurai le temps d'embrasser Jonathan sous l'abribus. Pour le moment, il n'est que 10 heures, le car s'est garé sur le parking, où il n'y a aucun autre véhicule puisque le château n'ouvre que pour nous. Bonjour madame, 27 élèves, c'est bien ça, allez, allez, abrégeons les civilités, on se pèle dans ce parc empli de brouillard. Ce parc majestueux, d'accord, mais quel vent ! Et la famille machin hérita le château de la famille Truc, je fais semblant de prendre des notes. J'écris à Jonathan. Mon chéri j'ai froid, je voudrais être dans tes bras, je te quitte une minute pour surveiller mes pieds, le pont-levis est à clair-voie, j'ai la frousse, je vois l'eau sombre. Quel idée d'habiter là. Ah, non : on n'habite pas, dit madame la guide. Mon chéri, ce serait trop grand pour nous. Escalier plein d'ombres, sous-sol obscur, avec la bouche terrible du puits, au fond duquel on entend battre l'eau des douves ; étage noble, la bibliothèque, livres blasonnés, parchemins, demain c'est sûr j'aurai une bronchite, j'avais mis un décolleté pour Jonathan. Visite des pièces Louis XVI, plus intimes, et on termine sur le siècle, par un tableau de, comment-avez-vous dit ? Jacques Emile Blanche. Connais pas. Y'en a plein le musée de Rouen, et il a fait le portrait de Marcel Proust ? Ah, oui, ce nom-là me dit quelque chose, ce type qui avait de l'asthme. Comme Jonathan à la saison des pollens. Et maintenant, on écrit. Une histoire à partir de ce château, a dit l'écrivain. J'ai pas l'ombre de l'ombre d'une idée. Les fayots de la classe jaspinent autour du prof, posent de nouvelles questions au guide. Je m'éloigne. Puisqu'on a le droit d'écrire où on veut, je retourne devant le tableau. C'est le portrait d'une adolescente, en robe blanche, dans un fauteuil d'osier. Elle est de dos. Et elle se regarde dans un miroir, qui nous renvoie son image mélancolique. Elle me fait pitié, la malheureuse. Comme elle doit s'ennuyer, seule en face d'elle-même. Pas de parents, pas de Jonathan. Je vais écrire son histoire. Il était une fois. Toutes les histoires commencent par il était une fois. Et après ? Je soupire. Il y a un écho dans la pièce. Manquait plus que ça ? Il était une fois une jeune fille nommée Ismérie. Ismé...quoi ? et d'abord : qui a parlé ? Qui me fait cette sale blague ? sûrement Vanessa. Elle est jalouse, parce qu'elle aurait voulu sortir avec Jonathan. Vanessa, je sais que c'est toi. Il était une fois une jeune fille nommée Ismérie. Ismérie du tableau, regarde-moi. Ce n'est pas Vanessa. Je lève la tête. La jeune fille du portrait ne s'admire plus dans le miroir. Ses yeux sont tournés vers moi. Elle me sourit. C'est elle qui a parlé. As-tu peur, demande-t-elle en me tendant la main. Euh... pas vraiment. Ce sera une histoire à raconter à Jonathan. Je monte sur une chaise, puis sur la commode. J'entre dans le tableau. Quelle surprise : Ismérie n'est pas seule. Toute une famille est avec elle, dans le jardin hors cadre. Ils jouent au croquet. On m'invite. Je me sens un peu ridicule dans mon jean's. Les dames ont des ombrelles, des chapeaux, tout le blanc de leurs robes m'éblouit. J'avance. Je marque un point. Deux. Dix. J'ai gagné ! Mais quelle heure est-il ? J'ai entendu le klaxon du car. On m'attend. La visite, l'exercice d'écriture sont terminés, Ismérie, Ismérie, explique-moi comment repasser dans l'autre monde. Ismérie, Ismé... Où es-tu ? Où sont-ils tous ? il n'y a plus que moi ici, assise dans un fauteuil de jardin, me regardant dans une glace, à l'intérieur d'un cadre, au-dessus d'une commode, dans un château fermé.

On aura deviné que le thème de l'atelier pendant lequel j'ai écrit ce Portrait était « le récit fantastique ». J'avais pour la première fois baptisé mon personnage du prénom d'Ismérie, que je réutilisais, deux ans plus tard, pour ma Femme au jardin. Et je découvre, les recopiant ce même jour pour mon site, que j'ai installée l'aînée telle que j'avais pu admirer la plus jeune à l'intérieur du tableau : dans un siège de jardin ! Quelle réminiscence a secrètement travaillé en moi ? Cette chaise-longue abandonnée dans mon grenier natal, et qui avait appartenu à la mère de ma mère, que je n'ai pas connue puisqu'elle était morte avant ma naissance ? Quant à ce prénom d'Ismérie il est celui de l'arrière-arrière-grand-mère de mon père, qui m'intéressa assez, lorsque je fis des recherches généalogiques, pour mettre de la chair sur les quelques éléments délivrés par l'état-civil. On trouvera ce texte dans la rubrique généalogie.
Les pêches
Quel beau matin d'été ! Où je serais si bien dans mon jardin, à jouir de la tiédeur de l'air sous mon ombrelle, dans le parfum des fleurs, des fruits, le vol étourdi des abeilles bruissantes, et les piaillements des hirondelles, les sifflets des merles.
Au lieu de cal je dois me tenir debout, raide, enclose en mon château, afin de poser pour un portrait qu'on destine à un prince qui m'est inconnu mais dont on assure qu'il m'épousera. C'est le destin des filles nobles que de convoler et produire des héritiers. Mais qu'ai-je à faire d'épouser, de perdre ma beauté dans les maternités ? Qu'ai-je à faire de quitter ce château campagnard qui m'est si cher ? J'ai retardé le plus que je pouvais ces longues séances de pose, en prétendant des maux divers. Mais mon père s'est tant énervé que j'ai dû finalement consentir.
J'ai cependant obtenu de choisir mon vêtement. Car on aurait voulu que je sois corsetée, couverte de ma grande robe d'apparat, si lourde, si chargée ne rubans et dentelles, et d'une couleur qui sied peu à mon teint. J'ai imposé de paraître en déshabillé du matin. Indécente femelle, a crié mon père, frappant le sol de sa canne. J'ai rougi sous l'affront, mais paré à la réplique : puisqu'on destine le portrait à un possible fiancé, quel mal y aurait-il à montrer le rond de mes bras, le début de ma gorge ? Ne suis-je pas une marchandise qu'on expose ? Mon père n'a pas répondu, a disparu en claquant la porte.
J'ai été tranquille pour organiser le décor autour de moi. J'ai fait venir mon jeune page, qui souffre à ma place sous une tenue qui n'est pas de saison mais affirme notre fortune grâce au velours, à la fourrure, à l'aigrette de son bonnet. Et le charmant enfant me tend une coupe de nos meilleurs pêches. Ainsi, ne pouvant entrer, ce matin, dans mon jardin, j'ai fait entrer, pour l'éternité, mon jardin dans le tableau. Puissent mes descendants, s'il en existe jamais, demeurer fidèles à mes goûts.

Cette duchesse aimant les fruits a un descendant, qui prend soin du château familial de Bosmelet et de ses admirables jardins (que je vous conseille vivement de visiter). Il accepta mon invitation à la lecture in situ des textes de l'atelier d'élèves s'étant livrées à des travaux croisés, alliant l'écriture et la couture. Philippe Davenet, l'ami pianiste était également présent, et Dominique Cordier, l'amie photographe, qui nous tira le portrait, après que les élèves de l'atelier aient été questionnées par un journaliste.






Mais on peut aussi, toujours dans un musée (celui des arts et de l'enfance à Fécamp) être arrêtée par une statue à peine arrivée, et qui n'a pas d'identité :
L'Inconnue du musée
Quel endroit étrange ! Dix jours que je suis ici et je n'ai pas encore été présentée aux maîtres de maison... Vaste demeure si j'en juge par les allées et venues dans les différents étages. Moi, je suis dans la seconde pièce, avant les escaliers. Belle cheminée condamnée, un banc pour les toit petits enfants (qui ne doivent pas s'y asseoir s'il en vient), des vitrines avec divers objets comme un rébus, un tableau colossal où des hommes en toge jurent sur le corps d'une jeune et jolie morte. Derrière moi, coulé dans la même matière, un type debout, nommé le semeur. L'impolitesse incarnée avec son chapeau vissé sur le crâne. Personne n'a dû lui apprendre qu'on se découvrait devant une dame. Le code des usages se perd. Si je n'étais conçue assise, il me laisserait debout, c'est à parier. Ou alors il trouve que je suis moi-même assez découverte. Soixante-treize ans que je suis nue, dans la splendeur de mademoiselle Ninon, le modèle de Maurice Fessard, le sculpteur. Avec un nom pareil, il était prédestiné à sculpter des nus.
Mademoiselle Ninon avait vingt ans, de petits seins, une coupe à la garçonne, c'était de mode. Posa alanguie de divinité sylvestre, ça ne manque pas de confort. Et contre moi, pour renforcer l'idée de forêt probablement, une biche. Je me souviens des séances de pose dans l'atelier ensoleillé, quand, peu à peu, sculpture d'argile d'abord, moule de plâtre pour terminer, je suis devenue mademoiselle Ninon. Nous étions fort ressemblantes. Comme des jumelles. Au début. Parce qu'ensuite mademoiselle Ninon a vieilli, flétri. Elle aurait quatre-vingt treize ans si elle vivait encore. Mais elle est morte depuis longtemps. Et Fessard également. Plus personne ne me connaît. Des visiteurs demandent régulièrement qui je suis, et on leur répond invariablement : je ne sais pas, elle vient d'arriver. J'espère qu'ils finiront par savoir et me rendre mon identité.
J'ai eu une si belle vie, dans l'hôtel particulier où je commençais ma carrière, en haut de l'escalier à double révolution. Je dominais la salle de bal. J'en ai vu passer du monde... Ce fut parfois très agité. Surtout pendant la guerre. Les Allemands avaient chassé mes propriétaires, dont ils occupaient la demeure. Mon succès était moindre. Ces militaires énervés me descendirent finalement à la cave, pour une raison inconnue. J'ai eu froid, interminablement. Un froid mental, certes, car, au contraire de mademoiselle Ninon, je ne sens pas vraiment les saisons.
La paix revenue - mais pas mes propriétaires - on m'a retrouvée. J'ai alors voyagé, dans le salon d'honneur d'un paquebot. L'infini de l'horizon, la houle : tout était nouveau pour moi. Seuls les uniformes me rappelaient les années sombres. Et puis, il en a été du paquebot ce qu'il en fût de l'hôtel particulier : vendu remanié. Je n'ai plus été au goût du jour. J'ai de nouveau mené une vie de cave. Sauf que c'était dans un grenier. Au moins avais-je un peu de lumière par les lucarnes, et la compagnie des araignées. Mais on se lasse d'une compagnie silencieuse...
Le dernier épisode est-il arrivé ? On a fini par s'intéresser à moi, de nouveau. De jeunes chenapans ont décidé de mon exil ici, non sans m'avoir préalablement mutilée. Il me manque une main, et j'ai un trou dans la jambe. Les imbéciles s'étaient raconté un roman, comme quoi les Allemands avaient sûrement caché un trésor de guerre à l'intérieur de mon corps. Ils n'ont rien trouvé et n'ont pas songé à réparer l'outrage fait à ma beauté. Les usages se perdent, j'ai déjà dit. Ils m'ont livré telle quelle, avec mes deux blessures. C'est peut-être à cause d'elles qu'on me néglige dans ce nouveau lieu, alors qu'on ne tarit pas d'éloges sur l'idiot en chapeau, derrière moi. Il aurait son jumeau sur une toile de Van Gogh, dit-on. Et alors, c'est qui, Van Gogh ? Me présentera-t-on enfin quelqu'un ici ?
Dans ce même musée de Fécamp (qui en compte un autre également digne d'intérêt, consacré aux Terre-Neuvas) j'avais, un autre jour, décidé de ressusciter le chien ayant, sur une tuile gallo-romaine, laissé son empreinte (voir Traces amoureuses, dans la rubrique animaux, où on trouvera également un texte d'atelier écrit dans les jardins de St Georges de Boscherville, La journée des bruits, où un chat est le narrateur).
Au musée de la marine de Seine à Caudebec (nous y revoilà !) j'ai aussi prêté vie au mannequin d'une vitrine, aux personnages d'une vieille photo en noir et blanc :
Le mannequin du musée*
Dix-huit heures. Le musée ferme. Ouf. Je vais pouvoir me dérouiller les jambes, relever mon dos douloureux. C'est pas rien d'être immobile toute la journée. Assis d'accord, mais penché sur mon ouvrage, comme si j'étais un centenaire. Bel ouvrage d'ailleurs : je suis censé réparer une barque qui est une ruine.
Je suis dans une vitrine pédagogie, en situation, à l'intérieur d'un bâtiment sombre, où je gèle l'hiver, où je cuis l'été. Quand je cuis, je somnole. Enfin : j'essaie, car c'est la saison touristique. Les étrangers débarquent par cars entiers. C'est divertissant d'entendre toutes ces langues variées. A l'automne, j'ai plutôt des retraités en goguette, qui se moquent de moi parce qu'ils me trouvent plus décati qu'eux. C'est vrai que les papis et les mamies de maintenant, c'est pas les vieux de mon époque.
Mais les visites que je préfère, ce sont les écoles. D'abord, ça me fait du bien de voir de la jeunesses, même si elle n'est pas toujours curieuse. Aujourd'hui, j'étais gâté : rien que des demoiselles. Il a fallu que je devine, parce qu'avec cette génération, on ne peut plus guère se fier aux tenues : toutes en pantalon. Pas toutes pareilles pour autant d'ailleurs : il y avait celles qui avaient froid, qui s'ennuyaient, qui regardaient l'heure, qui écoutaient de la musique et attendaient le moment de manger ou de fumer, qui soupiraient à l'idée d'écrire. Et puis il y avait celles qui s'intéressaient, que divertissait la visite du ventre du bateau, que troublaient les images du mascaret. Et puis il y avait Nadège, le clown de service, qui parlait d'étrangler sa sœur avec un des modèles de nœuds marins.
Moi aussi, je faisais le clown, quand j'étais vivant. Et quand le musée ferme, il me semble que je redeviens assez guilleret. Surtout les nuits de pleine lune. Je sors de la vitrine, et je vais muser dans le jardin, ou au bord de l'eau. La verdure, l'eau, ça attire toujours les amoureux. J'en surprends parfois. Et ils se demandent qui est ce vieux. Ils ne m reconnaissent pas, car ils n'imaginent pas que le mannequin du musée peut prendre les apparences de la vie.
Il est dix-huit heures, le musée ferme. J'ai la nuit devant moi.
Une famille de fantômes*
Il fait froid. Mais beau. C'est parfait pour rêver sur le quai : il n'y aura personne, et je ne prendrai pas si je suis bien couvert. C'est l'heure du flot descendant. J'entends la clapotis léger du fleuve, tel le babillage d'un enfant. Un petit bateau se balance, vide, qui semble un jouet. Toujours la Seine me ramène à mes jeunes années. J'ignore pourquoi, car je ne suis pas né ici. Je suis d'un village de montagne, que n'arrose aucune rivière.
C'est le travail qui m'a fait émigrer ici, à l'usine d'aviation, près de cette belle sculpture taillée dans le roc : Latham 47. L'histoire d'une expédition de sauvetage qui a échoué. Je pense souvent à cet équipage perdu dans le grand Nord, tel Saint Exupéry tombé quelque part en Méditerranée, ou l'orchestre de Glenn Miller, disparu en Manche, à la fin de la guerre. Curieux que je pense de préférence à des avions tombés. Peut-être parce que je n'ai jamais volé, et qu'il n'y a plus d'avions sortant de nos usines. Seulement des pièces sophistiquées, dessinées par ordinateur. Je suis seul le soir dans ma chambre d'hôtel. Alors je me suis inventé une famille. Pas seulement l'équipage du Latham, mais quelques personnages en photo dans le musée derrière moi.
Il y en a une qui me plaît particulièrement. Un homme est sur une péniche, aux écluses de Poses. Il regarde une femme agenouillée sur le qui, au-dessus de sa tête. Elle lui tend un petit paquet, qu'il tient déjà dans la main. Tous les deux sourient, complices. Je n'ai jamais réussi à distinguer ce qu'était ce petit paquet. Mais j'ai décidé que le marinier figurait mon père. Toujours à naviguer par fleuves et canaux. Il n'était pas présent à ma naissance. Ni à mon baptême. Alors, à ces écluses de Poses, la dernière attente avant la maison de Caudebec, l'épouse de l'éclusier, qui est aussi ma marraine, lui tend un paquet de dragées. Les petites amandes, enfermées dans le sucre et le sachet de tulle, c'est la promesse de l'enfant qui attend dans le berceau. L'enfant qui sera aviateur.
Il est treize heures. Je quitte le quai, retourne devant mon écran. Demain je me prêterai une nouvelle famille. Celle d'un tableau, au second étage, qui attend à un passage d'eau, dans la canicule de l'été, au bord d'un champ moissonné.
Et quand nous n'avons aucun objet de musée sous les yeux, nous pouvons toujours nous pencher sur des photos de journaux :

Les statues ne meurent jamais
J'étais pierre parmi les pierres dans une grande falaise au bord du fleuve. Des hommes sont venus me tailler, grossièrement, avant de m'emporter vers Alexandrie. Je n'avais pas idée, alors, de ce qu'était cette ville, ni même de ce qu'était une ville, ces alignements de maisons, de palais, de temples, réunis ou séparés par des rues. Et dans ces bâtiments, sur ces places, les hommes dressaient des obélisques, des statues.
J'eus le bonheur de devenir une statue de pharaon, la plus importante personne du pays, à l'égal d'un dieu. Je vécus dans le palais de Cléopâtre, qui était reine. La seconde reine d'Egypte, car, avant elle, il n'y eut Qu'Hatchepsout à régner sur le Bas et Haut empires. Ma reine à moi était fort belle, quoique son nez fût un peu busqué. Un nez impérieux, impérial. C'était aussi une grande amoureuse, qui avait un faible marqué pour les étrangers. Elle semblait sensible à la musique de leur accent. Ces amours exotiques, hélas, bientôt la perdirent et elle n'ut plus que le recours de se suicider. J'ai vu cette mort, quand le serpent, mis dans la corbeille de figues, et qu'elle agaçait de ses doigts bagués, la piqua. Elle fut comme foudroyée, et devint violette.
Alors l'empire tourna au chaos. Le palais fut incendié, détruit. Et je ne sus plus rien de la ville, ni des hommes, car je fus jetée dans la mer. Là, le temps me parut long, très très long. Lieu obscur, humide, poissons peu bavards. Pas même une sirène, car ces créatures, dont on avait parlé devant moi et auxquelles j'avais cru, ces créatures étaient imaginaires.
Mais les statues ne meurent jamais. Et il arrive parfois qu'elles reprennent du service, je viens d'en avoir la preuve éclatante. Des hommes, vaguement déguisés en grenouilles, sont venus me tirer de l'eau. Ils m'ont remontée à la surface. Le quai était noir de monde. Et j'ai été applaudie comme si j'avais été le pharaon lui-même. Alors, pour remercier mes braves grenouilles et la foule qui me fêtait, j'ai souri.
Et qu'y a-t-il d'autre que des instruments dans le musée de la musique à La Couture Boussey ? Encore des photos:
Vibrations*
J'animais des ateliers d'écriture depuis quelques années, dans des collèges, des écoles, une ferme.
Mais c'était la première fois que j'accompagnais une classe au musée de la musique à la Couture-Boussey. J'étais un peu émue car je savais que mon grand-père avait travaillé dans ce village. Le père de ma mère, que je n'ai pas connu, mais dont je possède une photo, où il pose avec sa femme, un de ses enfants, une sœur, ses beaux-parents. Ils sont jeunes, souriants, semblent heureux. C'était au début du XX° siècle, avant la première guerre mondiale. Je n'ai aucune autre image d'eux. Et ma mère elle-même avait peu de souvenirs car elle était devenue orpheline très tôt.
Elle se rappelait pourtant que son père jouait du violon et de la clarinette, qu'il faisait danser les clients du café-épicerie derrière lequel a été prise la photo. Et il jouait pour ses enfants aussi, dans le jardin, sous la glycine, les soirs d'été.
Les souvenirs de ma mère ressemblaient à une dictée de Colette, ils me paraissaient venir d'un paradis perdu, dont il ne restait rien. Rien que ma mémoire, relayant la sienne
Entrant dans le musée, où de nombreux et parfois très rares instruments dormaient sous le verre des vitrines fermées, je ne vis qu'elles : les photos sur les murs. Des photos de musiciens. Assis en groupes, rangés par taille, comme les jours de noces. Ils tenaient leurs instruments, ou les avaient posés dans l'herbe, devant eux. Ils semblaient heureux, comme la famille de ma mère.
Je fis le tour de toutes ces images, ayant ajusté mes lunettes sur mon nez, pour mieux regarder, découvrir, peut-être, le visage de mon grand-père. La jeune femme qui nous avait ouvert expliquait, montrait, jouait de la clarinette, à l'appui de ses explications. Elle employa beaucoup de termes qui m'étaient inconnus. Et elle évoqua souvent les vibrations.
Le mot finit par devenir obsessionnel pour moi, comme s'il cachait un secret, qu'il recouvrait autre chose qu'une circulation d'air dans une flûte d'amour, un basson, un galoubet, une musette. J'ai toujours aimé les mots ; c'est mon métier. Mais vibration n'était pas nouveau, il m'était connu. Alors pourquoi ?
Je fus distraite de ma réflexion par l'apparition du chien, qui avait si bien chanté derrière la porte quand sa maîtresse jouait de la clarinette, et je cessais d'essayer de comprendre la nature des vibrations.
Quand j'y pensais de nouveau, il était trop tard : je n'étais plus dans le musée. Je ne pouvais plus communiquer avec l'âme de mon grand-père, qui avait pourtant émis vers moi toutes les vibrations dont était capable son fantôme.
Ces photos ne m'appartenaient pas, mais elle me concernaient. Il n'y avait donc qu'un petit pas à franchir, pour écrire à partir d'objets personnels, que je priais les élèves d'apporter quand les ateliers n'avaient pas lieu dans des musées mais dans les établissements scolaires. J'évoquais un jour mon stylo, au lycée Georges Brassens de Neufchâtel-en-Bray :
Cadeau
J'étais là, tranquille, dans la vitrine d'un magasin bien chauffé. Il devait faire froid, dehors : je voyais des nez rouges, des yeux enfouis entre écharpes et bonnets. Mes compagnons de présentoirs se croyaient malins en commentant, se moquant. Moi je me jugeais sans esprit. D'autres stylos m'écrasaient de leur beauté, leurs étiquettes. Moi je suis en or, disaient-ils, moi d'ébène et d'argent damasquiné. Oui, mais moi, contestait le plus arrogant, je suis un Mont Blanc. Tous nous pouffions quand un vulgaire Parker rétorquait : en fais pas une montagne...
Donc, j'étais tranquille ce jour d'hiver, quand il est entré : un barbu, coiffé d'un feutre noir, le genre artiste. Il n'a pas eu une hésitation. C'était moi qu'il voulait. Il m'a pris, m'a caressé, très doucement - plus tard j'ai appris que c'était un pastelliste, ayant l'habitude de caresser son papier et la poudre de ses petits bâtons colorés - Il a demandé un paquet cadeau. Je me suis retrouvé dans l'obscurité d'une boîte, mise dans un papier rouge, lui-même attaché de ficelles frisées. Cette nuit totale a duré peu de jours. Quand j'ai retrouvé la lumière, j'étais devant un visage de femme, rayonnant. Elle disait : merci mon chéri. Le chéri ce n'était pas moi, c'était le barbu. Ils semblaient très contents l'un de l'autre. Je sais à présent que ça s'appelle l'amour.
Je sais même un nombre incroyable de mots, dont, sûrement, mes ex-compagnons n'ont pas idée. Car la femme à laquelle on m'offrit est un écrivain. La vie avec elle n'est pas de tout repos. Mais elle me fait voyager énormément, d'une histoire à l'autre, d'un souvenir à un conte. Avec une encre bleu-des-mers-du-sud. Parfois même j'écris ses lettres d'amour. C'est ce que j'aime le plus. Même si des fois j'en aurais bien la larme à la plume. Et il me plaît aussi beaucoup de l'accompagner dans les écoles, les collèges, les lycées, là où elle fait du prosélytisme - je vous avais prévenu que je connaissais des mots savants - car ces jours-là, dans les écoles, les collèges, les lycées, j'écris en compagnie, ça me rappelle mes copains de la vitrine. Mes copains qui ignorent sûrement le verbe préféré de mon écrivain. Moi je le connais, c'est tintinnabuler. Parce que c'est un verbe plein de clochettes. Un verbe à mettre au cou des chèvres qui courent dans la montagne, ou aux poignets des femmes quand elles dansent. Un verbe espiègle et musical, rouge comme du papier cadeau, jaune comme des ficelles frisées, bleu comme la mer, vert comme les prairies, orange comme le soleil couchant. Un verbe arc-en-ciel.
Au lycée Maupassant de Fleury-sur-Andelle, j'arrivais un jour avec mes vieux ours en peluche, qui, sur le bureau de l'enseignant, présidèrent l'atelier en dialoguant :
Conversation
- Ah la la, mon cher Popov, quelle belle journée !
- Tu peux le dire, mon vieux Michou : enfin sortis de l'obscurité de ce carton en haut du placard.
- Belle ballade en voiture, pour commencer.
- Tu ne trouvais pas qu'elle roulait un peu vite ?
- Oui, et elle râlait qu'elle serait en retard.
- Je l'ai même entendue nous accuser.
- Vraiment ?
- Oui, je t'assure. Elle a dit : j'ai perdu du temps à chercher mes vieilles pièces, la plume d'oie et mes deux ours en peluche.
- J'ai eu peur quand elle a offert les pièces et la plume. J'ai cru qu'elle nous donnerait aussi.
- Ce n'est pas une mère dénaturée !
- Peut-être que nous n'aurions pas été malheureux de partager la vie d'un de ces élèves.
- Un ou ... deux ! Nous aurions alors été séparés !
- Quelle horreur ! Après quarante-sept ans de vie commune.
- Tu étais déjà auprès d'elle depuis dix ans quand le Père-Noël m'a lâché dans la cheminée.
- Oui, t'es un p'tit ravisé.
- T'as vu comme les élèves sont sages ? Comme ils écrivent ainsi qu'elle a demandé ?
- Tu sais bien qu'elle a une baguette magique pour les transformer en écrivains.
- Elle ne l'a pas apportée.
- Les baguettes opèrent à distance
- D'ailleurs, si elle l'avait prise, elle aurait dû avouer qu'elle est une fée.
- Une fée qui revient sur ses traces. N'est-elle pas originaire de la forêt de Lyons ?
- Je crois.
- Et que fait-elle à part transformer les élèves en écrivains ?
- Ne joue pas l'innocent. Tu le sais aussi bien que moi.
- Elle sait communiquer avec les animaux.
- C'est ce qui lui permet de les protéger des chasseurs.
- C'est elle qui a guidé ce marcassin orphelin vers le troupeau de vaches, dans cette prairie au-dessus de Fleury.
- Elle l'a emmenée au C.H.E.N.E. ?
- Non : il est en forêt de Roumare à présent.
- A ton avis, qu'est-ce qu'on fera, après l'atelier d'écriture ?
- Je pense que nous irons manger des crêpes aux Lions de Beauclerc, à Lyons justement.
- Elle est très gourmande.
- Te souviens-tu, à la pâtisserie de ses parents, c'était elle qui mettait les fèves dans les galettes de l'Epiphanie ?
- Parfois elle glissait des bagues à la place !
- Elle avait lu Peau d'Ane.
- Mais jamais un prince n'est venu lui rendre la bague et la demander en mariage.
- Jamais les princes n'épousent les filles de pâtissiers.
- Ils ont ben changé, car il fut un temps où ils aimaient même les bergères.
- Tu en sais des choses !
- Je lis le journal, moi, en son absence, quand nous nous échappons du carton.
- Moi je préfère ses livres d'enfant. Boucle d'or et les trois ours, par exemple.
- T'es un sentimental !
- Chut ! L'exercice est fini. Les élèves vont lire.
- A ton avis : ça ressemblera à ce qu'on trouve dans les journaux, ou ce sera comme dans les vieux albums roses ?
J'avais déjà fait parler un autre ours en peluche, avec les élèves d'une classe solidarité, venue de Goderville à la ferme de l'Archelle, pour lier des textes Maupassant à cette solidarité (ce qui ne fut pas évident ! Voir Trouvaille, dans la rubrique au nom de cet écrivain) :
Vanité
Cette année-là, j'étais le plus bel ours en peluche des Grands Magasins Cauchois. Et j'avais un succès incroyable au moment où les enfants sortaient de l'école. Ils se collaient en grappe, le nez contre la vitrine, et, à cause du froid, en contraste avec leur haleine - car ils avaient la bouche ouverte d'admiration - une buée flottait entre eux et moi, qui renforçait ce mirage que je semblais être à leurs yeux. Je devins très vaniteux ce mois de décembre, je le confesse, et je ne rêvais plus que cheminées de châteaux, que nurseries de manoirs. Je me sentais promis à une longue vie douillette.
Quelle ne fut pas ma surprise d'être acheté par une dame timide, vêtue sans élégance particulière, et à laquelle je n'avais prêté aucune attention lorsqu'elle était entrée dans le magasin. Que voulez-vous ! Je croyais encore au Père-Noël, moi, et j'avais imaginé d'être choisi par le vieux barbu, qui me baladerait en traîneau avant de me déposer dans les souliers de petits enfants de Miromesnil. Vous savez : ce si beau château où est né Guy de Maupassant...
Donc, première surprise : je fus acheté, comme une vulgaire marchandise sans âme. Et il n'y eut pas de cheminée : la cliente habitait en immeuble. H.L.M., dit-on : habitation à loyer modéré. En cette nuit de Noël, je devins donc modeste. J'ai d'ailleurs passé des années heureuses auprès de Benjamin, puis de Stéphanie sa petite sœur. Ils m'ont très bien traité, car, sept ans plus tard, j'avais encore mon nez brodé, mes yeux en agate et mes oreilles si bien ourlées. Même mon nœud papillon était resté en place autour de mon cou. Je croyais que toute ma vie d'ours serait sédentaire. Je dois même avouer que je commençais à m'ennuyer. Comme quoi le bonheur ne fait pas toujours le bonheur.
Et puis soudain, ce fut comme une révolution, cet automne 1998. Benjamin était à présent en classe de 5° au collège de Goderville. Et un soir il rentra très énervé. Il en bafouillait, et j'eus un peu de mal à comprendre. Il était question de Bosnie, de guerre, de solidarité, d'écrivain, de ferme. Un vrai salmigondis. Il fallut trier pour comprendre. C'était une très édifiante histoire, et j'aurais applaudi si je n'avais compris, tardivement, que j'étais concerné au premier chef : Benjamin m'emporta à son collège, malgré les larmes de Stéphanie. Ce fut une jolie fête, car je retrouvais plein de copains connus dans la vitrine sept ans plus tôt.
La suite fut plus mystérieuse : j'ai voyagé longtemps dans un vieux camion. Il y a eu des arrêts, au passage des frontières. J'entendais parler des langues inconnues. Et, la dernière nuit, nous eûmes tous très peur, mes copains et moi, car des sirènes hurlèrent, juste avant un bombardement sur notre route. Enfin nous sommes arrivés. J'appartiens maintenant à une petite fille nommée Volodia. Elle ne parle pas le français, mais nous nous comprenons tout de même très bien car elle m'embrasse et me câline beaucoup. Surtout la nuit, où elle a si peur de devoir dormir dans une cave, car elle n'a plus de maison. J'essaie de lui tenir chaud, de l'apaiser, je sèche ses larmes dans ma fourrure. Je veille sur son sommeil. Je me sens indispensable, et je suis fier que ma vie ait pris une orientation si différente de celle dont j'avais si stupidement rêvée. Je n'ai qu'un seul regret : ne pas avoir appris à écrire, pour donner de mes nouvelles à Benjamin et Stéphanie.
Et je démontrais qu'on pouvait écrire à partir d'objets très usuels, comme un vieux banc (à l'Archelle), une pince à dessin (devant un paysage du Marais Vernier), un arrosoir, une pancarte :
Le banc réformé
C'est fait : ils sont là ! J'avais entendu Maurice et les cuisinières en parler toute la semaine : les enfants arrivent lundi. De Nogent-le-Rotrou, précisait-il. J'ignore où ça se trouve, car moi, le banc, je n'ai voyagé que de Hattenville à la ferme de l'Archelle, environ trois kilomètres. C'est peu en tant d'années, mais cela a suffi à mon bonheur.
J'ai commencé ma carrière à l'école du village, chez les filles, car à l'époque on séparait les enfants selon leur sexe. J'ai vu des petites culottes, des cuisses roses, des jupes empesées. J'étais ordinairement dans la classe, au premier rang, car j'étais le plus beau banc qu'avait fabriqué le menuisier, mais, une fois par an, on me sortait dans la cour, pour la photo de groupe. Les filles les plus petites étaient assises par terre, les suivantes installées sur moi, et le troisième et dernier rang debout sur un autre banc. Les enfants étaient généralement sages le jour de la photo, avec leur maîtresse au centre. Une fois, une écolière trop timide n'a pas osé lever le doigt pour demander : mademoiselle, je peux aller aux cabinets ? Elle m'a fait pipi dessus. C'était ma première tache. Il y en eut bien d'autres : l'encre violette, la confiture des goûters.
Plus tard, quand l'éducation s'est relâchée, on a commencé à m'écrire dessus, au stylo bille, au feutre. J'ai un cœur gravé au compas, avec un prénom à l'intérieur. C'est une jolie blessure. Elle me rappelle les mariages. Car il faut dire qu'un jour j'ai été réformé : le mobilier de l'école a changé, et nous, l'équipe des bancs, nous avons été transportés dans les combles de la mairie. Nous y passions une retraite ennuyée, je l'avoue, jusqu'au jour où Maurice demanda au maire, alors qu'ils jouaient aux dominos dans le café du village : t'aurais pas des vieux bancs à me prêter ?
C'est ainsi que je suis arrivée à la ferme de l'Archelle. La meilleure part de ma vie, je l'avoue. Je continue de voir régulièrement des enfants, et j'ai quotidiennement la compagnie des animaux : basse-cour, moutons, chèvres, etc. Avant-hier, j'ai eu un après-midi très studieux sous le pommier : la classe de Nogent-le-Rotrou travaillait à écrire une histoire d'après le tableau Repas de noces à Yport, dont la reproduction était punaisée sur le tronc de l'arbre. Il y avait quelques turbulents qui se chatouillaient sous la table au moment de la lecture, mais, dans l'ensemble, j'ai pu écouter toutes les histoires, même si les coqs et les moutons, visiblement intéressés, mêlaient leurs voix à celles des lecteurs. Hier, mes chers petits voyageaient au bord de la mer, je ne les ai guère vus. Et aujourd'hui, ils écrivent à l'intérieur de la maison. Je les aperçois d'ici, par la porte-fenêtre. Mais je ne les entends pas lire, c'est dommage. Les chèvres ont dû comprendre mon regret car leur troupe s'est approchée de moi pour me consoler.




Métempsycose*
Dans mes autres vies, je fus un homme, un chien, un ver de terre, descendant chaque fois dans la hiérarchie des espèces, car, toujours, je me rendis coupable de quelques méfaits. Homme, j'ai tué un de mes compagnons, un jour de colère. Je n'ai pas été pris, car j'ai caché le cadavre dans le marais, là où ne s'aventurent guère les autres villageois. On a cru l'homme disparu, et j'ai continué à vivre en paix, seulement troublé, au soir de ma vie, par le remords. J'avais eu le chagrin de la veuve sous mes yeux pendant 40 ans. J'ai prié Dieu, quand j'ai senti la mort approcher, pour implorer son pardon. Mais le Dieu de la Bible ignore l'indulgence, et il m'a puni, faisant migrer mon âme dans un chien.
Un chien de chasse, mauvais, hargneux, cruel. J'étais si enragé de n'être plus un humain ! J'ai fini par tuer mon maître, en l'attaquant à la gorge. La justice n'a pas traîné : on m'a immédiatement abattu. Je fus mort une nouvelle fois. Et je ressuscitai en ver de terre, pour bien comprendre que je devais m'améliorer.
Franchement, je ne voyais pas en quoi un lombric pouvait mener une vie exemplaire. Et bien sûr, j'ai échoué, très rapidement. Je suis mort, d'un coup de bec de cigogne. Toujours dans le marais, car Dieu, qui avait mis tant de fantaisie à me changer d'espèce, était invariable sur la géographie.
Ce n'était pas désagréable, car c'est un lieu que j'aime. Il correspond à ma nature sauvage, primaire. Il est empli d'odeurs et de couleurs : l'aubépine blanche, l'iris si parfaitement jaune, les grandes euphorbes, la fougère, l'écorce du boulot, l'orchidée mauve, les tiges des roseaux, animés par le vent du soir ; et, planant sur ces parfums éphémères, saisonniers, le pourrissement perpétuel de la végétation saturée d'eau.
Donc, ayant été un méchant homme, un mauvais chien, je fus un ver de terre lamentable. Et Dieu s'énerva. Il me priva de vie : mon âme ne demeura plus que dans un objet petit, insignifiant, souvent oublié au fond d'un cartable : j'étais devenu une pince à dessin. Totalement désespérée par ce sort, mon âme s'appliqua enfin à être bonne. Je servis bien la collégienne à laquelle j'appartenais, sans jamais pincer les doigts. Dieu finirait bien par être ému de mes efforts !
Et ce matin, ce matin de Mai qui sent si bon l'aubépine, le miracle a eu lieu.
J'étais tout en haut de mon cher marais, dans cet endroit que les hommes appellent panorama. Et je ne songeais qu'à pincer une feuille sur un rectangle de bois. Une feuille où Aurélie, ma collégienne, devait dessiner le paysage où j'ai vécu toutes mes vies.
Il y eut un moment de silence. L'inspiration planait sur les enfants. J'ai senti alors que je me métamorphosais, que je me détachais de la feuille et du bois.
Aurélie a crié : j'ai perdu ma pince !
Mais je n'étais plus une pince. J'étais un oiseau, un beau rapace volant sur le marais. Je suis à nouveau vivant ! Et libre ! Je vole, je vole, et je crie mon bonheur dans le matin du printemps.

Canicule
Canicule, canicule : les Zhumains n'ont plus que ce mot à la bouche. L'un d'eux même, qui est prof au collège, a expliqué que ce nom venait de canicula, petite chienne en latin, et que la nuit où la constellation du chien était la plus brillante dans le ciel correspondait au jour le plus chaud de l'année, le 27 juillet. Je n'ai pas bien compris ce qu'une chienne, même petite, faisait parmi les étoiles, mais il y a tant de choses que je ne comprends pas. Je ne suis qu'un arrosoir, un de ces objets utiles aux Zhumains. L'un d'eux, un poète, s'interrogea un jour : Objets inanimés, avez-vous donc une âme, qui s'attache à la notre et la force d'aimer ? C'est aussi un prof qui a rapporté la citation.
Je fréquente beaucoup les profs, ce qui n'est pas vraiment logique car je devrais plutôt vivre en compagnie des jardiniers. Mais j'ai eu une promotion au printemps, avant la canicule. J'ai été nommé Source d'Inspiration, pour un atelier d'écriture. Et c'est le prof, celui qui cultive du muguet dans son jardin, qui m'a apporté dans sa classe. Mon métal gris n'a pas rougi de plaisir, mais je me suis effectivement senti une âme ce jour-là.
Forcément, après, quand j'ai retrouvé mon ancienne situation d'objet stationné entre les salades et les fraises, j'ai un peu déprimé. D'autant que la canicule est arrivée, et que le préfet a interdit d'arroser les jardins, les pelouses, les potagers. Même le maïs des champs, ce gourmand d'eau, a été rationné. Les salades et les fraises sont mortes bien sûr, ainsi que les fleurs ; et les pelouses sont à présent jaunes, les arbres perdent déjà leurs feuilles comme à l'automne. J'entends souvent passer des ambulances du côté de la maison de retraite. Mais je n'ai plus vraiment les nouvelles du monde, car mon prof est absent et n'a pas pensé à me laisser la radio ou la télé allumée. J'aimais bien écouter toute cette rumeur humaine, par les fenêtres ouvertes sur les jardins. Mais les fenêtres sont à présent fermées, et les volets aussi. Le prof est parti en vacances. Il a choisi d'aller vers le Nord, loin, très loin, car il veut voir les derniers ours blancs, ceux qui vont disparaître en même temps que leur banquise, à cause du réchauffement planétaire. Canicula, bientôt, ce sera tous les jours de l'année. Et l'eau devenant de plus en plus rare, je n'aurai plus d'usage. Quelle angoisse ! Où donc s'achèvera ma vie ? Chez un ferrailleur qui m'écrasera avec une de ses grosses machines dont il compresse les voitures ? Dans la vitrine étouffante d'un musée, avec une étiquette précisant : Arrosoir, en usage jusqu'aux premières années du XXI° siècle. Je préfèrerais la seconde hypothèse, ça me rappellerait ce moment de gloire pendant l'atelier d'écriture, quand la petite pancarte indiquait seulement ne pas toucher, comme si j'étais précieux, fragile, unique, digne de fréquenter les poètes, fussent-ils... en herbe.
Déviation
J'étais, comme d'habitude, en avance pour mon rendez-vous avec mes collégiens de Fleury-sur-andelle. En avance de trois quarts d'heure. Je réfléchis à l'opportunité de prendre un second petit-déjeuner dans un bar, pour passer le temps. J'y renonçais, autant par souci de mon éternel régime que par crainte d'emporter dans mes vêtements, mes cheveux, l'odeur du tabac, que je n'apprécie pas. Les brumes matinales, si élégamment posées sur le paysage, comme des écharpes de mousseline au cou d'une frileuse, décidèrent pour moi : je continuerais de rouler jusqu'à Lyons-la-forêt, pour admirer la campagne, les prairies, les bois et poster une carte à une amie qui habita ce joli bourg.
Au premier croisement, je rencontrai une pancarte, d'un beau jaune d'or, sur laquelle était écrit : déviation. Je faillis renoncer à la promenade. Mais je suis d'une nature gourmande, et foncièrement têtue. Je suivis la départementale indiquée, dans la côte, derrière un camion poussif. J'arrivais à Lyons, un peu trop tard pour m'y arrêter. Je cherchais une voie plus courte pour le retour. Une nouvelle pancarte (la troisième) indiquait encore : déviation. Je pris cette direction, dont ma boussole interne me confirmait que c'était la bonne. La route déroulait son ruban d'acier, entre les bois, les prairies, avec ces écharpes de brume, j'ai déjà dit. Je souris en remarquant, dans un pré où vagabondait un ruisseau, une vache couchée, qui portait sur la tête et la croupe, deux pies, comme deux traits d'élégance la distinguant du troupeau. Mais, dans l'ensemble, je regardais moins ces beautés dignes de Virgile que mon compteur de vitesse et le cadran horaire. Bientôt, sur les pancartes blanches, je ne lus plus Fleury, mais, obstinément, Lyons, Vascoeuil, d'autres villages. J'accélérais, espérant avoir accompli ces quinze kilomètres me séparant de Lyons, d'où je venais. Je dus me rendre à l'évidence : j'y étais retournée.
Les pancartes jaunes continuèrent à me narguer, l'une d'elles surtout, identifiable à sa position près d'une mare où je crus terminer ma carrière de conductrice. J'ai roulé autour de Vascoeuil sans jamais y parvenir. Près de la mare, à mon troisième passage, je vis une voiture arrêtée, au milieu du carrefour, de stupéfaction probablement. Le chauffeur était penché sur une carte ouverte dépliée sur son volant. Il ne leva pas la tête.
J'ai compris, alors, que je n'étais plus dans le siècle, malgré les apparences, ni dans la géographie ordinaire. Le temps et l'espace avaient bougé. J'étais entrée dans le territoire des anciens contes, ceux où le voyageur égaré ne sort plus jamais de la forêt. Les pancartes jaunes dessinaient le cercle magique de Merlin. Je ne pensais plus à Ravel, ni à Isaac de Benserade, qui avaient habité Lyons, mais aux fantômes de l'abbaye de Mortemer, à la source enchantée de sainte Catherine, et, surtout, à ce très vieil arbre, dit chêne de l'homme mort, et dont aucun guide touristique ne précisait de quelle manière avait fini le malheureux. Je regrettais de ne pas m'être arrêtée auprès de l'autre égaré : nous aurions uni nos forces pour affronter les sortilèges, semer des cailloux blancs, triompher de l'épreuve. Peut-être même nous serions-nous mariés, aurions-nous eu beaucoup d'enfants, tout une classe...
Tout une classe qui m'attendait pour écrire sur le thème des objets. Je me demandais combien d'heures j'allais errer, jusqu'à la panne d'essence. Y avait-il des loups, dont les yeux brilleraient la nuit, autour de ma voiture, à l'égal des pancartes jaunes ? Qui s'inquièterait de moi, me porterait secours ? L'enseignante, si elle était une fée capable de rompre l'enchantement ?
Elle l'est, indubitablement, car, soudains, je fus... devant la grille du collège ! Je me suis garée dans la cour intérieure, et, au moment où je posais le pied dans l'allée, j'ai vu, sur la pelouse, de magnifiques champignons, poussés en cercle. De ces champignons qu'on appelle des ronds de sorcières.
Qu'allait-il encore m'arriver, dans ce collège ?

La réponse à la question ci-dessus vint au cours d'une autre atelier pour lequel j'avais prié élèves et professeur d'apporter des objets personnels. Ils avaient donc tous ces objets devant leur page. Tous sauf un. L'avait-il oublié ? Non. Son père ne l'avait pas autorisé à l'apporter en classe - où d'ailleurs, il ne serait pas entré, car il s'agissait du ... tracteur familial. Je décidais d'utiliser aussi leurs objets dans mon propre texte :
Cartouche
La cartouche résistait. Je ne parvenais pas à l'emboîter dans mon stylo. C'était un mystère : pourquoi, toujours, les objets me résistaient ? le matin je m'étais énervée sur le couvercle du pot de confiture. En vain. Il n'avait jamais tourné sous ma main, livré son délicieux contenu. J'avais mangé mon pain sec. Mon pain ... brûlé, car le grille-pain, pour une raison inconnue, n'avait pas éjecté les tartines. Après, quand je m'étais habillée, la fermeture éclair de ma jupe s'était coincée à mi-hauteur. J'avais dû en mettre une autre. Tout cela avait failli me retarder, alors que j'étais attendue, à Fleury, pour un atelier d'écriture, où j'avais besoin de mon stylo. De ce stylo-ci, avec cette couleur d'encre. Les écrivains sont parfois maniaques. Bien sûr, je pouvais renoncer, demander à un des élèves déjà penchés sur leurs feuilles : peux-tu me prêter un crayon ? Mais je ne voulais pas les déranger. Je devins stupide. Cela arrive aussi aux écrivains. C'est même parfois de l'être un peu qui les aide. J'ordonnais tacitement à la cartouche : allons, cède, emboîte-toi dans le stylo. Mon ordre mental ne fut pas entendu. Mais une vois inconnue, assez étrange, me dit : te fatigue pas, Boucle d'Or, ils ne t'obéiront pas. Je levais la tête. Personne ne parlait. La voix reprit : ne me cherche pas, je suis invisible. Je suis l'ours de Laura. Celui que sa mémoire et son amour ont ramené près d'elle. Tu ne peux pas me voir, et pourtant je suis aussi beau qu'avant ma mort dans la machine à laver. Je porte au cou le médaillon d'Aurélie, et dans mes grosses pattes je tiens l'alliance de la maman d'Anne et le porte-clef en forme de chien d'Emilie. Je demandais, de ma voix intérieure, celle que je suis seule à entendre : comment est-il ce chien ? Le nounours me répondit : demande à Anthony, c'est son chien. Il garde toujours sa photo sur lui. C'était sûrement vrai, car je perçus, derrière la voix de l'ours, un aboiement. Je m'accrochais à cet aboiement, pour revenir à la réalité : probablement un chien, un vrai chien aboyait dans un jardin proche du collège. Je quittais mon siège, le bureau, pour aller regarder par la fenêtre. Il n'y avait aucun chien à l'extérieur. Seulement un corbeau. Je pensais : le corbeau d'Edgar Poe, et, frissonnante, je retournais à ma place, retrouvant ma cartouche récalcitrante, mon stylo ouvert, ma page blanche. Tout le monde continuait d'écrire. Sauf moi, l'écrivain. C'était un comble. Que diraient le professeur et les élèves à la fin de l'heure quand j'avouerai : je suis en panne. En panne d'encre ? C'est alors qu'il y eût un bruit formidable, faisant relever toutes les têtes : un ballon de foot venait de faire exploser la vitre devant laquelle j'étais la minute d'avant. Nous nous précipitâmes pour voir qui, de l'autre côté, était coupable. Il y avait un tracteur, avec un homme qui criait. Mais il était loin, je ne comprenais pas ses paroles. Je continuais seulement d'entendre le nounours de Laura, qui me conseillait : Te bile pas, c'est un mauvais moment à passer. Quand tu refermeras ton stylo, avec ou sans cartouche à l'intérieur, tout redeviendra normal. J'obéis, juste au moment où le professeur annonçait la fin de l'exercice. Je relevais la tête, comme les élèves. Je regardais la vitre. Elle était intacte.
Mais j'écrivis aussi à partir d'un objet assez étonnant, retrouvé dans la Seine :
Mémoires de Seine
La pêche n'est jamais qu'un prétexte, un alibi. Je rentre toujours bredouille. Et même si je rapportais du poisson, ce qui est improbable vu l'état du fleuve, je n'oserais pas le manger, craignant trop la pollution. Mais je suis assis au bord de l'eau, sur le chemin de halage, et, ma ligne à la main, je peux regarder le fleuve, ses chatoiements sous le soleil d'été, je peux contempler les lourds bateaux et les péniches qui remontent ou descendent, entre Le Havre et Rouen. Je demeure immobile, comme uns statue, une stèle, une borne plantée là. Je ne suis plus qu'une paire d'yeux, deux oreilles, deux narines. Les oiseaux ne se méfient plus de moi, ils m'approchent. Et quand la marée remue les fonds, deux fois par jour, l'odeur mêlée de vase et de mer pénètre mon nez, envahit mon cerveau. Je me sens poisson. Comment, dans un tel état, ôterais-je la vie d'une seule de ces créatures ?
Lorsque je rentre, ma femme râle. Non tant parce que je n'assure pas le dîner, mais parce que je rapporte ce qu'elle appelle des saloperies. Je me suis constitué un musé dans notre grenier, avec des bois flottés, des chaussures, des boîtes de conserves, des bouteilles en plastique : tout ce que le fleuve m'apporte, tout ce qu'il a pris à ses rives ou tout ce dont l'Homme s'est débarrassé, comme si la Seine était une poubelle.
Aujourd'hui j'ai trouvé ce qui me semble un trésor. Une boule en zinc, avec des ailettes, paraissant avoir séjourné longtemps dans l'eau. Je ne savais pas ce que c'était, n'en ayant jamais vu. Et j'ai d'abord eu peur, soupçonnant quelque engin de guerre, inconnu. Quand je l'ai décroché de ma ligne, je l'ai manié avec précautions, le cœur battant. Je l'ai posé sur l'herbe, le contemplant longuement. L'ouvrir pouvait me tuer, j'en avais conscience. Mais la curiosité a finalement été la plus forte. C'était si visiblement hors d'usage, et tellement impossible que de la poudre ou quelque produit chimique soit contenu dans du zinc. J'ai pris mon canif et j'ai ouvert la boule, la forçant, au milieu, là où elle avait été fermée en 1870.
Je n'énonce pas cette date au hasard. Elle était inscrite à l'intérieur. Inscrite 700 fois, sur les 700 lettres qu'elle contenait. Tous ces épistoliers sont morts depuis longtemps, mais les lire m'a tiré des larmes car ils appelaient à l'aide, dans Paris assiégé, où ils mangeaient des rats, et, s'ils avaient un peu de chance, la viande de l'éléphant du zoo. Ils demandaient des nouvelles. Ils disaient leur faim, leur peur, le bruit des obus. Ils évoquaient les blessés, les morts. Ils parlaient d'amour, d'espérance. Et moi, leur destinataire unique, qui ne peux rien pour eux, je sais au moins cela. Je serai leur mémoire. Je ferai un livre de leurs lettres. Un livre que j'appellerai Mémoires de Seine.

Et bien sûr, dans les journaux, je ne trouvais pas que des photos, mais aussi de ces faits divers dont j'avais déjà fait mon miel dans les nouvelles (voir à cette rubrique), et dont j'invitais les élèves à s'inspirer, comme cela était arrivé à Maupassant. Et j'ajoutais que même les contes pouvaient s'inspirer de faits divers, écrivant, à l'appui, Disparu (voir dans la rubrique contes)
Tous les textes ci-dessus sont de moi (ceux dont les titres sont suivis d'un astérisque ayant été publiés dans Rouen-Lecture). Mais on trouvera également des textes collectifs dans la rubrique Mellicie hallucine, et dans la rubrique voyages (pour : Les fabuleux secrets du baobab et Le voyage des deux Indiens).
J'aurais beaucoup d'excellents souvenirs à conter, concernant ces ateliers, mais j'en terminerai par un sourire,
concernant quelques difficultés habituelles :
Elle coura, buttit, tombut
Ce pourrait être moi, cette personne précipitée, car je crains toujours d'être en retard à ces ateliers. Et je suis évidemment en avance. Tirée du sommeil par l'impatience, bien avant la sonnerie du réveil. Ayant mon cartable prêt depuis jours. Je dois avoir l'air d'une vieille écolière. Qui aurait perdu la tête, oublié que l'école est finie, comme dans cette chanson de Sheila. Nous avions 16 ans elle et moi, nos parents avaient vendu des bonbons (les siens sur des marchés, les miens dans une boutique, d'où, sûrement son audace plus grande que la mienne), je me coiffais comme elle, qui ne s'appelait plus Annie alors que je continuais à être Simone... A présent nous pourrions être les grands-mères des enfants que je rencontre, les mères de leurs profs. Sauf que là encore, elle s'est distinguée mieux que moi : elle a commis un fils, moi je n'ai eu que des chats.
Donc : je coura. Butis, c'est moins ... courant. Quoiqu' encore... parfois encombrée d'un cadre protégeant la grande affiche d'un Repas de noces à Yport, et du rouleau à pâtisserie de mon père, ça pourrait arriver. Pourquoi ce rouleau à pâtisserie, me direz-vous ? Non, non : ne me soupçonnez pas de songer à assommer la jeunesse qui m'est confiée, ni à rouler le rectorat dans la farine en faisant fabriquer des tartes, des croissants aux élèves, en place de les contraindre à écrire. Le rouleau c'est pour le thème des objets. Les objets de musée, qui les rebutent parfois, tenus à distance par les sarcophages de leurs vitrines. Les objets de mémoire, comme ce rouleau, qui a gardé en creux, la trace des doigts de mon père, mort un matin de juillet 1988. Les enfants restent rarement insensibles à ce souvenir familial, que je leur laisse toucher. S'ils sont émus, j'ai gagné la partie : ils mesurent que regarder, écrire, ça peut être autre chose qu'une corvée, qu'une heure d'ennui, enfermé dans une classe.
Donc : je butis pas toujours. Ou alors, des fois, c'est mental. Je butis sur des élèves maussades, mal aimés, contrariés. C'est comme les fées, les enfants : si on les contrarie, ils deviennent sorciers. A moi de les amadouer, de les sortir du maléfice. C'est difficile, en si peu de temps. Mais j'y parviens en général. En plus du rouleau à pâtisserie, j'ai une baguette magique. Et l'encre de mon stylo est, depuis toujours, bleu des mers du sud. Avec un tel matériel dans le cartable, tous les miracles sont possibles. Je butis finalement jamais sur les enfants.
Mais sur les profs, parfois. Ceux qui désespèrent - et qui y ont bien des excuses - ceux qui ne savent pas vraiment se démettre de leur rôle pour me laisser un peu de place dans la pièce que nous jouons ensemble ; ou ceux qui, au contraire, m'abandonnent l'équipe, se mettant hors-jeu pendant que j'essaie de marquer des buts. Ceux encore qui, distraits, changent les dates d'ateliers parce qu'ils ont oublié que c'était jour de grève, de voyage, d'examen, et qui s'imaginent que moi, que nous-les-écrivains, n'avons nulle autre occupation : ne sommes-nous pas de cette engeance d'artistes qui se nourrit de l'air du temps, s'abreuve de l'eau des ruisseaux et passe sa vie par les chemins, une herbe entre les dents, une rime entre les oreilles ?
Mais le pire est atteint avec le dernier verbe. Je tombus régulièrement sur les marches de l'autocar. Celui qui devait me livrer la classe au musée, au moulin, au jardin. Et qu'on a oublié de réserver ce matin-là. Ou qui est parti ailleurs, par distraction également, ou pour cause d'agenda surbooké (constatez, au passage, comme je suis trop, super-géniale, causant top de chez top, malgré mon allergie bien connue à la télé et aux Zordinateurs).
Et puis, si tout s'est bien passé, si, ensemble, élèves, profs et moi avons triomphé des embûches (avec le renfort des documentalistes quelquefois car ces dames-ci ménagent rarement leur enthousiasme), je tombus encore, au retour, dans la solitude de mon devoir du soir, la dernière page à graffiter : la facture de ma leçon d'écriture ! Sa rédaction obéit à des règles intraitables, qui me demeurent plus obscures que les exceptions grammaticales. Et je dois souvent recommencer ce pensum, pour cause de zéro pointé. Jamais j'aurai mon exam.
J'ai parfois des tentations de renoncer à ce prosélytisme d'écrivain ; de proposer une organisation plus raisonnable, plus rationnelle : est-ce que le chauffeur du car, dont dépend finalement la vocation littéraire des élèves (et auquel on ne demande jamais de baisser ses tarifs, alors qu'on marchande parfois les miens) ne pourrait assurer, à ma place, ces ateliers d'écriture ? et sans conduire ces troupes aux musées, moulin, abbaye, jardin (j'en oublie) ? Rester sur le parking de l'école, du collège, permettrait des économies d'essence, et de temps, car la classe, immédiatement, se jetterait sur les stylos et cahiers, en place de bailler, flirter, jouer du portable ou des mandibules sur les Mars, brownies et autres sucreries si néfastes à la santé ; au lieu d'implorer : c'est quand qu'on arrive ? Car le chauffeur de car serait capable, j'en suis certaine, de réussir, grâce à sa naturelle autorité poids lourd, là où les profs et moi semblons avoir échoué : apprendre à nos chères têtes blondes, beurs et noires la conjugaison du passé simple, leur temps préféré, cet ingrat vers lequel, dans leurs textes, ils courent, butent et tombent.

Comme le précise l'article de Paris-Normandie ci-dessus, le texte qui suit est une œuvre collective. Je ne m'étais livrée à ce type d'exercice (qui tient de la mayonnaise : les élèves fournissent les ingrédients, à moi de les amalgamer ...) qu'avec des élèves trop jeunes pour vraiment maîtriser l'art du récit (voir Le voyage des deux Indiens et Les Fabuleux secrets du baobab, dans la rubrique voyages) ou un groupe trop disparate : élèves mêlés de classes d'un LEP et d'un I.M.E., où nous nous serions exposés, les livrant à l'habituel travail individuel, à ce que certains d'entre eux, en trop grand difficulté, ne produisent rien. Pour cette classe du lycée Flaubert, j'étais un peu plus réticente, car il me semblait que le niveau devait permettre ce travail individuel. Le but des ateliers est en effet de faire écrire les élèves et non pas l'écrivain (même si je participe, tout comme les enseignants, ce qui est une des différences avec les cours : il n'y a plus d'un côté celui qui maîtrise le savoir, l'impose, et ceux qui le reçoivent, mais, pour un temps donné, cette démocratie d'un exercice pour tous). L'enseignante tenait à un texte collectif (d'autant plus qu'elle avait admiré l'exposition consacrée à Mellicie hallucine et rencontré Nora Magnan, à l'initiative de ce projet). A juste titre finalement. Car son enthousiasme lui avait fait organiser un projet très riche, comprenant plus de visites que d'ateliers, le fil conducteur n'était donc pas évident à trouver; et il fallait, dans chaque épisode, inscrire plusieurs de ces lieux : en plus de joindre, il était nécessaire de condenser. Mais j'ai obtenu que les textes individuels soient également conservés et présentés lors de cette exposition finale, tout comme le texte collectif, bâti sur le même principe que Mellicie hallucine : une jeune héroïne voyage à travers le temps. La différence essentielle est que Mellicie se déplaçait aussi dans l'espace (puisque ses aventures l'emmenaient de la Normandie au Nouveau Monde) alors que cette nouvelle héroïne ne quitte guère son périmètre habituel, d'abord exploré lors d'un rallye à travers Rouen, où la cathédrale était, à l'unanimité, le lieu le plus marquant. La cathédrale serait donc le départ de l'aventure, le lieu initiatique...
NOUS AVONS TOUT LE TEMPS...

Ce matin, 8 septembre 2006, les cours que j'ai l'habitude de suivre au lycée Flaubert de Rouen, n'ont pas lieu. Enfin ... n'ont pas lieu pour ma classe, car notre professeur de français nous a organisé un rallye dans la ville, pour mieux en connaître les plus célèbres endroits ou monuments : la place du Vieux Marché, où les Anglais brûlèrent Jeanne d'Arc, l'Aître Saint Maclou, où furent entassés les morts lors des grandes pestes, et la cathédrale - où j'espère que les histoires révélées par la guide seront un peu moins morbides.
Je ne suis jamais entrée dans la cathédrale. Ce n'est pour moi qu'une grande bâtisse d'un temps révolu, au croisement de diverses rues piétonnes où je regarde plus volontiers les vitrines avec mes copines. Mais, aujourd'hui, sérieux, sérieux, nous avons même un questionnaire à remplir, histoire de vérifier si nous avons bien écouté.
A dire vrai, et à ma grande surprise, ce que j'entends est si passionnant que j'en oublie de remplir ces feuillets. Tant d'histoires merveilleuses sous ces hautes voûtes de pierre, qu'il s'agisse des légendes de Saint Romain apprivoisant une terrifiante gargouille, de Saint Julien, assassinant par erreur ses parents, ou des vies de ces personnages médiévaux dont les cadavres ont été enclos dans des gisants à leur effigie. La cathédrale ne me semble plus cet énorme bâtiment vide de sens, où ne circulent que des touristes. Je la sens animée de toutes ces vies disparues. Je décide de rester un moment encore, assise sous le vitrail, si beau, si bleu, où la vie de ce Julien, furieux chasseur, est contée comme dans une B.D. où il n'y aurait que des images (car les textes auraient été inutiles à instruire les populations, alors analphabètes. Seuls, le roi, quelques nobles et les religieux savaient écrire, en latin essentiellement).
Je suis si fascinée que j'en perds la notion du temps. C'est comme une espèce de rêve éveillé, où je n'ai plus vraiment conscience de ce qui m'entoure. Et pourtant, soudain, le silence me frappe, me tire de cet engourdissement. Je me lève, regarde autour de moi. Il n'y a plus personne, et les grandes portes se sont refermées. J'essaie de ne pas céder à la panique, il suffira que je sonne mes copines sur mon portable, et je serai bientôt délivrée, nous rirons ensemble de ma distraction. Mais ni Perle, ni Magnolia, ni Charlène ne répondent à mon appel. Mon portable semble hors service. Je m'entête pourtant à faire tous les numéros que j'ai mis en mémoire, et j'en suis au dernier quand une lumière étrange m'éblouit. Une lumière qui ne vient ni d'une lampe, ni des cierges, mais qui, inexplicablement, m'attire et m'apaise en même temps. Je vais vers elle, découvrant qu'en son centre se dresse un homme, tenant en laisse un animal fabuleux. Je reconnais Saint Romain à cette gargouille. Spontanément je m'agenouille, le priant : Aidez-moi à sortir d'ici . Il semble réfléchir, se grattant le menton, alors que la gargouille souffle de l'air chaud par ses grosses narines dilatées. Je n'en mène pas large, car rien dans ma vie antérieure ne m'a préparée à une telle rencontre. Le saint parle enfin, tête levée vers le vitrail que j'admirais tant : Qu'en dis-tu, Julien ? A ma grande stupéfaction l'apostrophé tombe de son vitrail, proposant d'également consulter les morts des gisants. Je claque des dents, à l'idée de ces squelettes soulevant leurs dalles pour instruire mon procès. S'il est aussi inique que celui qu'on fit à Jeanne d'Arc, qui n'avait guère que trois ans de plus que moi, je risque de très mal finir. J'avise alors, derrière les deux saints et la bête monstrueuse, une petite porte rouge que je n'avais pas remarquée, et je cours vers elle, espérant qu'on aura négligé de la refermer. Derrière moi j'entends crier : Pourquoi donc es-tu si pressée ? Nous avons tout le temps...
J'ai heureusement atteint la porte, que je pousse, et qui s'ouvre dans un grincement digne d'un film d'horreur. Ouf, le cauchemar est terminé : je suis libre, je vais retrouver mes copines, mes profs, mon univers habituel, j'irai m'acheter une nouvelle carte pour mon portable, et un pyjama neuf chez Etam, avec de rassurants nounours brodés sur le col. Je cours, je vole vers cette boutique, mais suis brutalement arrêtée dans mon élan par un cochon fouillant un tas d'ordures. Qu'est-ce qu'il fait là ? D'où s'est-il échappé ? De la légende de saint Antoine ? J'essuie mes yeux, encore brouillés des larmes de l'émotion, et découvre que le cochon n'est pas seul à puer, les mendiants du porche de la cathédrale n'ont pas meilleure odeur dans leurs guenilles. Je tourne la tête vers Etam, stupéfaite que les élégants mannequins des vitrines soient remplacés par un étal de poissons qui ne semblent pas très frais. Je demeure pétrifiée, comprenant soudain que si je n'ai pas changé de ville - la cathédrale est toujours là, mais greffée de petites maisons, collées contre elle comme des sangsues - j'ai traversé le temps, transportée en plein moyen-âge. J'en demeure pétrifiée jusqu'à ce qu'un cri inintelligible me parvienne au-dessus de ma tête, juste avant que la personne qui l'a poussé par l'étroite croisée me jette un seau d'urine. Ah, comme ce siècle me semble loin des magnifiques vitraux, et des enluminures précieuses, des tapisseries tendues dans les châteaux, où les belles dames attendaient leurs valeureux chevaliers partis chasser ou combattre sur leurs fringants destriers, et qui reviendraient apporter leur cœur en même temps qu'un bouquet de roses. J'ai quitté un cauchemar pour un autre, bien pire, où personne ne semble prêt à m'aider, me proposer une douche. Ah, comme je voudrais être ailleurs, dans une prairie parfumée, près de la mer... Ce souhait est si violent, il me fait si mal que je m'évanouis.
Ce sont des chants d'oiseaux qui me réveillent, et une odeur de café chaud. Je suis couchée dans un lit inconnu, entre des murs que je n'identifie pas. Mon premier geste est de toucher mes cheveux (ils sont secs) de les respirer ( ils n'ont gardé que le parfum de mon dernier shampooing, sans trace de l'urine médiévale qu'ils sont reçue postérieurement). Je repousse le drap brodé, l'édredon rouge, et me précipite vers un grand miroir. Je suis saisie de ne plus me ressembler vraiment, comme vieillie de quelques années. Cependant décidée à l' optimisme, je me dis : Génial, je suis arrivée dans mon futur, où sûrement, n'avoir pas rempli le questionnaire d'un rallye est une faute oubliée ! Ma chemise de nuit est blanche, à manches longues, comme la robe disposée sur un mannequin d'osier. On frappe à ma porte avant que je n'ai eu le temps de réfléchir à la situation nouvelle. Sans ouvrir, je demande : Encore un moment, s'il vous plaît , ce qui me rappelle ce vieux conte de Barbe-Bleue où l'épouse trop curieuse implorait le mari prêt à la trucider. Derrière la porte une voix me répond : Pressez-vous, mademoiselle, ou le café sera froid, ça porte malheur un jour pareil ! Aïe, encore des ennuis en perspective, qu'est-ce que ça peut bien être un jour pareil ? Je regarde de nouveau autour de moi, et je comprends, face au mannequin d'osier, qu'il supporte une robe de mariée, vraisemblablement la mienne ! Mais la faim me torture trop - je n'ai rien mangé depuis mon chocolat et mes céréales matinales du 8 septembre 2006 - je sors de ma chambre. En bas de l'escalier, toujours guidée par l'agréable odeur, je trouve facilement la cuisine, où une grosse femme habillée de sombre, avec tablier et bonnet blancs, tranche gaillardement du pain. Vous v'là enfin, me dit-elle ! Tous les autres sont déjà à s'habiller... Je me jette sur le bol fumant, les tartines, le beurre, la confiture, autant par faim que pour n'avoir pas à répondre. L'autre continue son monologue : Fait si biau que j'm'en vas vous dresser la table dans la prairie. A ce moment-là, un jeune homme entre dans la cuisine, une cuisse de poulet dans chaque main. Je suis stupéfaite, car il ressemble étrangement à Mathieu, mon camarade de classe. Est-ce que lui aussi traverserait le temps ? Mais la femme me pousse dans l'escalier, après m'avoir mis une bouilloire d'eau chaude en main, je rejoins ma chambre, pour me laver et m'habiller. Mais où me laver ? Je ne vois ni douche, ni baignoire, ni lavabo. Sur une table recouverte de marbre, j'avise pourtant deux objets qui me sont familiers : une bassine et un grand pot de faïence. Ce sont des objets identiques à ceux d'un héritage familial auquel ma mère du XXI° siècle tient beaucoup, même si elle n'en use plus que pour décorer un meuble du salon : dans le pot où je trouve l'eau froide, elle a disposé un bouquet d'hortensias séchés. Moi, je mélange l'eau froide et l'eau chaude dans la cuvette, et je me lave à l'ancienne (on appelait ça se débarbouiller je crois). Mais que dois-je faire ensuite de l'eau sale ? La jeter par la fenêtre, comme au moyen-âge, risquant d'arroser Mathieu, la cuisinière, quelque membre de ma famille inconnue ? Je n'ose un geste si contraire à mon éducation et tente de m'habiller. Mais pour lacer le corset je dois appeler à l'aide, n'ayant pas de mains dans le dos. Mon portable est toujours hors service. A tout hasard, je crie : Maman ! Une petite fille vêtue de rose entre, son visage chiffonné de tristesse et me demande : Pourquoi t'appelle maman ? Tu sais bien qu'elle viendra pas ! J'ai dû gaffer, je le sens, je me promets de parler le moins possible, car être la mariée ne me renseigne pas pour autant sur la famille où je suis brutalement entrée pour jouer ce rôle. Les petites mains lacent mon corset, m'aident à passer la robe, posent sur ma tête une couronne d'oranger, qui maintient un voile de tulle. L'enfant applaudit : Comme t'es belle, mon Elisabeth ! Sûr que Richard va être content de t'épouser. Ces deux prénoms me troublent, car ce sont ceux de mes arrières arrières grands-parents, que je n'ai pas connus, mais dont on m'a beaucoup parlé. Ils s'étaient mariés en juillet 1884, à Yport. Donc, je ne serais pas dans mon futur, mais dans le passé de ma famille ? Avec pour mère morte l'arrière grand-mère de la mienne, bien vivante, et qui doit s'inquiéter en cet automne du XXI° siècle que j'ai brusquement quitté?
J'ai tant réfléchi à cette question (m'embrouillant un peu dans le calcul des générations) que je n'ai pas vu passer le temps à la mairie, à l'église. Mais sans doute ai-je dit les bonnes réponses, ai-je fait les bons gestes, car rien n'est venu troubler la joie des invités. A présent, assise à la grande table dressée dans la prairie, ayant ôté mon voile par commodité, j'écoute mon père, debout à côté de moi et qui s'embrouille un peu dans son discours, un verre dans une main, une serviette dans l'autre. Je souris à Richard, en face de moi, si beau avec sa fleur blanche à la boutonnière, qu'il a tirée du bouquet posé au centre de la table. Les voilà, les roses de mon chevalier médiéval, telles que je les rêvais ! J'ai connu pire, comme aventure temporelle ! Ce XIX° siècle me convient mieux que le moyen-âge. J'abandonne de fixer Richard pour regarder les autres convives et constate que ma jeune sœur s'ennuie au bout de la table, secoue un maigre bouquet en direction d'un bébé assis sur les genoux d'une femme âgée. Un bébé qui s'agite, semble vouloir dire quelque chose à un homme en face de lui. Soudain il crie : Kéké , sollicitant l'attention de la tablée qui baillait au discours de mon père. Chacun de s'extasier : Mais il parle, le poupon, il parle enfin ! Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce premier mot : kéké ?
Nous nous retournons, pour voir ce que l'enfant désigne du doigt, en direction de la maison. Il montre une fenêtre ouverte, où peut-être, sur le mur de cette pièce, une gravure encadrée. Chacun profite de la diversion pour se lever, abandonner mon père à son discours interrompu. Moi j'entre dans la maison, pour mieux regarder ce dessin, qui me semble familier. Son titre me confirme qu'il s'agit de Rouen, vu de la côte Sainte Catherine. Brutalement j'ai envie d'être là-bas, plus proche de ma famille du XXI° siècle, au moins géographiquement, et je passe ma main sur ce paysage connu, surprise de sentir une grande chaleur sous ma paume ; le verre disparaît, comme s'il fondait, et le paysage grandit autour de ma main, grandit, grandit, au point que ma main est finalement posée contre l'écorce d'un arbre proche du prieuré Saint-Michel, à mi-hauteur de cette côte. La chaleur s'est éteinte, et le silence s'est fait brutalement. Je me retourne. Yport a disparu. Je suis vraiment revenue à Rouen, que je découvre derrière moi. Je ne vois d'abord que la cathédrale, qui me rassure bien que j'ai contre elle quelque rancune, car c'est en ses murs qu'ont commencé mes terribles aventures, mais, portant mon regard vers la Seine, je suis surprise de n'y pas trouver le compte de ponts. Et la rive gauche est beaucoup moins urbanisée, quasi toute constituée d'une épaisse forêt. Comprenant que si je suis de retour dans ma ville je ne suis pour autant de retour dans mon époque, je me mets à pleurer, et à marcher, sans bien savoir dans quelle direction. Mais je suis vite essoufflée car la montée est raide. Je m'assois au pied d'un vieux calvaire, contre lequel, épuisée de chagrin, de peur, de froid (car quittant Yport j'ai quitté l'été semble-t-il), je me blottis, fermant les yeux. Mais je surprends un pas léger, furtif, comme un petit animal dérangé sous des broussailles - la côte en est emplie - et une main tiède se pose sur moi. Je n'ose relever mes paupières, craignant d'être déçue, car c'est la main de ma mère que je souhaiterais, et il n'est pas certain que ce soit elle, là, près de moi : elle n'a pas, pour le moment, été de mon grand voyage dans le temps. Une voix s'ajoute à la main, me disant : je suis sainte Catherine, à laquelle ce mont est voué, ne te décourage pas, jeune fille, je peux t'aider. La voix est douce, j'ouvre finalement les yeux. Il n'y a personne. J'aurais dû m'en douter, le sortilège n'est pas achevé ! Et je n'ai guère confiance en tous ces saints, car l'habitude s'est perdue de les rencontrer aussi facilement qu'au moyen-âge, je n'ai pas les codes, moi, pour vivre en dehors de mon siècle...A propos de code, toujours en panne, mon portable, seul objet conservé d'un siècle à l'autre ? Hé oui : toujours muet. Les saints me parlent et les objets se taisent, j'aimerais pourtant mieux l'inverse ! Furieuse, je me relève, reprends la montée, stupéfaite de me trouver bientôt au cœur d'une bataille. On veut prendre un fort planté au sommet, semble-t-il, les balles sifflent autour de moi, je me jette à terre, pensant de nouveau à ma mère qui me reprochait tant de ne pas m'intéresser aux cours d'histoire. On ne peut comprendre le présent si on ignore le passé, sermonnait-elle. Sûr que je ne comprends rien à ce présent qu'on me fait conjuguer au passé, je ne suis même pas capable d'identifier en quel siècle a lieu ce violent combat, j'ignore qui est mon ennemi, qui est mon allié. Sainte Catherine, Saint Romain, Saint Julien, si je sors vivante de ce trou où j'ai plongé, je vous promets d'être plus attentive au lycée.
La nuit tombe bientôt, et le silence se fait car la bataille s'interrompt. Je décide d'en profiter pour filer, sans plus penser à atteindre le sommet de cette côte. D'ailleurs pourquoi avais-je choisi de monter ? C'est vers le bas, au cœur de Rouen, qu'habite - ou qu'habitait - ma famille (quelle drôle de chose d'employer l'imparfait pour parler au futur ; Sainte Catherine, Saint Romain, Saint Julien, je serai aussi plus attentive aux conjugaisons).
Hélas je ne suis pas la seule à émerger d'un abri provisoire, car j'entends derrière moi le souffle puissant d'un animal en fuite. Serait-ce la gargouille ayant cassé sa laisse ? Un grognement et une odeur fauve me renseignent : c'est un sanglier ! Sans me poser la question de savoir s'il est moyenâgeux ou contemporain, je cours dans la descente, pour n'être pas renversée par la bête, qui n'est sûrement pas copine avec Julien, ce furieux chasseur. Et, bien sûr, à cette vitesse, dans une pente raide, par une nuit sans lune, je tombe brutalement. Une très violente douleur à la cheville me coupe le souffle. Et mon cœur cogne violemment dans ma poitrine... ah...je crois que je meurs...
Après un grand silence et une obscurité totale, dont j'ignore combien de temps ils ont duré, je perçois une faible lumière à travers mes paupières closes, et j'entends des cris de douleurs. Le jour se serait-il levé ? La bataille aurait-elle repris ? Avant d'ouvrir les yeux, je tâte d'une main timide ce que je crois être le sol de la colline où je me suis évanouie, et je suis surprise de caresser un drap. Un drap un peu rêche, mais rassurant tout de même. Je dois être dans un lit, où on me soignera. J'ouvre les yeux. Plafond haut, blanc, comme les murs. Je suis bien dans un lit, dont le matelas semble être en paille. Et, tous mes sens me revenant, mon odorat m'annonce que cette paille ne doit pas être très fraîche. Quant aux cris, ils m'arrachent les oreilles. J'ouvre les yeux. Et je les referme aussitôt, incrédule, car j'ai cru voir que nous étions six dans ce lit. Je demande, d'une voix étranglée : où suis-je ? Entre deux quintes de toux mon plus proche voisin me répond : A l'Hôtel-Dieu. J'ajoute : et depuis quand ? Le catarrheux me répond, avant de s'étouffer dans une quinte plus violente : depuis ce matin, t'as eu bien de la chance qu'un maraîcher te trouve au bas de la côte et te porte ici sur sa charrette. Pour échapper à l'haleine et aux postillons de ce voisin, je me tourne sur le côté, juste au moment où un homme au tablier sanglant traverse la salle. Mon voisin reprend, sa toux calmée : v'là m'sieu Flaubert, le chirurgien qui vient d'amputer. Je suis terrifiée à l'idée que ce sera peut-être bientôt mon tour de sentir une scie entrer dans mes chairs, et sans être anesthésiée, car si je ne suis pas très douée en histoire, je sais au moins qu'à cette époque ces merveilleux produits nous empêchant de souffrir n'étaient pas encore inventés, c'est ma cousine infirmière qui me l'a dit. Alors que la nuit tombe, je prends la décision de m'échapper, quel que soit l'état de ma cheville. J'attends que tous mes voisins s'endorment, faisant semblant moi-même d'être assoupie. Toutes les veilleuses sont éteintes, mais, de nouveau, il me semble qu'une lumière traverse mes paupières. Une garde nocturne peut-être, faisant sa ronde ? Je ne bouge pas d'un cil, mais j'entends une voix murmurer à mon oreille : boute-toi de cette paillasse à sanies, damoiselle, sinon demain seras couverte de bubons pesteux et prompte mort s'ensuivra. J'ouvre les yeux, mais la personne qui m'a tenu ce curieux langage déjà s'éloigne, je ne vois plus qu'une armure, de dos, dans un cercle de lumière. Je crie : Jeanne, Jeanne ! Mais l'héroïne que j'ai cru identifier a disparu. Je repousse le drap et la mince couverture, je pose un pied par terre, puis l'autre, réprimant un cri de douleur, et je commence à me sauver, à cloche-pied, sans savoir m'orienter dans cet immense bâtiment qui, pour autant que je me souvienne de mon futur, devint une préfecture. Toutes les portes du rez-de-chaussée sont fermées. Pourquoi donc Jeanne d'Arc n'a-t-elle pas fait sauter les serrures d'un coup d'épée ? Je tente ma chance vers les étages, ma douleur maîtrisée par ma volonté de m'enfuir. Mais sur une marche, un enfant est assis, qui lit à la lueur d'une bougie. Il est en chemise, comme moi, mais ne paraît pas malade. Je lui dis : Bonsoir, comment tu t'appelles ? Il me répond : Gustave. Et il ajoute : tu veux te sauver ? Je réplique par une autre question : m'aiderais-tu ? Il referme son livre, se lève, tenant la bougie de sa main libre, et il descend l'escalier que j'étais en train de monter. Je le suis. Il semble très content quand il m'annonce : c'est facile, par cette fenêtre. Il ouvre en effet une fenêtre, m'aide à y grimper. Il précise : de l'autre côté c'est notre jardin privé, la clef de la porte est sous le troisième pot de ravenelles. Sa voix me paraît soudain attristée, et je lui propose : viens donc avec moi. Mais, refermant la fenêtre, il conclut : non, non, la fuite n'est pas pour moi, je veux rester toute ma vie enfermé dans les livres.
Je saute dans le jardin, la fenêtre se referme, je me retourne pour voir encore un instant, à la lueur de sa bougie, cet enfant qui sent déjà qu'il deviendra écrivain. Quelle force, quelle volonté l'animent, si jeune, alors que moi, qui ai bien 6 ou 8 ans de plus que lui, je ne suis pas encore déterminée quant à mon avenir ? Mon avenir dans le 21° siècle, si j'y reviens...
J'ouvre la porte du jardin. Comme les rues sont noires, sans les lampadaires auxquels j'étais habituée en 2006. Je bute sur ce que je crois être un paquet oublié, mais la forme remue, m'insulte, se dresse. C'est un S.D.F. Je fuis au hasard, paniquée d'être poursuivie, craignant de bousculer encore d'autres clochards. Mais j'aperçois soudain, devant moi, à quelque distance, le cercle de lumière dans lequel Jeanne d'Arc m'apparut à l'hôtel Dieu. Je cours dans cette direction, criant : Jeanne, Jeanne, attends-moi ! Mais elle ne s'arrête pas, continue d'avancer, et soudain disparaît, alors que j'atteins le quai. J'évite de justesse la chute dans l'eau, devinée à son clapotis et son odeur. Jeanne a coulé dans la Seine, et me souvenant que c'est là que furent jetées ses cendres, je comprends que je ne la verrai plus. Ni elle, ni Flaubert enfant, ni sans doute saint Julien, saint Romain et sa terrible gargouille. Mais qui, encore vais-je rencontrer dans ces aventures sans fin, qui m'épuisent ? Je suis seule, abandonnée dans la nuit d'un siècle qui n'est pas le mien, j'ai peur, j'ai froid, j'ai sommeil. Ah, seulement dormir un moment, manger ne serait-ce qu'un vieux bout de ce pain sec que je gaspillais en 2006... Un bateau est amarré, et je monte à bord. Avançant à tâtons sur le pont, j'identifie des sacs emplis de grain, et je me creuse un abri en leur centre. A peine suis-je accroupie, inconfortablement, l'estomac tordu par la faim, que je m'endors.
C'est une sensation de mouvement qui m'éveille. Je passe la tête hors de mon abri, découvrant que le bateau n'est plus à quai, mais vogue sur la Seine, qui, dans la lumière du matin, m'apparaît beaucoup plus large que lorsque j'allais me promener en rollers sur ses quais, le dimanche, avec ma famille. Aurait-elle débordé ? Mais je n'ai pas le temps de réfléchir à la question qu'une voix tonne derrière moi : qu'est-ce que tu fais ici ? Je me retourne, découvrant que la voix, pour terrible qu'elle me parût, est celle d'un jeune homme. Je le supplie : ne me chasse pas, je n'arrête pas de m'enfuir, je suis fatiguée. Il semble hésiter, m'interroge : Et d'où tu t'es enfuie ? Je réponds : de l'Hôtel-Dieu. Il semble effrayé : t'es contagieuse ? Je le rassure : non, je n'avais qu'une cheville foulée. Il se met à rire : et t'étais à l'hôpital pour si peu ! Sûr que le capitaine de la gribane me débarquerait pas pour un si petit bobo ! Un peu froissée d'être prise pour une douillette, je proteste, énumérant : j'ai également fui un dragon dans la cathédrale, un pot de chambre vidé sur ma tête, un mari que je n'avais pas choisi et qui était mon arrière-arrière grand-père, une guerre sur la côte Sainte Catherine, un sanglier caché dans les broussailles, un chirurgien sanglant, armé d'une scie à amputer, et des voisins de lit qui avaient peut-être la peste. J'ajoute, pour qu'il mesure bien ma terrible détresse : tout ça sans pouvoir appeler à l'aide sur mon portable ni manger à ma faim. Il se gratte la tête, perplexe, prend le parti de plaisanter : Et moi, je ne serais pas Jeanne d'Arc pendant que tu y es ? Je conteste : c'est impossible puisqu'elle a disparu en Seine alors que je la suivais après que Gustave Flaubert m'ait aidée à fuir l'Hôtel-Dieu. Il reprend son sérieux pour soupirer : Sûr que si les infirmiers te rattrapent, ils te passent la camisole de force. Sors de là, je vais te cacher à l'intérieur du bateau. Je le suis. Il me donne à manger, un restant de soupe, qui, pour claire qu'elle soit, me semble meilleure que tous les potages en sachets du 21° siècle. Et il m'ordonne, me tendant des vêtements : passe donc ce pantalon et ce sarrau, pour cacher ta chemise. J'obéis, et il me quitte sur une dernière recommandation : si on n'atteint pas Caudebec à temps, ça va secouer dur, à cause du Mascaret, ce sera prudent que tu t'encordes autour de la base du mât.
Seule je m'allonge sur un sac de paille, qui doit servir de couchette, et je m'interroge : pourquoi donc aurais-je peur du Mascara ? Je m'en mettais tous les matins avant de me rendre au lycée... Le lycée ! Je le regrette, car la vie y était bien plus douce que celle que je mène à présent. Je jure, sur mon assiette de soupe hélas vidée, que si je retourne dans mon siècle je serai plus attentive en cours. Et j'ouvrirai mon dictionnaire pour savoir ce que sont des ravenelles, une gribane, une camisole de force et un sarrau. Je rêvasse à cet avenir studieux quand soudain j'entends crier au-dessus de ma tête : Le v'là ! le v'là ! J'ignore qui arrive, mais brutalement je suis secouée d'un bord à l'autre, le bateau semble se dresser à la verticale, et des paquets d'eau me tombent dessus par la porte arrachée de ses gonds. Un mugissement de tempête a couvert les cris. Je ne maîtrise plus mes mouvements, ma tête va brutalement cogner contre ce mât auquel je ne me suis pas encordée. Ma dernière pensée est que cette fois je meurs...
C'est une douleur au crâne qui me réveille. Douleur qui m'assure que je suis encore en vie. Quel bonheur, où que je sois ! J'ouvre les yeux décidée à être aimable même si je dois me trouver devant un monstre surgi de la Seine ! Surprise : je suis toujours à l'intérieur du bateau, qui semble aussi sec que mes vêtements. MES vêtements ! Ceux que je portais pendant le rallye, ce 8 septembre 2006. Mon portable est fidèlement dans ma poche, et son cadran est à nouveau lumineux ! Mais avant de sonner qui que ce soit, je tiens à m'assurer que je ne rêve pas, que je suis bien retournée dans mon siècle ! Je grimpe l'escalier de métal, et, depuis le pont je regarde autour de moi. Mon bateau n'est plus sur l'eau, mais à l'intérieur d'un hangar ouvert, avec des barques, également au sec. Et la Seine est toute proche, surmontée de la silhouette si gracieuse et surtout si familière du Pont de Brotonne. Aucun doute n'est plus possible : je suis bien revenue dans mon époque. Je quitte le bateau, cours vers une porte vitrée, parfaitement contemporaine. Elle ouvre sur une petite pièce, avec un tourniquet de cartes postales, un guichet, des affiches ; derrière une autre porte, j'entends des voix qui me semblent également familières ; je l'ouvre, me trouvant dans une salle de projection. Mes camarades de classes y sont assises, et quatre de mes professeurs, ainsi qu'une petite dame inconnue. Madame Laissac me dit : Toujours la dernière ! On a failli commencer sans toi. Je ne réplique pas, vais m'asseoir à côté de ma meilleure amie, qui me chuchote : mais pourquoi t'étais si longtemps aux toilettes ? Ne sachant quoi répondre, je me tais, regarde le film, qui nous raconte la Seine. La Seine qui faisait 4 km de large jusqu'au XIX° siècle, alors qu'elle ne mesure plus que 300 mètres. La Seine qui connaissait deux fois l'an le phénomène du Mascaret, qu'un autre film, dans une autre pièce, nous montre, car il a sévi jusqu'en 1962. Ecoutant les commentaires, et mes camarades, mes professeurs, une jeune personne qui nous guide, je comprends que je suis au musée de la marine de Seine, à Caudebec-en-Caux, où j'ai cru mourir pendant qu'on me supposait aux toilettes. J'écoute attentivement tout ce qui se dit, surtout pour éviter de parler, de me trahir (je me souviens comme le jeune mousse du bateau doutait de mon effrayant récit) ; ce musée me paraît d'ailleurs très intéressant. On apprend même à y faire de ces nœuds marins qui auraient pu servir à m'encorder au mât de la gribane. Quand la visite est terminée, j'espère que nous allons rentrer à Rouen, mais nous nous dirigeons vers un petit bâtiment. Trois murs en béton, et des portes vitrées en place du quatrième. Il fait beau, chaud, clair, la Seine brille sous le soleil, son flot calme balançant un ancien bac devant nous. Je ferme les yeux, pour profiter de ce bonheur. Mais la voix de Madame Laissac me gourmande : Ah, non, on ne dort pas ! On mange et ensuite on écrit la suite de notre conte. Panique à bord : j'ai dû rater des cours, je ne sais pas du tout de quoi il est question ! Manger, ça je sais faire, même si j'ai oublié le pique-nique que tous les autres élèves on emporté. Solinda, toujours serviable, partage le sien avec moi. Ah, comme c'est bon des chips, des Mars, du Coca-Cola !
Le déjeuner fini, nous reprenons ce fameux conte, dont j'ignore tout. La petite dame qui m'est inconnue semble tenir le gouvernail, rappelant : donc, nous avions laissé notre héroïne sur la gribane, cachée entre les sacs de blé... J'en suis pantoise : n'est-ce pas mon étrange aventure que la classe est en train d'écrire ? Chacun semble s'appliquer, surtout Emilie et Alexandra, alors je fais de même, ce qui est nettement plus facile pour moi que pour les autres élèves, car le Mascaret sur la Seine je l'ai vraiment vécu, et je peux imaginer la terreur de Léopoldine Hugo quand elle s'est noyée avec son mari et un neveu. Soudain, la petite dame - dont j'ai appris que c'était un écrivain (comme quoi ils ne sont pas tous morts, enterrés dans les livres scolaires) - nous propose une récréation, pour aller admirer des enfants déguisés qui arrivent sur la pelouse voisine. Mes camarades se précipitent, admirant surtout un groupe de petits costumés en Dalmatiens, avec leur institutrice habillée en Cruela. Moi je reste à distance, car je ne veux pas risquer une nouvelle aventure, genre devenir un chien finissant en manteau. Je demande seulement à un inconnu : pourquoi sont-ils déguisés ? L'inconnu me répond, d'un air d'annoncer une évidence : on est le 15 mars, c'est la mi-carême. Je m'en étrangle de saisissement. J'ai disparu dans le moyen-âge le 8 septembre 2006, et reparu dans mon siècle le 15 mars 2007, mon voyage dans le temps a duré plus de six mois, et non pas ce court moment où mes camarades me croyaient dans les toilettes du musée. Mais alors, terrifiante question : qui a pris ma place, mon apparence, pendant tout ce temps ? Est-ce que je vais trouver mon double quand je rentrerai chez mes parents ? Ou est-ce que cette intruse dans ma famille sera retournée dans la sienne ? Ma gaieté tombe brutalement, et je suis distraitement la fin de l'atelier d'écriture, prétextant que je manque d'imagination, que je suis hors sujet, que je n'ai rien écrit. N'importe quoi plutôt que d'éveiller des soupçons dans la classe.
Je suis la première à monter dans le car quand il revient nous chercher, la première à en descendre devant notre lycée. Sans même saluer mes amies, je cours vers ma maison, où j'arrive très essoufflée. Je sonne. Ma jeune sœur m'ouvre la porte, me demandant : t'as perdu ta clef ? Je ne réponds pas, l'interroge : tout va bien ici ? Elle me dit : pas pour toi, ce qui ne manque pas de m'inquiéter. J'insiste, tremblant déjà : qu'est-ce qui s'est passé ? Ma mère paraît à ce moment-là, sortant de la cuisine, et me précise, visiblement contrariée : t'as encore oublié d'éteindre ton ordinateur en partant ce matin, file dans ta chambre me couper ça tout de suite, les factures d'électricité et de téléphone, ça commence à suffire. J'obéis immédiatement, non sans embrasser ma sœur et ma mère au passage, en leur criant : je vous aime, je vous aime tant ! Ma mère hausse les épaules dans un dernier reproche: c'est ça, c'est ça : cajole-moi pour que je me calme ! Je ne suis pas dupe, tu sais ! J'ouvre la porte de ma chambre, le cœur battant, craignant encore d'y trouver mon double. Il n'y a personne. Mais sur l'écran de l'ordinateur, je lis une phrase que je suis bien certaine de n'avoir pas écrite : Nous avons tout le temps...
