VARIA
Les contes, disais-je... je leur empruntais encore une fois un titre :
La Reine des neiges*
A sa naissance, l'année du charleston, elle avait été prénommé Lucette, par sa mère, qui était fille. Lucette Martin, baptisée petite lumière, enregistrée civilement sous un patronyme répandu, elle n'avait, dans son enfance, retenu que la banalité du nom de famille (réduite à trois personnes : il y avait aussi un affreux et tendre clebs), négligeant l'étymologie lumineuse du prénom. Puis, chemin inverse, crise de croissance, premières règles, elle avait voulu sortir de la banalité par la lumière. Elle serait célèbre, comme Piaf, en plus riche et plus heureuse. Plus jolie aussi, ça elle était sûre, des hommes l'attendirent très tôt à la sortie du cours de danse. Maman la repasseuse lui passa tout, ne soupçonnant rien, et fut, à la veille de sa retraite, fière de voir sa fille sur scène, autant que satisfaite d'asseoir ses varices dans un fauteuil crevé. Lucette sautait dans la poussière, sous l'unique projecteur de la salle qui fermerait le lendemain. Lucette était superbe dans son tutu rose, superbe cul auréolé de tulle, les messieurs de Belleville en tiraillaient leur moustache, en agaçaient leur braguette, ce cul sauteur devant leurs yeux, leurs yeux brouillés par la poussière et qui croyaient pleurer d'émotion esthétique, sur une musique de Strauss, Johann évidemment, ils n'avaient jamais entendu parler de l'autre. Lucette sauta en éternuant, jura de consulter un spécialiste, les premiers s'installaient dans les quartiers huppés, salua en éternuant, Lucette, ce qui lui fit un plus grand triomphe encore car les petits seins à leur tour sautaient dans le bustier, à chaque secousse de la fosse nasale arrosant la fosse d'orchestre. Lucette fut la reine de Belleville, un soir, à moins que ce ne fût en matinée, sa biographie ne précise pas, se jura d'être de Paris, la reine, toujours, et décida, Lucette de changer son nom pour celui de Renata, à particule, ce serait plus chic, chic exotique, on ne voyageait pas encore trop loin, sauf elle, bientôt, jusqu'à San Francisco, elle se promit, Renata-à-particule, entre le quinzième et seizième éternuement, De La Fosse s'imposa au dix-septième, quand claquaient les fauteuils sous les fesses des messieurs enfin décidés à quitter la salle, on éteignait le projecteur.
Renata de La Fosse dansa, soigna son allergie, dansa, apprit à écrire sa particule avec une minuscule, c'était la règle, même pour une artiste majuscule, car elle devint, Renata, une artiste en majuscules sur les affiches des théâtres, parisien et de provinces, toute une saison, deux années.
Renata de La Fosse dans La reine des neiges, le tutu avait pâli, rose de l'aube contre blanc du jour, l'étoile vieillissait, fleur de pêché contre flocons d'hiver, il en tombait vraiment au dernier acte, sur la scène balayée où nul entrechat n'envolait plus de poussière, l'impresario avait veillé, ordonnance du médecin remis aux machinistes, à la concierge, au souffleur, on n'est jamais assez prudent. Le titre du ballet, titre de gloire, devint une seconde peau, une troisième identité, port royal eut la danseuse, vêtue de blanc fut la femme, telle une vierge bretonne vouée à Marie. Blanche elle apparaissait sur scène, froide comme un flocon, dure comme un épi de glace, ses articulations s'en raidissaient un peu, au contraire des messieurs de Belleville, depuis longtemps ramollis dans leur costume de sapin, et dont les successeurs avaient des manières moins accortes, l'applaudissement plus avare.
Elle ne vit jamais San Francisco, seulement Cherbourg, port d'embarquement pour les Amériques , on employait encore le pluriel, dernier théâtre pour la vedette débarquée du programme quand les protestations de son astragale couvrirent le tintement du triangle, le chant de la flûte traversière. Elle bouda dix jours à l'Hôtel des Trois Marins, puis, abandonnée par la troupe, s'abandonna dans les bras d'un légionnaire, elle restait fidèle à Piaf et à son premier chien, dont le légionnaire sableux ressuscitait la trogne rase et les oreilles dentelées. Ils s'aimèrent un peu, très peu, ou firent seulement semblant, mal, à contre-temps ; se quittèrent quand il aboya.
Elle refusa de fondre, décida d'être, sinon immortelle, l'impossible, immortalisée dans des mémoires qu'elle intitula Les neiges de la Reine ou l'envers des flocons. Le titre plut à un éditeur, qui le conserva, faisant récrire les huit cent pages du volume mensonger, exergue comprise, par un Argentin désargenté dont l'identité négrière n'apparut par sur la couverture en quadrichromie. Malgré l'excès d'adjectifs le livre eut un certain succès, on comparait la photo de la jaquette, vieille de vingt ans, au visage contemporain de la retraitée, qui montra son lifting parfait (il lui avait coûté ses droits d'auteur) à la télévision. Des lettres d'admiratrices lui parvinrent, demandant l'adresse du chirurgien, d'admirateurs, proposant, de façon saisonnière, le chien qu'ils devaient abandonner à l'entrée de l'autoroute. Des maniaques comptabilisèrent les amants, les flocons, les adjectifs. Ce fut une autre gloire, un grand regain, une renaissance, Renata again, pour la première fois on lui parlait anglais. On évoqua des traductions, un film pour le grand écran, un feuilleton pour le petit. On oublia ces projets, commença d'oublier Renata, une ride lui revint, qui fut gommée par une invitation tardive dans une ville du nord, où se tenait, en Décembre de chaque année, un salon littéraire.
Elle partit avec le nègre argentin, promu nouvel impresario. Il était frileux, avait trente ans de moins qu'elle, le chauffage de train fonctionnait mal, celui de l'hôtel fut pire, le couple fit lit commun pour avoir moins de frissons ou moins d'années. Lui fut chaste, eu égard à sa mère. Ils ne vendirent aucun exemplaire de leurs mémoires, et l'homme déserta la pile de livres pour les verres du bar. Quand il revint, la femme avait disparu. Il la chercha un moment, jusqu'à l'heure du dernier train. Puis, furieux, enrhumé, il quitta la ville. La neige tombait depuis deux ou trois heures, le quai de la gare était blanc, comme les toits, les rues, les allées du zoo. C'est là qu'on retrouva Lucette Martin. Elle était tombée, ou descendue, dans la fosse de l'ours polaire, et paraissait dormir sous la pancarte indiquant : animal en voie de disparition. Elle était morte. De froid, probablement, car l'ours ne l'avait pas touchée.
La Méprise*
Né à Rochefort, patrie de Julien Viaud (qui, en littérature, s'illustra sous le nom de Pierre Loti), David Lecerf avait été un adolescent exalté, s'en allant régulièrement rêver devant la maison natale de l'écrivain. Dans cette demeure, que l'auteur fantasque avait transformée en logis oriental, le jeune homme aspirait aux voyages. Comme Loti, se promettait-il, il partirait vers des îles lointaines, des civilisations différentes ; comme Loti, il se ferait aimer d'une vahiné sous les palmes, il rencontrerait la mystérieuse Aziadé dans le secret d'un harem, et partagerait la cérémonie du thé avec Madame Chrysanthème.
C'est ainsi que pris par ce désir d'Orient ayant également agité nombre de peintres du XIX° siècle, David Lecerf, né au milieu du XX°, devint coopérant culturel pendant neuf années.
C'était plus que ne prévoyait son contrat, et, à la limite de la légalité (il avait usé d'influences pour prolonger ce séjour à l'étranger), il dut bien rentrer, réintégrer le grand corps des enseignants.
Il espérait obtenir un poste dans le sud de la France, mais il fut nommé au collège d'Yvetot. La nouvelle le navra, car il ne connaissait de ce gros bourg normand que ce qu'en avaient écrit Guy de Maupassant et Annie Ernaux. Ni l'un ni l'autre n'avait montré beaucoup d'enthousiasme, et, dans le train qui l'emportait vers la Normandie, David espérait que les deux auteurs avaient quelque peu exagéré les disgrâces du pays de Caux. D'ailleurs, n'était-ce pas le propre de la littérature que d'amplifier la réalité, de la déformer ? David crut tenir la premier sujet de devoir qu'il imposerait à ses élèves : la littérature du désastre chez les auteurs normands depuis le XIX° siècle. Appuyez d'exemples.
Ce mot de désastre lui vint sur le quai d'arrivée quand il quitta la température clémente du wagon pour faire connaissance du si célèbre crachin normand. Il tendit la main à l'épouse qu'il avait ramenée de son exil exotique, et qui, bien plus que lui, aurait du mal à s'acclimater. Bethsabée était livide.
Ils furent reçus par le directeur du collège, et par le notaire, avec lesquels ils avaient rendez-vous. On leur fit visiter l'établissement scolaire et divers établissements, qui leur déplurent. Ils revinrent, et le cercle des recherches s'élargit autour du bourg. Maître Pingard et les époux Lecerf s'enfoncèrent dans la campagne profonde, n'espérant plus de miracle.
Le miracle advint pourtant : à Gueuseville-la-bourbeuse, David et Bethsabée eurent un coup de foudre pour une habitation de briques, fort vaste, qui, en des temps meilleurs, avait été l'unique café-épicerie de ce village ne comptant que deux cent âmes.
La disposition des pièces était demeurée d'origine, avec le bar. Ce fut peut-être cette incongruité qui les séduisit. Ils ne surent pas expliquer, mais signèrent l'acte de Maître Pingard, qui fut grandement soulagé. Maître Pingard connaissait l'histoire locale. Il avait même publié, à compte d'auteur, un opuscule, dont il se garda bien de faire l'article à ceux que, tacitement, il avait baptisé mes gogos des souks.
Les gogos emménagèrent quelques jours avant la rentrée, suscitant la légitime curiosité de leurs voisins.
Ceux-ci, prudemment embusqués derrière leurs rideaux, constatèrent que le mobilier transitant du camion à la maison était peu traditionnel : il ne comprenait ni armoire ni horloge, mais regorgeait de sièges hétéroclites, de tapis, de poufs, d'objets en cuivre, toute eun' brocante dont j'donnerais point trois sous conclut le père Anselme, l'ancien du village. Un brocanteur se présenta effectivement peu après, qui fut éconduit. Mais cette visite parut utile aux Lecerf, leur confirmant ce qu'ils avaient immédiatement soupçonné : ils manquaient, pour être adoptés, de couleur locale.
Ils remisèrent donc au grenier tout ce qu'avait souhaité acquérir le commerçant ambulant. Ils meublèrent les vides obtenus en chêne rustique, plus conforme. On commença à les saluer, discrètement, sans paroles, d'un hochement de tête, d'un index pointé vers la casquette.
Le premier bonjour fut prononcé par Anselme à une sortie de messe. On avait cru ces horsains enjuivés ou mahométans, on les découvrait chrétiens avec soulagement. Et la précision qu'obtint l'abbé - Madame Lecerf était chrétienne maronite - ne parvint pas à gâcher l'impression favorable suscitée par leur présence au rite communautaire. Anselme se permit même un jeu de mots qui fit le tour des fermes : elle saura bin tirer les marrons du feu !
Les Lecerf se sentirent intégrés puisqu'on les entretint bientôt de la météorologie : biau temps pou' les canards. Est qu'un grain, ça va passer. Le diable marie sa fille. Est à cause d'la lune. Le vent souffle de la mer, est une marée de 115.
L'automne passa. On entra dans l'hiver. Les journées semblèrent plus longues à Betsabée, qui, n'ayant pas d'emploi, était seule de longues heures. Elle tardait à s'habiller, écoutait beaucoup de musique, pour cultiver le souvenir de son pays natal (et couvrir le bruit de l'horloge, qui la déprimait). Elle espérait vaguement un incident qui viendrait interrompre la monotonie de sa solitude frileuse.
L'événement se produisit un matin de neige, alors que David venait de partir. La nuit était encore épaisse, et l'isolement, accentué par le silence, paraissait plus terrible. Un camion stoppa sur la place. L'homme qui en descendit fonça sans hésiter sur la maison des Lecerf. Il ouvrit la porte à la volée, et, avant même d'avoir atteint le bar, commanda : un grand noir ! Bethsabée préparait justement son café matinal. Elle servit l'homme qui, tout à son affaire, ne remarqua pas la tenue de son hôtesse. Il but, demanda : un autre, puis chercha des yeux un cendrier pour y déposer le mégot de la cigarette fumée entre les deux tasses. Quelque chose, dans l'ameublement, dut l'avertir qu'il s'était fourvoyé. Pris d'un doute, soudain intimidé, il questionna, d'une voix qui avait perdu toute autorité : j'suis pas dans un troquet ? Betsabée avoua, qu'en effet, il n'était pas. Il remarqua enfin la robe de chambre de son hôtesse, bafouilla des excuses, demanda combien il devait. Bethsabée, mise en joie éclata de rire : vous ne me devez rien, je ne suis pas commerçante. Lui hésitait entre rire avec la femme (qu'il trouva bien jolie dans ce vêtement de satin blanc) et se montrer froissé, insister pour payer ses deux cafés. Il s'en tira par un compliment : je m'disais bien que l'jus était particulièrement bon. Il ajouta, croyant expliquer sa méprise : j'viens de Rouen. Bethsabée ne put résister à l'inévitable réplique : et moi de Damas.
Il revint, ne pouvant supporter sa défaite. Lui qui avait cru épater une villageoise en évoquant la capitale normande, il se sentait ridicule devant cette femme qui avait connu des cieux si différents. Quand il reparut, deux semaines après sa méprise, le printemps faisait une timide incursion en pays cauchois. Des crocus poussaient leurs têtes audacieuses dans les jardins et les forsythias osaient quelques taches jaunes sur les branches dénudées. Le routier vint avec un bouquet de mimosa, pour présenter ses excuses. Il but trois cafés, assis à une table et non plus debout contre le bar.
Comme tout cela était fort innocent, les deux protagonistes ne songèrent ni à se cacher ni à se taire. Le camion resta bien en vue au cœur de la place le temps de cette visite courtoise, que Bethsabée raconta au curé (lequel avait pris l'habitude de venir boire, lui aussi, vers 15 heures, du thé à la menthe, sous couvert de parfaire son éducation religieuse). Et le routier évoqua cette histoire plaisante dans les fermes où il livrait du matériel agricole. Tout le village fut donc au courant. Tout le village sauf David.
Il avait quelques soucis avec ses élèves, et Bethsabée ne trouva aucun moment propice pour raconter ni la méprise ni la visite d'excuses (à dire vrai, les moments propices, qui auraient pu être ceux des repas, n'existaient plus car David préférer écouter la télévision plutôt que son épouse ; Bethsabée avait bien essayé de lutter contre ce parasite de leurs conversations, mais, découragée par quelques chut intempestifs, elle s'était lassée, mangeai en silence, assez triste, vaguement rancunière). Elle n'évoqua pas non plus ses séances de catéchèse avec le curé, pour les mêmes raisons. Et David ne posa pas les questions qui auraient pu susciter les confidences de son épouse, car il tenait pour acquis que la Femme doit être au service de l'Homme, et que Bethsabée, aidée dans ce service par tous les appareils ménagers qu'il lui avait offerts, était une femme heureuse.
Au bout d'un mois, le routier amena un copain, offrant, pour faire durer la plaisanterie, un tableau noir où écrire le tarif des consommations. David était absent, parti accompagner des élèves en voyage scolaire.
Ce fut cette même semaine que le père Anselme maria sa petite-fille. Il était un peu vexé de s'être fait griller la politesse par le curé et un gars pas d'cheu nous alors que c'était lui qui, le premier avait salué la p'tite dame du professeur. Logiquement, il aurait dû être le premier à franchir le seuil de la maison des Lecerf (d'autant, se souvenait-il avec nostalgie, qu'il avait souvent bu dans cet endroit, du temps que c'était un café). Le vieux décida d'un coup d'état, ce jour des noces familiales. Le temps froid servit son audace. Tandis que les invités piétinaient dans l'attente du photographe, Anselme traversa la place, entra chez Bethsabée en claironnant : fait frisquet ; c'est pas une température à mettre un chrétien dehors. Bethsabée opina. Son visiteur tira une bouteille de calvados de sous son gilet et la tendit, glorieux : c'est du vrai ; qu'a pas été mouillé et qu'a pas vu l' gendarme ! Bethsabée sortit deux verres. Anselme servit, avec des gestes emprunts de respect : m'en direz des nouvelles... Ils humèrent le beau liquide blond, qui sentait si fort la pomme. La pièce en fut toute parfumée, comme si l'esprit du pays de Caux prenait possession des lieux.
Ils se taisaient, troublés de se sentir au cœur d'un mystère initiatique. Bethsabée frissonna, comme si un fantôme lui avait effleuré l'épaule. Anselme, interprétant probablement ce frisson, suggéra de faire une p'tite flambée. Betsabée avoua son incompétence : ses feux s'éteignaient toujours. Anselme lui fit une démonstration commentée : d'abord, le journal de la veille, bien froissé - mais pas trop serré - des boîtes de camembert, en bois de peuplier, qu'est l'plus tendre, et puis la bourrée de fagots. Enfin, au-d'sus du p'tit bois, la bûche ; le pommier, c'est c'qu'y a d'meilleur.
Bethsabée contempla le miracle de ce feu qui ne s'étouffait pas, poussait de hautes flammes bien droites. Dans un souci d'équité, prise d'une inspiration, elle fila au grenier, en revint avec un narguilé. Moi aussi, je vais vous apprendre quelque chose.
La leçon faillit ne pas avoir lieu car la noce, enfin photographiée, se précipitait vers les voitures, commençait d'user des avertisseurs pour rameuter l' pépé qu'on soupçonnait d'être parti uriner contre une haie. Anselme, chauffé par le feu et le calva, n'avait pas envie de retourner dans le froid. Il marmonna, comme pour lui, sans regarder son hôtesse : dans l' temps, après la messe, toute la noce trinquait au café.
Bethsabée comprit l'allusion. Elle invita les mariés, leurs familles, son cher curé. On manqua de sièges. Bethsabée entraîna trois costauds au grenier. Les fauteuils syriens (dont les damasquinages éblouirent un neveu d'Anselme, ébéniste) et les poufs de cuir, les tapis réapparurent. On but, on fuma, les parfums d'Orient mêlés aux senteurs de pomme. Le garçon d'honneur, émoustillé de bientôt fourrager les jupes de la mariée pour en détacher la jarretière, réclama d' la musique de danse du ventre. Mais Anselme jugea qu'il était temps d'aller déjeuner, ajoutant : la musique ce s'ra pour d'main, au r'tour des noces. Et il cligna de l'œil vers leur hôtesse, certain qu'elle comprendrait cette nouvelle allusion.
Bethsabée comprit si bien que, l lendemain, quand la noce se présenta de nouveau chez elle, c'était l'Orient dans sa maison ; Elle avait ajouté des tentures, des lampes ouvragées en cuivre. De l'encens brûlait sur les tables et le bar. Oum-Kalsoum donnait de la voix sur la chaîne hi-fi. Et l'hôtesse était méconnaissable, revêtue d'une splendide tunique où brillaient des fils d'or, ses petits pieds dans des babouches, ses cheveux mêlés de bijoux filigranés, ses yeux soulignés de khöl . elle ressemblait plus à quelque houri de conte persan qu'à une habitante de Gueuseville-la-bourbeuse fin XX° siècle. Son succès fut énorme, et la fête commença par une ovation tonitruante.
Pendant ce temps, l'époux de la houri et sa classe rentraient de leur séjour linguistique. Les élèves fatigués, avaient dormi dans le train, et David s'était laissé aller à une somnolence rêveuse, doucement mélancolique, ce bref voyage lui ayant remis en mémoire ses anciennes lectures de jeunesse, ses vieux fantasmes et quelques souvenirs de ruelles obscures, de jardins lumineux, de femmes voilées, de chaleur, de poussière. Il croyait entendre la voix d'un muezzin appelant à la prière depuis le minaret d'une mosquée. Ce n'était que le contrôleur de la S.N.C.F. annonçant dans le haut-parleur du wagon : Yvetot, une minute d'arrêt.
Il fallut se secouer, saisir vêtements et bagages, sauter sur le quai froid où les familles des élèves attendaient.
David retrouva sa voiture devant la gare, là où il l'avait garée une semaine plus tôt. Il quitta le gros bourg, roula jusqu'à son village. Là, il se crut encore la proie d'une hallucination auditive car de la musique malouf semblait emplir la place sombre où s'érigeait sa maison. Il poussa la porte de l'ancien café, et s'arrêta saisi de surprise, lâchant sa valise : sur trois poufs alignés, une odalisque vêtue de blanc et d'or, sensuellement abandonnée, fumait un narguilé.
Il ne vit qu'elle, au cœur de la foule, au centre d'un brouillard d'encens parfumé à l'eucalyptus. Le silence se fit parmi les noceux cauchois, et on put entendre David crier, transi d'amour : Aziyadé !
Cette mésaventure d'un routier égaré dans ce qui avait été un bar-restaurant et auquel la nouvelle propriétaire servit un café sans se démonter (pour la plus grande gêne de l'intrus quand il prit conscience de son erreur) me fut contée par la protagoniste elle-même (qui ne revit jamais ce client !). Mais j'ai beaucoup extrapolé à partir de cet incident, pour la plus grande joie du couple habitant cette maison, qui termine souvent les repas amicaux en faisant lecture de la nouvelle à ses invités. Détail troublant : j'avais prêté au mari de Bethsabée d'apprécier Pierre Loti, or, j'appris ensuite que le mari de l'aimable personne m'ayant conté l'épisode du routier goûtait effectivement beaucoup cet auteur !
Il m'est arrivé, certains étés, d'habiter cette maison, aimablement prêtée par leurs propriétaires quand ils partaient en vacances plus au sud. Je pensais pouvoir y écrire. Ce ne fut par toujours possible :
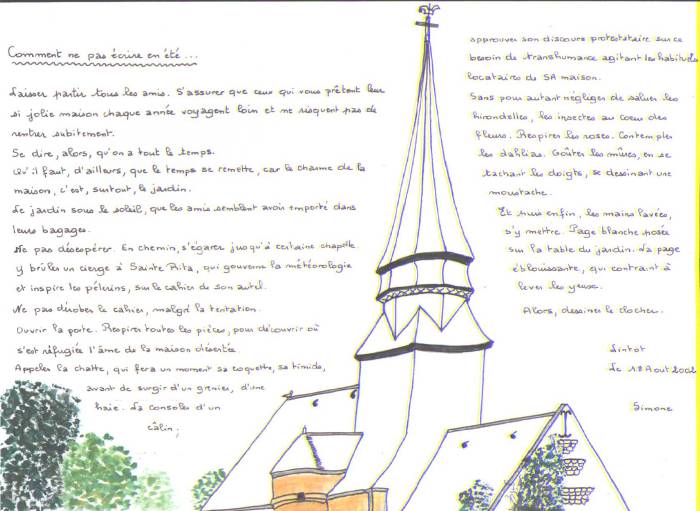
Dans cette Méprise, j'évoquais Loti. Mais, à tout seigneur tout honneur, voici qu'il est question du plus célèbre des écrivains normands :
Pèlerinage
J'avais connu l'éminent universitaire lors d'un congrès de flaubertistes à Detroit, et c'était étrange d'aller l'attendre en gare de Rouen quelques mois plus tard. Allions-nous seulement nous reconnaître ? Aux Etats-Unis, nous n'avions jamais été en tête-à-tête mais généralement séparés par un espace empli de tables, chaises, ordinateurs sophistiqués et professeurs émérites. Je n'étais pour ma part qu'une très modeste traductrice, chargée d'accompagner ces messieurs (12) et dames (3) dans leur tournée américaine. J'avais été choisie pour mes compétences, mais aussi - m'avait-on précisé à voix basse derrière une porte - pour mes qualités de diplomate souriante. Je m'étais assez bien tirée de ce double rôle, et j'avais reçu, après coup, une lettre d'un professeur particulièrement satisfait. J'avoue que j'ignorais lequel - c'est à dire : à quelle tête attribuer l'épistole et la signature. Mais le verbe était séducteur, l'écriture agréable, le papier de qualité, et il s'en était suivi une correspondance régulière, où l'ermite de Croisset occupait la place centrale. De là cette étrange prière de Michel Savigny : « Emmenez-moi à Ry. »
Il débarquait au train de 11h02, et je comptais sur sa mémoire pour que nous nous identifions puisque la mienne était défaillante. J'espérais seulement que ce Michel Savigny ne serait pas le doyen du groupe que j'avais chaperonné, car la moyenne d'âge était élevée. Je vis venir vers moi un bel homme, mince, grand, le cheveu abondant. Comment avais-je pu ne pas le remarquer, à Detroit ? Je me posais la question alors qu'il m'embrassait, quatre fois, ses deux mains sur mes épaules. Cette familiarité chaleureuse acheva de me déconcerter, et, tandis que nous sortions de la gare pour rejoindre ma voiture au parking, je le regardais en coulisses, mes yeux apparemment dans la direction de mes pas, mes deux pupilles désolidarisées pour ne voir que lui, à la recherche du détail qui me permettrait de faire coïncider les souvenirs flous de Detroit avec le moment présent.
Nous étions déjà à Martainville quand, enfin, je compris. C'était une question de tenue. En Amérique toute la palanquée d'universitaires avait joué la carte vieille France, costume cravate pour les messieurs, tailleurs classiques pour les dames. J'avais dû singulièrement trancher avec mes mini-jupes. Mais, sur nos terres, l'équilibre était rétabli : Michel Savigny portait un pantalon de lin clair, une chemise à impressions géométriques et col ouvert, des sandalettes monastiques laissant voir ses pieds, de manière indécente me sembla-t-il. Il cachait ses yeux derrière des Ray-Ban. J'étais dans une robe qui ne permettait d'apercevoir ni mes seins quand je me penchais, ni ma petite culotte quand je m'asseyais. Il s'était modernisé et je m'étais assagie : nous étions au diapason. Surtout concernant Haëndel.
Dans la dernière descente avant Ry je me demandais à quel moment la conversation avait pris ce tour musical inattendu. Là aussi je m'étais dédoublée, tenant à voix haute le discours qu'il fallait, sans y porter attention, en me racontant, mezza-voce, avec beaucoup d'acuité, une romance que n'auraient désavouée ni Barbara Cartland pour le premier chapitre, ni un producteur de films classés X pour le dernier. Finalement, j'avais peut-être eu tort de ne pas être en mini-jupe, même si mon hôte s'était, dès la gare de Rouen, extasié : « Vous êtes toujours aussi ravissante ! » L'équipée ne tenait pas le genre initialement prévu. D'autant que, sous la pancarte marquant l'entrée du village, il y en avait une autre, pour annoncer le tournage d'un télé-film anglais et l'interdiction de stationner devant les halles. Il était également impossible de se garer dans la cour du restaurant L'Hirondelle, car elle était occupée par la cantine-vestiaire-maquillage des Britanniques : trois tentes et deux camions. Il ne restait que la rue sans ombre, ou les abords de la Maison de l'Abreuvoir, sous les arbres, près du Crevon.
C'est là que je choisis de m'arrêter. Nous nous penchâmes un moment sur l'eau gazouillante et fraîche, dont l'exceptionnelle canicule de ce mois d'août exacerbait les parfums. Ah, dit Michel Savigny, passant un bras autour de mes épaules, c'est toute mon enfance que vous me rendez là : je suis né au bord d'une rivière. Troublée par les doigts posés sur ma bretelle de soutien-gorge, je demandais le nom de cette rivière. Et je le fis répéter car il parut tout à fait étranger à mes oreilles expertes de traductrice. Michel Savigny précisa que cette eau de mémoire coulait en Lituanie, pays de sa mère. Et il ajouta : « Faites-moi plaisir, appelez-moi Michka, c'est le nom dont elle me berçait. » J'eus du mal à réprimer un rire, qui eut été incongru à cette minute sentimentale, car Michka était le nom de mon premier ours en peluche.
Mon visiteur ôta son bras de mon épaule quand nous sortîmes de l'ombre protectrice du feuillage. Nous marchâmes en silence jusqu'à L'Hirondelle. Le menu n'était pas plus normand que Lituanien, mais du sud-ouest, chargé en calories. Nous fîmes précéder de vodka et suivre de calvados. Entre les deux, nous rîmes beaucoup, relevant le carré de guipure avoisinant notre table, pour voir passer, à intervalles réguliers, les acteurs et figurants se dirigeant vers les halles. Le patron avait proposé de nous ouvrir la fenêtre, mais nous avions refusé : « C'est plus amusant de soulever le rideau, comme des concierges. »
Il semblait que nous fussions devenus très intimes, Michka et moi, car il m'avait demandé si j'étais une femme fidèle. J'avais réfléchi un moment avant de répondre : « Uniquement fidèle à l'étymologie. » Et j'ajoutais, à l'appui, tenant toujours mon verre : « Savez-vous d'où vient le mot calvados ? » Il avoua son ignorance et me pria de l'instruire, hypocritement, car il était évident que ses pensées n'étaient pas spécialement tournées vers la linguistique. Je précisais donc : « El Calvador était un navire de guerre espagnol, faisant partie de cette invincible Armada devant conquérir l'Angleterre. Mais la tempête eut raison du bâtiment, qui vint s'échouer sur la côte normande ; le lieu du naufrage, puis la région, prirent le nom du bateau naufragé, bientôt déformé par l'usage. » Il y eut un silence, que je ne sus comment interpréter, car le regard de mon interlocuteur gardait ce flou d'après boire. Il reprit enfin : « Vous oubliez l'essentiel, chère traductrice : que signifie El Calvador ? » Je répondis : « Le démâteur. » Michel Savigny partit d'un grand rire. J'allais en demander la raison quand mon attention fut attirée par une silhouette féminine passant dans la rue. Elle était vêtue à l'ancienne, comme tous les figurants que nous avions vu passer durant ce long déjeuner, mais sa robe était défraîchie, d'une couleur devenue indéfinissable - entre le marine, le noir, le brun, le violet - la plume de sa capeline était cassée, et la maquilleuse avait dû forcer la dose car le teint de cette femme était également d'une couleur incertaine, entre le blanc de céruse et le jaune bileux. Mais ce qui avait suscité mon étonnement, bien avant que je ne remarque ces détails, c'était le mouvement de cette silhouette, de l'autre côté du rideau. Alors que toute la troupe s'était acheminée, par grappes, d'un pas assuré, vers les halles, elle semblait hésiter dans la direction à suivre. Elle s'était finalement arrêtée, et son regard paraissait fixé sur le nom de l'établissement où Michel Savigny, profitant galamment de ma distraction, réglait la note.
Nous sortîmes. La femme était toujours immobile, comme frappée de stupeur. Nous passâmes près d'elle sans qu'elle parût nous voir, et je constatais alors que ses bottines et l'ourlet de sa robe étaient raides d'une boue ancienne, qui avait séché. Michka se pencha vers moi pour murmurer : « Elle n'est pas raccord, la costumière va se faire virer. » Je ne répondis pas. Il buta contre une jardinière de l'autre établissement - Le Bovary - concluant : « Le calvados m'a complètement démâté. » Mais je n'avais plus envie de plaisanter, la figurante hâve avait cassé ma gaieté.
Nous arrêtâmes notre promenade pédestre un moment devant les halles. Il ne s'y passait rien. Les figurants patientaient entre les volailles mortes et les rasières de pommes. Quelques portables sonnaient. Et des ordres, en anglais, traversaient les conversations françaises. Je proposais de monter jusqu'à l'église, pour admirer le célèbre porche. Nous en détaillâmes les sculptures avant de pousser la porte, qui grinça terriblement. Michka en profita pour se pencher une nouvelle fois vers mon oreille, murmurant : « Nous allons réveiller des fantômes ». Je le fis taire d'un coup de coude dans l'estomac, car nous n'étions pas seuls : la figurante qui m'avait intriguée était à genoux, visiblement absorbée par une ardente prière, près d'un cierge juste allumé. J'allais rebrousser chemin quand elle se retourna et nous dit : « Cette porte grince toujours autant. Le bedeau n'a donc pas d'huile ? » Je ne sus que répondre, et mon linguiste démâté paraissant aussi perplexe que moi, nous restâmes cois. La femme se releva et demanda : « Pourquoi ne répondez-vous pas ? » Je précisais que nous ne savions pas si le bedeau avait de l'huile. Et Savigny ajouta : « Nous ignorons même s'il y a un bedeau. » La femme tapa du pied et haussa le ton : « Non, ce n'est pas que vous ne savez pas. C'est que personne, jamais, ne répond à mes questions, quelles qu'innocentes qu'elles soient. » Profondément troublée par cette colère brusque, je ne trouvais aucun argument. Michka crut s'en tirer en annonçant platement : « Nous ne sommes pas d'ici. » Elle répliqua, de plus en plus enflammée : « Si vous n'êtes pas d'ici, vous êtes d'ailleurs. » Savigny me souffla : « Nous sommes tombés sur Madame de La Palice », mais la femme ajouta : « Moi, je ne suis de nulle part. » Entendant cela je ne doutais plus de ce que j'avais seulement supposé l'heure d'avant : cette malheureuse n'avait plus toute sa tête. Je ne pouvais cependant mettre un nom sur la forme particulière de son trouble mental car je n'avais aucune connaissance médicale. Par compassion (et pour retarder l'instant où mon compagnon me pousserait dans le confessionnal ainsi qu'il m'en avait menacée sur le parvis), je voulus poursuivre cette curieuse conversation, interrogeant : « Vous n'êtes pas du tournage ? » Elle secoua la tête, négativement, puis ajouta, dans un soupir : « Moi, je réponds toujours aux questions. » Je proposais : « Trouvez-en d'autres, je saurai peut-être mieux vous renseigner que pour l'huile du bedeau. » Elle poussa un nouveau soupir, de contentement cette fois, et se rassit, m'invitant à faire de même auprès d'elle. Savigny, vexé de se sentir abandonné, entreprit d'inspecter méthodiquement chaque statue, dans un silence de fin connaisseur. Quand je fus installée à côté de l'inconnue, elle me demanda : « L'hirondelle passe-t-elle encore ? Qui a détruit le héron ? » Je restais sans voix, trop peu sûre de mes connaissances ornithologiques. L'amateur de statuaire pieux s'approcha de nous mi-curieux, mi-facétieux, et dit : « Flaubertiste distinguée, qui connaissez les noms de la diligence et du château disparu, je vous salue. A qui ai-je l'honneur ? Madame Bovary, sans doute ? » Le visage de mon interlocutrice, qui avait légèrement rosi en me parlant, redevint blême quand elle répondit : « J'ignore ce qu'est une flaubertiste, distinguée ou non, et vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre car je ne m'appelle pas Bouvari. » Elle abandonna le fâcheux pour m'interroger de nouveau : « Pourquoi la ferme a-t-elle été transformée en auberge ? Qu'est devenue la pharmacie ? Où ont-ils transporté les morts ? » Je prétendis que les commerces changeaient souvent, et que les cimetières n'étaient plus autour des églises, mais exilés aux frontières des villages, ajoutant même que la foi se perdait et que les concessions à perpétuité n'existaient plus, faute de place. J'étais assez contente des banalités que je dévidais, mais l'inconnue m'interrompit brutalement : « C'est bien ce que je disais : vous ne répondez pas à mes questions. Je vais devoir rentrer. Et pourtant je déteste être seule. » Elle se leva, quitta le banc. Je la suivis car ses dernières paroles me rappelaient un conte de mon enfance. L'inconnue était-elle victime d'un enchantement ? Quelle réponse la délivrerait du sortilège, interromprait sa solitude ? Et, d'abord : où rentrait-elle ? En quel château hanté ? Ou - plus vraisemblablement - en quel asile psychiatrique ?
Elle sortit de l'église, tourna à droite du porche, se dirigeant vers l'unique pierre tombale de la pelouse. J'hésitais à m'approcher, craignant d'interrompre une visite à un défunt, mais l'inconnue ne s'immobilisa pas devant la pierre. Elle s'enfonça dans la terre, et y disparut comme s'il s'agissait de sables mouvants. Ce fut si rapide que je crus avoir rêvé. Je courus vers le carré d'herbe où elle n'était plus. Il n'y avait aucune trace de son passage. Je lus à vois haute le nom gravé sur la pierre : « Delphine Delamare », et j'entendis, derrière moi, Michel Savigny me dire : « Ma chère, il est probable que nous avons trop bu. »









Jardin sous la neige*
C'était un vieux projet. Pas même. Seulement un souhait, une rêverie vague. De ces pensées tournées vers un futur improbable, et qui tiennent chaud l'hiver.
L'hiver, justement : il commençait, de manière brutale, après un automne indulgent qui n'avait pas permis d'oublier le bonheur de l'été. Premiers flocons blancs sur le jardin, où pourrissaient les feuilles tombées du tilleul. Un jardin que je quitterais avant le printemps, pourquoi m'en serais-je encore occupée ? J'avais tant planté, biné, sarclé, tondu, taillé, cueilli, toutes ces années d'espérance. J'avais si avidement guetté les fleurs, les fruits : crocus défiant le froid, dès janvier, en flammes safran sur la terre nue ; jonquilles, narcisses, tulipes affirmant tous, de leurs tiges raides, qu'ils ne craignaient pas les giboulées de mars ; promesses des pommes sur les arbres nains, à l'apparition des iris altiers, des pivoines affaissées ; fougères dépliant ses crosses élégantes tandis que rougissaient les grappes de groseilles, les framboises ; parfum voluptueux du chèvrefeuille, en été ; abondance des roses, entêtées jusqu'en décembre où elles n'osaient plus ouvrir leurs boutons devenus frileux. J'avais eu de si jolies surprises parfois : éclat de pavots, que je n'avais pas semés , morille solitaire sur une pelouse, que ma tondeuse avait épargnée de justesse, et les neuf coprins surgis dans la rocaille, au bord de la lavande, le jour de ma fête. Sans oublier les visiteurs faunesques : lucanes du premier été, en vols lourds excitant le chat, les trois pies chassant à l'aube, les merles, grives, rouge-gorge se disputant les lombrics que mon jardinage leur découvrait, pigeons ramiers nous visitant le soir, tandis que nous dînions sous l'if, troglodyte furtif aventuré dans le houx, picorant la margarine déposée dans le nichoir du forsythia, volée de moineaux répondant à mes volées de graines ; et les matous du voisinage poussant leur tête curieuse sur les toits des appentis, la crête d'un mur, traversant à pattes précautionneuses ce territoire étranger. Tous ces passants m'avaient remis en mémoire, un matin que je découvrais, entre des herbes froissées, les plumes d'un meurtre nocturne, cette phrase de Tchekhov : « Il est difficile d'aimer à la fois les cerises, les merles et les chats. »
J'étais donc là, devant la fenêtre, mes deux mains posées sur le radiateur, regardant le jardin en deuil. Comme arrêtée de vivre, la pensée suspendue. Et le souhait, la rêverie vague, le vieux projet se glissa dans ce blanc, cette parenthèse, ce vide, cette vacuité : passer Noël, ce moment haïssable, dans un pays non chrétien. Pour éviter tout ce qui, en bloc, m'était de très longue date, insupportable : le p'tit Jésus, le vieux bonhomme aux rennes, les sapins massacrés, par forêts entières, mêlant leurs cadavres à ceux des gibiers pendus aux crocs des bouchers, les cadeaux, les bougies, l'indigestion de chocolats, la niaiserie, la fièvre, la joie sur commande, l'hystérie collective, etc. ET CAETERA : je le dis à voix haute. Je me sentis prise en faute. Ce n'était pas la première fois que je me surprenais à soliloquer. C'était même devenu une habitude, une manière de peupler les absences de mon compagnon, un hommage, peut-être, à ma mère, morte quelques mois auparavant, et qui avait tenu beaucoup de discours à ses murs durant sa maladie. Etais-je sa réplique, son fantôme ? Je soupirais sur la question (tacite : et caetera me rendait prudente). Le chat remua la queue, pour entamer le dialogue. Il était, depuis seize ans, un auditoire d'élite. Je quémandais son approbation : « Si, déjà, je radote, il est temps de bouger, avant d'être également impotente. » Il approuva, du même mouvement. J'ajoutais, un ton en dessous : « Tu iras chez tante Anna. » Il parut retourner à son sommeil, désapprobateur. Je me montrais obséquieuse, tout à fait lâche : « Elle te cuira des truites, te mitonnera des foies de volailles. » Sans doute, me dirent ses oreilles soudain pointées, mais je m'ennuierai, frémit sa moustache.
Il restait à choisir la destination. J'éliminais le Tibet, entre la fenêtre du salon et la porte de la cuisine. Trop loin. Et l'Egypte, en me dirigeant vers la poubelle. La malédiction des pharaons pesait sur Hatshepsout, qui ne voulait plus être dérangée dans son éternité de momie. Je fouillais les ordures, à la recherche d'un de ces dépliants publicitaires engorgeant régulièrement ma boîte aux lettres. Je retrouvais ses pages hautement colorées entre du marc de café et des coquilles d'œufs. Il était parfumé, gluant, mais demeurait lisible. Je le défroissais sur le marbre de la table, près du rouleau à pâtisserie ayant appartenu à mon père. Une semaine en Tunisie. Pas de barbus, pas de voiles, et prix spécial en fin d'année. Hôtel trois étoiles avec piscine. Visite de Carthage en option. C'est l'option qui me décida. Les guerres puniques, Hannibal et ses éléphants, Regulus et sa promesse imbécile, Salammbô (l'héroïne de Gustave, pas le gâteau de mon enfance)...
Les flocons tombaient drus quand je traversais le cimetière monumental, où Flaubert dormait plus tranquille qu'Hatshepsout. Je saluais sa dalle, l'informant de ma destination, puis sa statue, place des Carmes, près de l'agence de voyage. Le vieil écrivain semblait porter une toque d'astrakan blanc et des épaulettes de général russe. Il demeurait stoïque à côté du jeu de boules déserté, de la terrasse vide, où, l'été, pépiaient les moineaux et les touristes.
Touriste à mon tour je suis. Sans mon compagnon que boisson en supplément a découragé. J'ai pris l'avion, mangé des briks à l'œuf, bu l'eau de la piscine, écrit une carte postale à mon chat. J'ai visité Carthage. De jour évidemment. Mais j'y retourne cette nuit, sans groupe de joyeux drilles ni guide trilingue. Je fuis les trois étoiles de l'hôtel pour la lune sur les ruines. Je suis une incurable romantique. Mal informée sur la mondialisation des rites occidentaux. Bien fait pour toi, dirait mon compagnon, t'as qu'à écouter un peu plus la radio et regarder la télé au lieu d'être toujours le nez dans tes bouquins. Les joyeux drilles et le guide trilingue réveillonnent et cotillonnent (pardon Flaubert pour le néologisme), confettis et falbalas, dans des canards, etc. ET CAETERA. Je regrette la maison, le jardin sous la neige, mon chat sous la couette. Il aurait suffi de fermer les volets, de dormir avec des boules Quies. Je m'engueule vertement, punie, et buttant sur les pierres vénérables. Carthago delenda est : la vieille malédiction me remonte aux lèvres. De qui donc était-ce ? Consulter un dictionnaire avant de dormir. S ‘il y en a dans cet hôtel d'Hamilcar, où je n'ai vu traîner que des magazines emplis des princesses et des romans de Barbara Cartland, oubliés par les fournées précédentes. Caton, me répond une voix inconnue. De surprise, j'en ai l'invective tarie. Je ne serais pas seule ? Un autre romantique ? Un fiancé qui se découvre, profitant de l'obscurité de ma solitude hardie ? Je me pétrifie, colonne parmi les colonnes. J'attends que la voix devienne une ombre. Rien. Personne. J'ai rêvé. Un bourdonnement d'oreille dû à ma colère. Caton d'Adrénaline. Je pouffe. La voix reprend : « Caton l'Ancien, né à Tusculum en 234 avant J.C., mort en 149. » Le texte laconique sent son dictionnaire, indubitable. Mon ami Adrien, incollable sur les dates ? Hypothèse ridicule : Adrien est à Alexandrie. Je plaisante, je plaisante, je fais la fière, mais je perds de mon assurance, car la voix a pris corps à présent. Une ombre a petit bedon. Mon compagnon, finalement venu me rejoindre, surveiller traîtreusement ma fidélité ? J'aurais reconnu son timbre, il n'y a pas dix jours que nous sommes séparés. Je dois me rendre à l'évidence : si la silhouette m'est familière, la voix me demeure inconnue. Je me réfugie dans le souvenir d'un Manuel des bons usages, à l'intention des jeunes filles, et prie le mystérieux promeneur de décliner son identité, ses titres, les raisons de sa présence en ces lieux, à cette heure indue. J'entends un soupir. Et la voix reprend : « C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. » Me voici tranquillisée : un érudit capable de citer la première phrase de Salammbô ne saurait être sur mes talons pour me violer dans l'inconfort d'un camp de ruines, m'égorger comme le mouton d'Aït-el-Kébir. Je décide de me présenter la première, entorse au manuel : « Valentine Marino, étudiante prolongée. A qui ai-je l'honneur ? » L'homme ne répond pas, il fouille ses poches, en tire un objet. Révolver ? Poignard ? Je tremble. Il demande : « Puis-je tirer sur ma bouffarde sans vous incommoder ? » Je consens. L'inconnu s'assoit sur une pierre, près de ma colonne. Il poursuit : « Vous devez fatiguer, debout derrière votre pilier. Venez donc près de moi mon enfant. » Aïe. Après Salammbô, le Petit Chaperon Rouge. Pas de doute : je suis en compagnie d'un universitaire préparant une thèse originale pour les éditions de l'Harmattan. Je m'apprivoise et consens à quitter mon refuge précaire. J'étais au bord de la crampe.
Nous regardons la lune, les étoiles. Entre deux crachotements dans sa pipe, il me cite les constellations. Sa préférence va à Cassiopée, dont il me rappelle succinctement la légende : reine d'Ethiopie, mère d'Andromède, elle monta au ciel après sa mort. Un condensé de la reine de Saba et de la Vierge Marie en quelque sorte. Le temps s'écoule doucement, dans le parfum du tabac. Quelle paix sur la Terre. Une vraie nuit de Noël. L'aube va bientôt paraître, et, de concert, nous versons dans la mélancolie. J'évoque mon jardin d'Europe, que j'aimais tant surprendre à ce moment où il basculait de l'obscurité à la lumière. Moi aussi, dit l'étrange bonhomme, ajoutant : « Je me souviens particulièrement d'une nuit de gel blanc, avec George. Ce devait être en novembre 66. » Je crois bon de préciser, soudain coquette : « L'année de ma naissance. » L'homme rit brusquement, à s'en étouffer, incrédule : « Vous m'étonnez. » Je suis piquée au vif, vexée d'être prise en flagrant délit de mensonge. Je me suis rajeunie, et alors ? C'est seulement trahir une volonté de séduction mal récompensée. Le ciel s'est éclairci et je vais enfin voir les traits de l'inconnu. Mais il se lève, semble vouloir me quitter. Va-t-il me jouer une nouvelle version de Gradiva, ce chef-d'œuvre de Jensen où le fantôme d'une jeune fille traverse les ruines de Pompéi. Je lance mes deux mains vers lui, pour le saisir par son gilet. Ce goujat aura un visage dont me souvenir, ou je ne m'appelle plus Valentine Marino. Il s'immobilise, et, d'une voix brutalement changée, comme prêt à débonder dans les larmes, il termine : « 1866. C'était à Croisset, faubourg de Rouen, dans le jardin de ma mère. »


Flaubert fut donc un de ces fantômes circulant dans mes nouvelles. Je ne suis jamais allée à Carthage, mais j'ai vécu dans le jardin rouennais qui ouvre la nouvelle, et j'ai visité celui de Croisset, si proche, où une colonne carthaginoise voisine le pavillon de l'ancienne maison, détruite, qui fut celle de Flaubert, et où il reçut Georges Sand (voir le texte En visite à Croisset dans la rubrique Seine en scènes)
La neige, encore :
Le Petit bois*
Le froid a reculé, le bonhomme de neige, qui a dû se pétrifier en glace au bord du bois, va lentement fondre. Nous nous étions demandés pourquoi les enfants étaient allés le construire à l'abri de ce bosquet, où il demeurait invisible de nos fenêtres. Chaque année ils en édifiaient un sur la pelouse centrale, où cette statue précaire semblait exercer une royauté provisoire sur le lotissement. Elle n'avait pas toujours les mêmes dimensions, ni les mêmes attributs, mais ce qui était identique, c'était le plaisir des enfants, leur excitation joyeuse, leurs rires fracassant le silence. Les enfants ne paraissaient pas sentir le froid, échevelés, leurs visages rougis, ayant perdu bonnets de lutin et foulards laineux dont les mères les avaient emprisonnés. Parfois, l'une d'elles s'aventurait à participer au jeu, que sa présence infléchissait, dérangeait bientôt. Derrière mon rideau je maudissais l'intruse, qui prétendait régenter la création spontanée. Que s'égarait-elle ainsi, à régresser, retourner dans un monde dont elle n'était plus ? N'était-ce donc pas suffisant d'avoir reproduit, continué le fil des générations ? Que voulait-elle encore gouverner le petit dont le cordon avait été tranché ? Je savais toujours lequel de la troupe était le sien, elle lui remettait bonnet, gants, cache-nez. Et le petit, qui avait été si heureux de voir surgir sa reine, le petit, de nouveau emmailloté, perdait goût à l'édification. Ses gestes devenaient plus lents. Il s'immobilisait finalement. Il avait froid. La reine le rentrait. Elle avait gagné, le ramenant au cocon, au ventre de la maison. Il était à elle, encore à elle, tandis que les autres, un moment, n'étaient qu'entre eux, sans leurs géniteurs que la neige décourageait de paraître, ou que leurs activités d'adultes appelaient ailleurs.
Moi je ne suis pas active. Je n'ai pas d'emploi. J'attends seulement que mon mari rentre du sien, quotidiennement. Moi je ne suis pas frileuse. J'aurais donc pu, chaque année, m'associer au jeu. Mais je craignais les mères. Dans cette partie, j'aurais été le joker, la carte unique, le fou à grelots. Je sais bien ce qu'on dit. Ou, plutôt : ce qu'on ne dit pas, mais qui est dans les regards, dans les silences interrompant brutalement les conversations codifiées. e pauvre madame Rouvière, qui n'a ni enfant, ni travail. Cette malheureuse étrangère dont le père fut un ennemi des nôtres. Tant de culpabilités la rendent triste et solitaire, il faut comprendre... Les imbéciles ! Je ne leur ai jamais rien lâché de ma joie à être stérile, du bonheur de ma vacuité, et du chagrin de mes parents. Elle ignorent jusqu'à mon prénom : Gretel. Fidèle à ce patronyme de conte, j'allais souvent dans ce petit bois où doit fondre le bonhomme de neige. Je n'y découvris nulle maison en pain d'épices, mais des mûres, des myrtilles, des champignons. Parfois des canettes vides, des sacs plastique, que je rapportais aussi, pour les mettre dans ma poubelle. Et quand je ne trouvais rien pour satisfaire ma gourmandise, alimenter ma colère, je faisais provision d'images, de sons, d'odeurs.
La forêt m'a toujours paru ma vraie patrie. Petite fille j'y espérais les fées ou le loup. J'y ai surpris des biches, des écureuils, admiré les pièges des épeires. Je collectais des marrons, qui, plantés d'allumettes, devenaient un bestiaire. Et des feuilles, saisies dans leurs fugaces couleurs d'automne. Je les retrouve encore, entre les pages de mes livres d'enfant. La forêt n'a cessé de me fasciner, de m'appeler. C'est à cause du petit bois que j'ai dit oui pour l'achat de la maison. Mon mari avait préparé une liste d'autres raisons pour obtenir mon consentement. Je ne l'ai pas laissé énumérer. Et c'est le petit bois que j'ai visité, avant la maison, tandis que mon mari faisait patienter le vendeur. Dès ce jour, probablement, les habitants du lotissement m'auront trouvée étrange. Et ils doivent penser que ma mélancolie s'aggrave, à présent que je ne sors plus. Certains se sont inquiétés de ma santé, je le sais. D'autres ont proposé des réunions Tupperware, des bridges. Mon mari en riait encore en me rapportant ces amabilités. Il n'a pas demandé pourquoi je n'allais plus dans le bois. Il sait que je réponds rarement aux questions. Je n'aurais pas parlé de l'homme endormi contre le tronc d'un chêne.
Il était apparu à l'automne. Dans la journée, il se chauffait au centre commercial, où il mendiait. Et, au moment de la fermeture, il disparaissait. Nul ne savait qui il était, d'où il venait, en quel lieu il dormait. Jusqu'au jour où monsieur Lécuyer l'avait découvert, une semaine après moi, alors qu'il emmenait crotter son chien à l'abri des regards. Il avait appelé la police. Connaître l'identité de l'intrus, lui proposer des soins, un toit temporaire : quoi de plus civique ? Les gendarmes repartirent bredouilles : l'homme était en règle, semblait en bonne santé, refusa de se rendre à l'asile ouvert pour les sans-abri. Nul ne l'avait revu. Progressivement j'avais cessé de penser à lui, surpris dans l'abandon du sommeil, et que j'avais baptisé Hansel. Le petit bois avait la forme de mon remords. J'aurais dû proposer une couverture, de vieux cartons, notre tente de camping. J'aurais dû porter le gâteau mis à cuire pendant ma promenade, cet après-midi-là, et dont le parfum m'accueillit à mon retour précipité. Ma maison était vide, comme toutes les autres, chaque habitant en visite au cimetière, ce jour de Toussaint.
Trois mois ont passé. Aux premiers bourgeons, c'est promis, je retournerai dans le bois. Promis à qui ? A mon mari, si respectueux de mes silences ? A la mémoire de mes parents, m'offrant mes livres de contes ? A l'enfant que je n'ai pas cessé d'être ? Au si estimable monsieur Lécuyer ? A la ronde des mères ? Elles sont depuis un moment groupées autour de leurs petits, qu'elles semblent vouloir faire disparaître dans les plis de leurs manteaux. Les petits tellement sages et silencieux. Il y a là-bas, au bord du bois, un mystère, comme une cérémonie pleine d'effroi autour des gyrophares. Les pompiers ont disparu entre les arbres dénudés, et tout le public est pétrifié, comme pris dans le gel de la semaine passée. Le gel qui a libéré le bonhomme de neige. Le bonhomme qui, en son cœur, a révélé un cadavre. Hansel est sur la civière des pompiers.
... et toutes les :
Saisons
J'ai toujours aimé les saisons. Je les ai aimées secrètement, jalousement, ne voulant jamais avouer préférer l'une puis l'autre, selon l'humeur de mes jours, le fil déroulé de ma vie. Jeune, je ne m'exaltais qu'au printemps, certain de la présence des nymphes farouches dans chaque bosquet, chaque source. Il suffisait d'attendre, assis à leur ombre, ou plongeant ma paume dans leur onde claire, et elles me parlaient, soufflant leur haleine parfumée dans mon cou moite d'espérance anxieuse. Ausonius, chuchotaient-elles, nous sommes là, sois tranquille, nous veillons sur toi. J'en pleurais d'émotion, comme une fille, certain d'être leur élu, et je baisais la terre, l'écorce des arbres, j'enfonçais mon visage plus avant dans l'eau froide. Parfois même je récitais Virgile, en regardant paître les troupeaux. La couleur du ciel changeait, je me souvenais qu'on devait m'attendre, que peut-être quelque esclave serait battu de ne m'avoir pas trouvé. Je quittais brutalement mes amies invisibles, courant à perdre haleine jusqu'à notre domaine. Emilia Corinthia, ma grand-mère, que tous ne nommaient que la mauresque à cause de son teint, était dans l'ombre du porche, une main en arc de cercle au-dessus de ses sourcils froncés, l'autre sur les amulettes de son cou. Elle grondait, des pauvres mots de sa langue vernaculaire, que j'avais tant chéris, et que l'étude, peu à peu, me fit injustement mépriser. Mon grand-père lui-même, tout amoureux qu'il en restât, la regardait parfois d'un peu haut, comme surpris de l'avoir épousée, lui, Cecilius Argicius Arborius riche et noble Gaulois, poussé au sud avec son père quand ce dernier avait été proscrit. Je rentrais, sous le feu roulant des questions de la mauresque, et des reproches d'Emilius Magnus, mon oncle et premier précepteur. Je ne devais point négliger l'étude, si je voulais devenir médecin comme mon vénéré père Julius, qui avait épousé Emilia Eona, troisième et dernière fille de mes grands-parents maternels. Ma tante Emilia Hilaria, sœur aînée de ma mère, fut également médecin, mais avec de plus rudes manières, qui la firent surnommer Hilarius, comme si ses vêtements de femme cachaient un homme. Ce sexe incertain découragea les possibles prétendants et Hilaria resta célibataire, sans que cela parût nuire à sa gaieté. Je lui garde une grande tendresse, comme à tous ces autres morts qui m'attendent sur la voie des tombeaux de Burdigala, où je suis né, il y a bien longtemps, en CCCIX.
On s'affaire en cuisines, pour préparer le festin de ma huitième décennie, et moi seul demeure à cette heure tranquille, assis sur ma terrasse regardant la Garonne. J'ai pris, depuis mon retour en Aquitania, cette habitude d'un moment de méditation solitaire. C'est ainsi, que regardant s'évaporer la brume matinale au-dessus du fleuve, j'ai pensé aux saisons, compagnes discrètes de ma vie agitée.
Mon oncle, qui était rhéteur, me confia aux plus célèbres maîtres de Burdigala, qui m'apprirent le latin et le grec, qu'entendaient déjà mon père et mon grand-père maternel. Le premier préférait même la langue grecque, qu'il pratiquait aussi bien que l'art d'Asclépios. Et, en secret, car la pratique en avait été interdite par la nouvelle religion, le second vouait ses loisirs à l'astrologie. Il fallut longtemps à ma mère pour lui faire révéler mon horoscope, qu'il n'avait pas manqué d'établir à ma naissance. Les nymphes n'avaient pas menti : j'étais promis à de grandes choses. Je suivis mon oncle à Tolosa quant mes maîtres de Burdigala n'eurent plus rien à m'apprendre, et j'y enseignais à mon tour, autant par goût de l'étude - j'avais délaissé de courir les nymphes dans la campagne - que par fidélité à mon très cher oncle, qui mourut dans sa trentième année. La mort semblait toucher ma famille de son aile sombre, car ma jolie tante Emilia Dryadia mourut au moment de se marier. Ma sœur Emilia Melania, première enfant de mes parents était morte elle aussi, de longue date, mais je n'en eus pas le chagrin, n'en ayant pas le souvenir, car je n'avais que quelques mois quand survint ce malheur. Ma seconde sœur, à laquelle on donna le prénom de la regrettée Dryadia, vécut presque autant qu'Hilaria-Hilarius, ma tante au sexe incertain. Mais mon jeune frère Avitianus, qui aurait dû marcher sur les traces de notre père en devenant médecin à ma place, mon jeune frère mourut avant d'embrasser cette généreuse carrière. Je me demandais alors si son choix lui avait été dicté par sa révérence vis-à-vis de notre père, ou par quelque intuition de la maladie qui l'emporterait et qu'il pensait peut-être pouvoir juguler de sa science toute neuve. Et je compris pourquoi notre grand-père avait tenu secrets nos horoscopes, car, s'il avait vu pour moi un long et glorieux avenir, il avait su également que Melania mourrait dans sa première année et qu'Avitianus n'atteindrait pas l'âge du Christ.
Sans doute aurais-je dû m'habituer à ce que la mort fît partie de nos vies, qu'elle y vînt trop tôt ou bien tard, conformément au fil tiré des Parques, dont nous ne connaissons jamais les caprices. Ou peut-être aurais-je dû m'en consoler en espérant cette autre vie promise par la religion des Chrétiens qui avaient finalement gagné de chasser nos anciens dieux et triomphaient dans leur quartier excentré de Burdigala, où leur église avait remplacé un de nos temples. Mais leur Ciel probablement m'apparaissait trop peuplé de leurs martyrs, morts en nombre dans nos amphithéâtres, et je doutais que leur compagnie me parût aussi aimable que mes chers Olympiens.
Et, surtout, plus que ces tergiversations religieuses - qui, dans ma jeunesse ne m'effleuraient pas - je ne m'habituais pas à la mort, dont les médecins de ma famille étaient pourtant familiers, car elle me frappa bientôt dans la femme qui avait alors supplanté, dans mes sentiments, toutes celles de ma famille : ma jeune épouse, Sabina. Elle m'avait été destinée de longue date, par son père, qui fréquentait notre maison. J'aimais beaucoup cet ami, grave sénateur, dont le goût des retraites bucoliques me rappelait mes quêtes juvéniles. Est-ce toi, Attusius Lucanus Talisius, qui, à l'instant tente de me parler, agitant le feuillage dont mon ombreuse pergola est tissée ? Est-ce toi, que je rencontre parfois, invisible présence, quand je me rends aux champs, ou dans mes vignes ? Quand je contemple le mascaret agitant notre Garonne ? Quelle colère alors t'agite contre moi ? Crois-tu donc que je fusse pour quelque chose dans la mort prématurée de ta fille, que tu n'eus pas la joie de conduire à l'autel car tu fus sur la barque de Charon avant ce temps de réjouissances ?
Morte à vingt-huit ans, Sabina me donna pourtant trois enfants : un premier fils, qui ne tarda pas à vous rejoindre au-delà du Styx, l'obole à Charron entre ses dents puériles ; puis, consolations de mes deuils, un second enfant mâle, Hesperius, qui fait une si belle carrière ; et mon unique fille, qui eut le courage de surmonter son veuvage pour se marier une seconde fois, et me permet ainsi de voir grandir mon petit-fils dans la sérénité. Les pères se doivent aux fils, dit-on, mais, de même que je suis l'amant secret autant que fidèle des saisons, j'éprouve un grand amour silencieux pour ma fille, aussi belle et bonne que l'était mon épouse regrettée, que je n'ai pas remplacée, même si certaine Bissula, captive Suève dont me gratifia l'empereur Valentinien lors de sa victoire sur les Alemanni, sut me troubler, réveiller mes sens. Elle était aussi pâle que mon aïeule la mauresque était sombre, ses cheveux étaient blonds, ses yeux bleus, elle était jeune quand je m'avançais vers la vieillesse, elle demeurait le plus souvent silencieuse faute de connaître les diverses langues que je parlais, et je n'entendais guère sa voix que dans le plaisir partagé, où les sons gutturaux de son langage inconnu étaient sur ma jouissance comme le garum sur nos plats romains.
J'avais alors totalement délaissé les nymphes de mes premières années, pour embrasser la religion chrétienne, qui était celle de l'empereur m'ayant appelé dans son palais d'Augusta Treverorum pour y être le précepteur de son fils Gratien, promis à lui succéder. Ce prince n'avait alors que huit ans, et je m'attachais à lui, en souvenir de mes propres enfants, devenus adultes. Je m'appliquais à l'éduquer autant qu'à plaire à mon impérial maître, dont j'obtins bientôt de grandes faveurs, plus avouables que celles de Bissula. Et quand Valentinien mourut, en CCCLXXV, Gratien, qui n'avait que quinze ans, continua de me combler. J'ai assuré ma gloire et obtenu tous les titres et bienfaits souhaitables pour ma parentèle. C'était, quant à ma carrière, une apogée, et je n'aimais alors que l'été, aussi brillant que moi. Etés chauds et lumineux de l'Aquitania que j'avais quittée, et que je regrettais un peu car cette saison est, aux confins nord et est de l'Empire, plus raisonnable, plus discrète. Bissula, aussi chaude qu'un caldarium, me rendit heureusement la canicule, pour lequel je me croyais définitivement fait. Mon stylet ne fut jamais plus inspiré que durant ces années-là, et mes tablettes en gardent la mémoire. J'ai chanté la Moselle et le Danube comme personne avant moi, ai-je la fatuité de croire ; et peut-être n'est-ce pas Attisius Lucanus Talisius qui vient s'indigner dans les flots de ma Garonne, mais la Garonne elle-même, qui, trahie de n'avoir pas été si bien honorée, fait ronfler son coléreux mascaret.
Paix, ma rivière, je te suis revenu, pour finir mes jours auprès de toi, devisant avec mes amis Axius Paulus, Theon, Tetradius quand ils me visitent dans mes domaines, accompagnant les promenades de mon petit-fils sur les chemins qui te bordent, lui révélant, dans les sous-bois, les champignons dont je demeure friand, et que j'espère voir figurer au festin qui s'apprête aujourd'hui. Aura-t-on pensé aux huîtres de Burdigala, qui sont les meilleures quoi qu'en prétendent d'autres amateurs ? La lamproie sera-t-elle préparée de la manière que j'aime ? Trouverai-je, dans son berceau de feuilles, le fromage goûteux de mes chèvres ? Les vins seront-ils de mes propriétés, ou leur ajoutera-t-on quelque Falerne apporté par bateau sur les quais de Burdigala, qui commerce avec les ports de Mare Nostrum ? L'amphore romaine et le tonneau gaulois se disputent la faveur de mes caves, comme les religions se disputèrent nos croyances. J'avoue avoir quitté les Chrétiens, que je n'avais guère approchés que par opportunisme. Cette foi morbide en en un dieu condamné à l'indigne crucifixion ne seyait guère à mon heureux tempérament, alors qu'elle semble convenir à ce Pontius Meropius Paulinus, fils d'un ami de mon père, et qui fut mon disciple.
Je me porte encore bien, malgré mon âge, et j'ignore à quel moment Atropos, la troisième Parque, qui trancha le fil de Gratien à Lugdunum, grâce au couteau de Maxime son assassin, tranchera le mien ; mais je ne crains pas d'entrer dans cet hiver définitif de la mort, car j'y retrouverai tous ceux que j'ai chéris, et j'y verrai peut-être enfin le visage de ces nymphes que je cherchais dans les bois et les eaux. Je n'ai quasi point de regrets, à l'exception de ce Paulinus, ma brebis égarée, comme diraient ses amis chrétiens. Je partirai serein car j'ai pu tracer ce cercle parfait, qui me ramène, en ma vieillesse, à la matrice de mes jeunes années. Puissent mes yeux se fermer sur cette terrasse où j'ai, ce matin, médité des saisons. C'est à présent l'automne et sa douceur sucrée que je préfère.
Cette nouvelle était un hommage rendu au propriétaire (et guide passionné) des ruines d'une villa où vécut probablement le poète Ausone. Il s'y vend également un excellent vin, car cet heureux homme est aussi vigneron.
J'ai prêté au poète gallo-romain de méditer heureusement, sur la fuite du temps. Ce temps m'obsède sans doute un peu, car j'écrivis un jour une nouvelle dont le sujet (la démonstration) devait être que nous vivons en permanence dans l'attente du temps futur, et que nous nous en trouvons toujours floués puisque le futur n'aboutit qu'à la mort. Je commençais donc sur cette idée, abstraite, sans savoir en quels personnages j'allais l'incarner. Les mots mon Dieu (interjection banale) et ma sœur, qui vinrent spontanément sous ma plume, décidèrent pour moi :
Confession
« La vie se passe en attentes. D'où nous vient, mon Dieu, cette insatisfaction ? Qui donc nous croyons-nous pour, toujours, espérer mieux du lendemain ? Les mots eux-mêmes trahissent cela avant notre naissance. Car, de la femme qui nous porte dans son ventre, on dit qu'elle attend un enfant. Le verbe est aussi précis que vain. Car il est mille manières d'attendre. Avec espoir, joie, impatience, crainte, accablement, terreur. En montrant ses sentiments intimes, en croyant les partager avec d'autres humains, ou en les dissimulant. Et, de concert, la petite vie qui n'a pas encore de mots mais s'en nourrit par le cordon, la petite vie, déjà, attend. D'être une belle copie présentable et non plus ce brouillon en chantier pendant neuf mois. Il - ou elle - naît. Sera-ce la fin de l'attente ? Vous n'y êtes point, ma sœur, ce n'est que le commencement véritable. Il y a cette douleur d'attendre le sein nourricier, qui n'est plus à disposition comme le cordon lors que les corps sont séparés. Puis ce combat permanent pour sortir de la petite enfance, apprendre à parler, marcher - lequel précède ou suit l'autre ? Je ne m'en souviens plus - à contrôler ses fonctions naturelles. A manger seul, avec divers instruments plutôt qu'avec ses doigts. A de laver, se vêtir seul. Vous l'aurez compris : toutes ces victoires sur soi-même n'ouvrent que le terrible chemin de la solitude. Notre mère s'éloigne de plus en plus, fière de nos triomphes successifs. Mère inconsciente, qui ne mesure pas que cet apprentissage d'autonomie est aussi, celui du détachement, qui nous fera admettre sa mort... Mort : voici qui est fait, j'ai prononcé le mot, ne vous agitez pas ma sœur, ce serait à moi de la craindre et non point à vous. Mis vous connaissez là-dessus mon indifférence, et que je partage complètement les vues de Monsieur Pascal, permettez-moi, en la circonstance, de le citer : Avant elle ne nous concerne pas, après elle ne nous concerne plus. Abandonnez votre rosaire, le bourdonnement de votre voix m'agace autant que celui d'une ruche, écoutez-moi plutôt, je suis au seuil de la clairvoyance, vous reprendrez vos prières plus tard. Ce que j'ai à dire, en ce moment capital, vous sera, peut-être, utile. Orgueil présomptueux que de l'espérer, je le vois à votre regard terrifié, mais que m'importe de commettre ce péché capital ? Et même les six autres - quoique, pour la luxure, si vous ne m'aidez, je n'y parviendrai guère - je ne songe pas à mourir absoute. Votre rougeur est charmante, mais ne vous sauvez pas sous couvert de quérir notre confesseur, je préfèrerais notre beau jardinier. Tenez-vous coite, par faveur, car vous regretterez votre agitation quand j'aurai passé. Vous vous demanderez si j'ai bien prononcé tel mot, énoncé telle idée. Reprenons, vous me fatiguez, quand le rôle qui vous est dévolu serait de m'apporter calme et sérénité. Nous perdons du temps, car je n'en étais, de ma démonstration, qu'aux prolégomènes de la petite enfance... C'est alors que la grande insatisfaction prend corps : que reste-t-il quand ce dernier a tout appris, pour satisfaire l'esprit insatiable ? Pour le tenir en laisse, on nous inflige Dieu, Allah, Quetzalcoalt, Krishna, qu'importe le nom, ne me jugez point impie, du haut de vos dix-huit ans incultes, j'ai seulement beaucoup lu, seuls voyages autorisés dans notre vie recluse. Et ne vous tourmentez pas à l'idée de devoir bientôt chercher dans ma cellule des livres interdits pour en dresser un de ces bûchers de vanité qui éclairèrent sinistrement Florence : vous ne trouverez que des ouvrages pieux, pour le leurre, et les Mémoires des missionnaires épandus sur le vaste monde comme les sauterelles sur l'Egypte de notre Bible. Ajoutez le blasphème à l'orgueil, je vous le concède, mais je suis encore loin du compte pour les péchés mortels. Vous avoueriez, si vous aviez quelque humour, que je ne risque plus grand chose présentement. Las, vous êtes vierge de cette qualité - que je tiens en très haute estime - comme de beaucoup d'autres. Vierge de corps aussi probablement, inutile d'avouer, cela transpire dans tous vos gestes. Vous êtes jeune cependant, ce grand malheur est réparable. Moi, Dieu merci - oui : je persiste dans le blasphème - je n'emporterai pas mon pucelage au tombeau. Il y a belle lurette que j'ai été saillie par tous les orifices possibles. Le chapelet vous en tombe des mains, laissez-le don au sol, il n'y a personne que vous et moi dans cette pièce. Non : Il n'est pas là qui nous regarde, nous entend, nous juge, il n'y a personne vous dis-je, et vous tenez la dernière occasion de vous instruire en ces murs. Les Mémoires des missionnaires, disais-je avant que vous ne m'interrompiez. Ne protestez pas que vous n'avez rien dit, il est aussi mille manières de rompre une conversation : d'un regard qui noircit, d'un haussement de sourcil, d'une rougeur subite, d'un geste brusque, d'une bouche qui s'entre-ouvre. La votre est jolie, que j'eus parfois envie de baiser, je l'avoue sans honte car ce n'était que reconnaissance d'une beauté particulière en ce vaste monde de laideurs diverses. La beauté est une grande injustice, mais une ineffable consolation. On me loua fort de tant prier dans le jardin du cloître, par tous les temps. C'est que j'y trouvais cette païenne consolation, dans le parfum du buis et des roses - vous en trouverez des pétales entre les pages de ces Mémoires, ne négligez pas de lire et relire les lignes qu'elles ont tachées, ce sera manière de continuer notre entretien car je ne les ai jamais glissées au hasard des feuillets : toujours leur présence indique quelque passage remarquable - L'hiver, j'admirais la neige, et le gel blanc trahissant les pièges de dentelle tendus par les araignées. A l'automne, je collectais les feuilles mortes, dont j'ai également parsemé ces livres, vous pourrez vous épargner lecture des pages ainsi signalées, remplissage de prêchi-prêcha. Au printemps j'attendais le surgissement des crocus, l'édification des nids. Il n'est de si beau jaune que l'intérieur de jeunes becs réclamant pitance... Jamais je ne prononçais une seule prière en ce jardin, où je ne fus que regard, ouïe, narine, toucher. Les papilles furent moins satisfaites car le cloître ne recèle pas les groseilliers du verger de mon enfance. Mais la mémoire est ma sûre alliée, qui, à l'instant, dans ma bouche séchée de fièvre, m'en restitue le goût et me fait saliver. Non : je ne vous réclame point l'eau du pot d'étain pour cette bouche brûlante, car cette eau, prise au puits voici deux jours, n'aura plus goût que de métal... Source vive de mon jardin d'enfance, je ne t'ai pas oubliée non plus... Mais aujourd'hui, j'aimerais du vin. Du vin de Champagne, pour honorer Dom Pérignon, qui fut de ma parentèle, du côté de ma mère. Avez-vous jamais bu de ce vin, sœur Agathe ? Non, sans doute, vous aspirez trop à la sainteté et au martyr, il n'est que de prononcer ce nom qu'en religion vous vous êtes choisi : sainte Agathe, dont on trancha les seins. L'Homme montra toujours une grande imagination dès lors qu'il s'agissait de faire souffrir, mutiler, tuer. Que donc vous reprochiez-vous en choisissant Agathe pour patronne ? de vous être caressée, parfois, ces beaux seins dont votre bure ne saurait, totalement, dissimuler les courbes harmonieuses ? Caressez-vous, caressez-vous, ma fille, donnez-vous du plaisir, c'est autant que vous volerez à la mort, fin de toutes choses. Non je ne crains pas l'Enfer et son grand four, qui n'existent pas plus que le Paradis et son céleste concierge. Il n'y a rien derrière la porte vers laquelle je m'avance, et je vous conseille de prendre le pari inverse de Monsieur Pascal, en misant sur ce monde-ci. Le philosophe n'avait point de santé, on lui pardonnera d'espérer en une deuxième vie, tout de lumière, sans son corps douloureux. Nous avions en commun de préférer la couleur jaune : à lui le rayonnement solaire de la Face Divine - vous n'entendez pas, mais je mets des majuscules, par dérision - à moi le bec des oiseaux, les pétales de roses, et ce petit chausson de soie safran que je garde de mon enfance. Vous le trouverez dans un coffret de cèdre, dissimulé sous mon châlit d'agonisante, d'où je tente de vous éclairer. Mon vœu de pauvreté ne sut s'étendre aux richesses dérisoires de mes jeunes années. Ce chausson à la trame usée, au fil rompu, c'est la main de ma mère le mettant à mon pied. C'est la danse avec Jacotte, ma nourrice, qui chantait si bien Aux marches du palais. Vous ne voulez pas me faire entendre cette musique une dernière fois, en place de la prière des mourants ? Il me plairait mieux de partir sur votre jolie voix servant notre français si clair plutôt que de m'enfoncer dans les ténèbres du latin tortueux de notre foi jurée. »
Sœur Agathe chanta.
La prieure mourut, un sourire revenu sur ses lèvres. La jeune nonne se pencha sur le corps immobile, en baisa la bouche enfin muette. Elle se saisit de la main encore tiède, la posa un instant sur son sein, plongeant son regard dans celui de la morte. Ayant accompli cela, elle ferma les paupières sur les yeux qui ne la voyaient plus, elle ramassa le chapelet tombé, le mit entre les doigts du cadavre, dont elle joignit pieusement les mains. Tout le bâtiment dormait. Elle sortit de la cellule, se dirigeant sans hésiter vers le jardin du cloître. Sous la lune pleine, elle cueillit des brassées de roses jaunes et les rapporta sur le corps de la Prieure. A cet ouvrage furtif, pressé, elle s'était piqué les doigts aux épines et quelques gouttes d'un beau vermillon marquaient les pétales. Elle se nettoya au pichet d'étain où la morte avait refusé de boire. Puis elle se pencha pour tirer le coffret en cèdre de sa cachette. Parmi les livres de l'étagère unique, elle choisit les Mémoires, qu'elle noua ensemble du cordon enserrant sa robe. Et, chargée de ce double viatique, elle quitta le Prieuré, par le potager dont le mur était en partie écroulé. Elle entendit la cloche appelant à la messe de l'aube alors qu'elle traversait le ruisseau, ayant évité le gué, pour être certaine de sentir la caresse de l'eau fraîche sur ses pieds déchaussés.
Des mots, ainsi, peuvent orienter une texte sur des pistes auxquelles n'avait pas songé l'auteur. Ils peuvent aussi orienter une vie, comme dans :
Mots
Il fut réveillé par les cris du bébé hurleur, à l'étage en-dessous. Il bougonna, à mi-voix, ayant pris l'habitude de soliloquer : « Putain, y'en a qu'ont vraiment envie de se pourrir la vie ! Quelle idée d'adopter un môme niakoué. Auraient mieux fait d'aller chercher un greffier à la S.P.A., les voisins auraient moins souffert. » Au mot greffier il sut que son monologue prenait la mauvaise pente, il se tut, tenta cette gymnastique mentale, également devenue habituelle, qui consistait à détourner le cours de ses pensées dans une autre direction. Vers la géographie, peut-être, à partir du têtard jaune troublant régulièrement son sommeil ? Il n'était jamais allé en Asie. Et n'avait même jamais rêvé d'une telle destination. S'il avait dû fuir, son goût l'aurait porté vers l'Amérique latine. Fuir était aussi un mot à éviter. Il refit sa phrase tacite à voix haute : « Si j'avais dû émigrer, j'aurais choisi l'Argentine. » Pourquoi l'Argentine, plutôt que le Pérou, la Bolivie ou Cuba ? Il l'ignorait car tous ces pays lointains n'étaient guère que des noms, les pièces d'un puzzle qu'il se serait montré incapable de situer sur ce continent. Il décida d'explorer cette piste : « L'Argentine à cause de Carlos Gardel, et parce que je baragouine l'espagnol de ma mère. » Il chercha à se remémorer un air de tango, quelques paroles de chanson. Et le visage de la défunte. C'était bien. Cette association de la musique mélancolique et de son grand deuil le rendait infiniment triste, mais le mettait à distance du présent, le renvoyait au temps d'avant. Avant était de trop. Il rectifia : « Au temps de ma jeunesse. » Désireux de rester sur le souvenir de sa mère, il s'interrogea : depuis quand ne s'était-il pas rendu sur sa tombe ? Il ne sut trouver la date exacte mais retomba sur le mot à chasser : avant. Les yeux fermés, il se projeta l'image de cette pierre nue, gravée d'un nom et deux dates : Mercedes Gustamero 1921-1971. Morte à cinquante ans. Pile l'âge qu'il avait à présent. Combien d'années lui restait-il, dans cette loterie qu'était toute vie ? Pourquoi n'avait-il pas passé un contrat avec un fleuriste de la ville pour d'annuelles chrysanthèmes ? Contrat était encore un mauvais mot. Il se jeta hors du lit, hurlant presque : « Putain, je les aligne aujourd'hui ! » Putain lui sembla à cultiver : il irait en voir une avant de prendre sa veille à l'usine. Le sexe était le seul remède. Quand il pénétrait une femme, ce n'était pas uniquement son foutre qui jaillissait hors de lui, mais toutes ses pensées. Il se retrouvait l'esprit vide un moment, comme si, derrière son front, il n'y eut plus ce cerveau dément, tricotant toujours. Dément le fit hésiter, alors qu'il se brossait les dents. Dans quelle catégorie entrer ce mot ? Réfléchissant, il se regarda dans la glace au-dessus du lavabo. Exactement les yeux de sa mère. Et de ce père inconnu, qu'avait-il hérité ? La mauvaise part, probablement. La mère avait toujours refusé de l'évoquer. Il n'avait même jamais appris son nom, son prénom. Avaient-ils fui ensemble l'Espagne franquiste, ou s'étaient-ils connu plus tard ? Etait-il de Barcelone, ou de Toulouse ? Quand sa mère était morte, il s'était promis d'enquêter. Mot tabou. C'était loin derrière... Les points de suspension lui parurent un moindre mal. La ponctuation était plus floue, plus impalpable que les mots. Il se souvenait de cet apprentissage avec la si jolie institutrice dont il était amoureux. Maîtresse d'école et non pas institutrice, rectifia-t-il, c'était le vocabulaire d'alors. Et la leçon qui l'avait tant fait rire, c'était comment déjà ? Une même phrase, ponctuée différemment, et dont le sens changeait : « Le maire dit : l'instituteur est un âne. » « Le maire, dit l'instituteur, est un âne. » Il répéta, d'une voix d'enfant. Sa mère détestait l'institutrice. Sa mère qui avait dit « La maîtresse est une pute. » Il essaya l'autre ponctuation : « La mère, avait dit la maîtresse, est une pute. » Il rit, mais ça ne collait pas. La mère et l'institutrice avaient été d'honnêtes femmes. Honnête : voyant rouge allumé, sonnette d'alarme, s'esbigner. Quitter la salle de bain pour préparer le café. Parfum apaisant. Pour le goût, ce serait raté, à cause du dentifrice ayant précédé. Mais il avait une haleine si détestable, une bouche tellement sèche au réveil. C'étaient ces putains de médicaments. « Putains, revenons-y. Laquelle aujourd'hui ? La brune Carla ou Eve, la fausse blonde ? Prénoms sûrement empruntés. » il butait décidément sur des identités inconnue (son père) ou mensongères (les filles). Combien coûtaient de faux papiers ? Il l'ignorait mais abandonna la question. Scénario trop compliqué ; trop long à mettre en place. L'âge de sa mère, se souvint-il. S'il mourait demain ? Et l'Autre, que deviendrait-il, dans cette hypothèse ? il sentit des gargouillements de peur sous la peau de son ventre et décida de bifurquer à nouveau vers les leçons de l'institutrice : « Quand tu récites un poème, pour bien entendre la ponctuation, tu comptes des silences : 1 pour une virgule, 1-2 pour un point-virgule, 1-2-3 pour un point. » Il avait demandé : « Et le point d'interrogation, d'exclamation ? » Elle avait précisé : « Avec ceux-là, il faut seulement varier l'intonation sur les mots. » Pour les points de suspensions, il demeurait dans l'ignorance, ayant omis de questionner la maîtresse d'école. Qui s'appelait, qui s'appelait... Il fredonna : « non je ne me souviens plus du nom du bal perdu... » Bal perdu : alerte maximale, même si ce n'était pas l'orthographe correct. Il mangea sa dernière tartine. Ce ne serait ni Carla, ni Eve, mais la pute noire, qu'il n'avait jamais essayée car il craignait un travesti. Un peu de couleurs, c'est peut-être ce qui a manqué dans ma vie, argumenta-t-il. En s'habillant, il récapitula : « Mère habillée de gris, comme les murs de notre banlieue, et mes blouses d'écolier, de magasinier. Mes nuits blanches de veilleur. Tout était trop blafard. » Il eut une nouvelle pensée pour l'Autre : son sort n'était-il pas pire, définitivement gris ? Avec, probablement, autant de nuits blanches ? Est-ce qu'on fournissait des médicaments là-bas ?
Sur le boulevard il trouva la prostituée africaine. Ce n'était pas un travesti. Et son odeur n'était pas aussi désagréable qu'il avait craint. La quittant, il se félicita : « J'ai perdu un préjugé. Je suis un homme libre. » Il affronta le mot libre. Il s'y fortifia, et, au lieu d'aller prendre sa veille à l'usine, il se dirigea vers la gare. Il dut attendre quelques heures, mais il n'était plus pressé. Il observa le va-et-vient des voyageurs. Il mangea au buffet, où il acheta un sandwich et une bière pour un clochard effondré sur un banc, et sourit à l'idée de son étonnement quand il trouverait sachet et canette près de sa tête.
Dans le train il s'endormit brutalement et ne fit aucun cauchemar. Il s'éveilla peu avant Toulouse. Sa décision était prise : il ferait tout le trajet à pied. De la gare au cimetière, et du cimetière au ... A Paris il ne marchait plus : ascenseurs remplaçant les escaliers, métro pour se rendre d'un lieu à un autre. Sa vie, soudain, lui sembla visitée par les couleurs : ciel très bleu, linge aux fenêtres, fleurs rouges, jaunes, roses, violettes, oranges dans cette boutique proche du cimetière. Il dépensa tout son argent et dut se faire aider pour transporter ses achats sur la tombe de Mercedes Gustamero. Il fut très content de ses choix. La pierre disparaissait complètement sous cette profusion multicolore et parfumée. Il resta un long moment à contempler son œuvre éphémère et à soliloquer. Puis il marcha jusqu'au palais, avec lenteur mais détermination. Quand il fut arrivé, il demanda à rencontrer l'avocat de Pierre Mercier. On lui répondit qu'il était en rendez-vous, et que lui-même devrait prendre rendez-vous. Il insista que c'était urgent, qu'il fallait déranger maître Aubert. On continua à vouloir l'évincer. Alors il se décida à préciser, sans plus attendre l'avocat : « Pierre Mercier est innocent. C'est moi qui ai tué Antoine Cipriani. »
Et il y a les mots qu'on oublie, dans la vieillesse et la maladie, quand tout le passé, et jusqu'aux visages familiers deviennent un brouillard inconnu :
La Photographie
Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Ce n'est pas ma maison. Je ne connais pas les gens qui habitent avec moi. Aucun objet ne m'est familier. Pas même cette photo qu'on a mise près de mon lit. Elle y est depuis hier. Ou depuis des mois peut-être. Le cadre est joli, en bois laqué rouge. Deux dames sourient. Elles ont regardé le photographe. Elles semblent heureuses. L'une a ses bras autour des épaules de l'autre. Leurs joues sont colorées. Elles ont chaud. Ou froid. Ou elles ont bu du vin. Elles sont à table. Derrière elles il y a une chose verte, avec d'autres choses multicolores posées dessus. Les mots se sont encore sauvés. Pourtant, il faut que je parle, sinon on va me gronder. Et je pleurerai, comme Denise. Je me suis souvenu son nom ! Elle dort dans le lit voisin. Pendant la journée, elle me tient la main. C'est ma sœur, peut-être.
Mais non : ma sœur est une petite fille. Elle a cinq ans. Moi j'en ai sept. Denise est une vieille dame. Elle a des cheveux blancs. C'est Noël. Ma petite sœur et moi regardons la chambre de maman, par le trou de la serrure. Elle ne se lèvera pas aujourd'hui, a dit notre papa, elle a trop mal au dos, ne faites pas de bruit. Alors, toute ma vie, je suis arrivée sur la pointe des pieds. Derrière mon papa qui pleurait. Et mes frères. Ma petite sœur. L'autre papa. Je m'embrouille. Celui que j'ai appelé papa, plus tard, c'était le papa de ma fille. Je ne dois pas m'énerver, ou les mots se sauveront encore et on me mettra sous la douche. Comme si la douche pouvait faire pleuvoir les mots envolés.
Personne n'est réveillé. Je suis bien pour réfléchir dans ce silence blanc. Je crois m'être toujours levée tôt, dans ma maison d'avant. Papa-le-deuxième faisait des gâteaux. Je sais encore leurs noms. Et leur parfum. Il est mort, je crois. Au printemps, j'irai au cimetière. Avec la dame de la photo. Elle a une voiture. Son visage m'est vraiment très familier. Quel dommage que je ne sache plus comment elle s'appelle. Tout est tellement en désordre, dans ma tête. C'est plein d'images, comme dans le téléviseur de la pièce voisine, mais quand je veux dire les images, les mots descendent en bouillie dans ma bouche. Je bave un peu en mangeant. Elles ne veulent pas comprendre. Je me suis coupé la lèvre avec le couteau. On m'a grondée. J'aurais dû me servir de la fourchette ou de la cuillère. Il y a trop de choses autour de mon assiette. Manger est devenu une chose très compliquée. Je n'ai plus jamais faim. Il faut que je cesse d'employer le mot choses, que je trouve leurs noms, comme si j'étais à l'exercice du matin, devant le tableau. Je ne sais pas pourquoi je dois retourner en classe chaque jour. Ma petite sœur n'y vient plus. Elle est malade peut-être. Non. C'est maman qui est malade. Elle va mourir. Ils meurent tous dans cette histoire. Sauf moi. J'irai bien les rejoindre quand je m'ennuie. Je m'ennuie souvent. Mais la porte du couloir est toujours fermée. Sauf quand je suis avec la dame de la photo. Elle sait, elle, appuyer sur tous les boutons qu'il faut. Sésame ouvre-toi, disait Ali-Baba. Sésame est un mot inutile. Pourquoi est-il resté ? Et ce nom du héros, alors que je ne sais plus comment s'appelle la dame de la photo ? Celle qui ouvre la porte et m'emmène dans le parc. Nous nous asseyons sur un banc et nous goûtons. Elle me parle de promenades anciennes, de bonheurs passés, et je fais semblant de me souvenir. Mais je ne sais plus rien, sauf que les friands ou les palmiers qu'elle m'apporte sont aussi bons que ceux de mon-papa-le-sien. Ma petite sœur était gourmande. Nous mangions du chocolat, cachées sous nos draps. Le chat aussi était caché sous les draps. Il faisait froid dans la grande maison. Ici il fait toujours chaud.
Denise a remué. Il faut que je me dépêche de réfléchir avant qu'elle ne vienne tout embrouiller avec ses larmes. Denise a une vie d'aquarelle. Moi, c'est pastel sec. J'aime bien cet exercice avec les bâtons de couleur. On n'est pas obligé de parler, ni de faire des choses qui ressemblent à des choses. La dame de la photo est venue à la kermesse, quand nous avons vendu nos dessins et nos petites bouteilles emplies de sable. Je n'étais jamais allée à la mer avec ma petite sœur. Nous habitions la campagne. Il y avait un noyer dans le jardin, et des champs derrière la maison. Les soirs d'été papa jouait du violon ou de la clarinette, sous la glycine. Une fois il nous a emmenées au théâtre. Avec maman. Dans la voiture tirée par le cheval. Un tilbury, je me souviens du mot. Et notre cheval s'appelait Candie. Comme l'île, comme le sucre. Je ne dois pas me laisser distraire par les mots qui n'ont plus cours ici.
Robert s'est levé, il est sorti de sa chambre, je l'entends marcher dans le couloir. Il cherche sa femme. Il ne la trouve jamais. Elle se cache dans une blouse blanche. Avant je n'aimais pas cette couleur, je la trouvais fade. Mon papa préférait me voir en rouge. Telle le Petit Chaperon. Le loup viendra bientôt me prendre. Il y a une forêt derrière le parc. Comme le nom de mon village. La Forêt-du-Parc. Je suis née à La-Forêt-du-Parc. En 1913. Mon papa n'est pas allé à la guerre parce qu'il avait quatre enfants et que le frère de maman avait été tué sur le front. C'était la première guerre. Et le premier papa. Le deuxième a été prisonnier à Dortmund. Cinq ans. Il a été libéré par les Américains. Notre fille est née après.
Denise est réveillée. Elle pleure parce qu'elle ne veut pas être la femme de Robert. Les blouses blanches vont arriver. Elles ne me gronderont pas, car je n'ai pas fait pipi au lit. Je leur dirai tous les mots que j'ai retrouvés ce matin, tous les souvenirs. Elles les écriront sur un cahier. Denise en a un aussi. Et Robert. Et les autres. Un chacun. Nous sommes sept. Je sais encore compter. Comme les sept nains. Mais je ne sais plus écrire. Le stylo n'obéit plus à ma main. C'est un méchant. Beaucoup d'objets sont méchants à présent. Mais il ne faut pas que je les gronde, ni que je les casse. Je dois faire semblant de les croire aimables, et ne pas les cacher dans mon lit pour les punir. Le chat ronronnait sous les draps, et le chocolat était bien meilleur. Ma petite sœur en avait le museau tout barbouillé. Papa ne nous a pas grondées ce matin-là. Le matin où maman est morte. Elle va venir. Elle est sur la photo. Je l'ai reconnue finalement. Mais je ne sais toujours pas qui est avec elle, tenue par les épaules. Une vieille dame avec des lunettes. Ma grand-mère Esther peut-être ? Mais grand-mère Esther voyait bien. Très bien le chocolat qui restait sur nos lèvres. Moi j'ai une mauvaise vue. Les lettres de l'alphabet sont devenues méchantes, elles ne veulent plus jouer ensemble pour faire des mots, sur le tableau. Et je ne peux pas les cacher dans mon lit, le chocolat les salirait, le couteau les blesserait, elles mordraient le chat. Et Denise se mettrait à pleurer. Moi je n'ai pas pleuré, quand maman est morte. Pour la punir. Elle est toujours derrière le tableau noir. Mon cahier est rouge, comme la robe qu'aimait mon papa. Celle que j'aurai dans mon cercueil si je meurs. Le cadre de la photo est rouge aussi. Le plafond est blanc. Il manque des couleurs à l'arc-en-ciel. Je n'ai pas pu terminer mon dessin.
Mais d'autres sensations, dans d'autres vies, demeurent précises, intenses, inoubliables, comme :
Le parfum du tilleul
J'avais rendez-vous chez l'avocat dans la soirée. Mais j'avais dit au bureau que la convocation était pour l'après-midi. Ce qui me donnait deux heures d'avance pour m'habituer à cette idée d'une séparation définitive d'avec Millicent. Nous avions été mariés dix-huit ans, et il me paraissait incroyable que cela finît, même s'il y avait des mois que nous ne vivions plus ensemble. Elle était partie un soir de Juin, sans dire pourquoi. Peut-être n'avait-elle pas de raison particulière. C'était un soir comme les autres. Un peu plus chaud, je crois me souvenir. Je pensais boire un verre sur la véranda du bungalow, comme d'habitude, assis dans le vieux rocking-chair que je tiens de mon grand-père Harry. Je me serais balancé sans penser à rien, veillant seulement à ce que les mouches ne tombent pas dans mon whisky. Je n'aurais pas fermé les yeux, parce ça agaçait Millicent. J'aurais plutôt regardé les gosses des voisins jouer dans la décharge des pneus, ou j'aurais fait semblant de lire le journal du jour, retardant l'instant d'en arriver aux pages sportives, les seules qui m'intéressaient, et dont Millicent s'emparait quand elle avait besoin de papier pour envelopper les ordures, allumer le feu. J'aurais rusé, pour paraître occupé, alors que je n'ai jamais été attentif qu'au bonheur d'être marié avec Millicent. J'aurais écouté son pas, dans mon dos, d'une pièce à l'autre, avec ce petit bruit caractéristique de ses mules claquant le parquet. Et j'aurais respiré le parfum des beignets qu'elle préparait au moins une fois par semaine pour notre dîner.
Je ne saurai jamais si, ce soir-là, elle aurait préparé des beignets. Nous serions peut-être allés au ranch, dîner d'un hamburger à la sauce piquante. Et Mac Grown m'aurait accueilli d'une tape dans le dos, en me demandant : « Alors, Ben, toujours pincé ? » Millicent aurait souri. De ce sourire timide que je lui ai toujours connu.
Mais ce soir-là, je n'ai pas entendu les mules de ma femme, je n'ai pas respiré le parfum des beignets. La porte était fermée. J'ai pris la clef sous le pot retourné, j'ai ouvert, pensant qu'elle n'était pas rentrée du supermarché. Tout était propre, rangé, inhabituel. Sur le tableau où elle inscrivait ordinairement la liste des commissions, elle avait écrit : « Je ne rentrerai pas ce soir. » J'ai cru qu'elle était partie au chevet de sa mère. Mais je n'ai pas appelé, car la vieille dame est sourde et Millicent ne répond jamais au téléphone. J'ai ouvert le frigo. J'ai bu du lait, dans un verre abandonné sur l'évier. Un verre tout seul, comme si Millicent avait eu soif au dernier moment et qu'elle avait tiré de l'eau au robinet. Un verre sans aucune empreinte, j'ai regardé par transparence. Ma femme ne mettait jamais de rouge à lèvres, et ses mains étaient toujours sèches, même par quarante degrés à l'ombre. J'ai mangé des biscuits, qui devaient être vieux car ils m'ont semblé durs. J'avais faim, mais je n'osais pas me rendre chez Mac Grown, pour éviter les questions. Et je pensais que si ma belle-mère était mourante ce ne serait pas décent de montrer mon appétit. J'ai regardé la télé, assez tard. Il y avait des retransmissions de hockey sur plusieurs chaînes. J'ai vidé la bouteille de whisky sans m'en rendre compte ; sauf au moment de quitter la banquette pour monter dans la chambre. J'ai dû tenir la rampe de l'escalier.
Le lendemain, je suis arrivé en retard au bureau. Mais le patron n'a rien dit car ce n'était pas dans mes habitudes. J'avais toujours été ponctuel, pour rapporter ma paie intacte à Millicent.
Je n'ai pas eu de nouvelles pendant une semaine. J'étais maussade. Je trouvais que la vieille dame mettait beaucoup de temps à mourir, qu'elle manquait de décence à me priver si longtemps de ma femme. Je suis allé chez Mac Grown deux fois. Nous avons parlé du cancer, des primaires, et des matchs de hockey. C'est le lendemain de ma seconde sortie que Millicent m'a téléphoné au bureau, pour me demander si j'avais choisi un avocat. Je l'ai fait répéter. Je croyais qu'elle confondait avec un notaire, à cause de la mort de sa mère. Mais sa mère était vivante. Et Millicent voulait divorcer. J'ai demandé pourquoi. Elle s'est énervée, a raccroché en me disant : « Ne sois pas idiot ». C'est la dernière phrase que j'ai entendue d'elle.
Après, j'ai eu du courrier de son avocat. Il voulait le nom du mien. Je n'ai pas répondu, parce que je n'en avais pas choisi. Alors celui de Millicent s'est également énervé, il a évoqué les intérêts de sa cliente. C'était bizarre, ce mot : cliente. Parce que Millicent était fauchée, et que l'avocat probablement pas. C'était comme une inversion des rôles ; et ça ne collait pas avec le sourire timide de ma femme. Elle avait dû faire des efforts considérables pour franchir une porte sur laquelle était posée une plaque en cuivre, dans un quartier huppé où nous ne nous étions jamais rendus.
Je suis allé traîner par là, un soir, après l'heure de fermeture. C'est au bord du fleuve. Il n'y a pas de décharge de pneus sur un chemin de terre poussiéreux, mais des arbres centenaires et des voitures rutilantes sur l'asphalte lisse. J'étais ému. Millicent avait dû paraître si menue sur cette grande avenue où les taxis ne respectent pas les limitations de vitesse. Je l'imaginais à ma place, accoudée au parapet de ce pont, regardant l'eau glauque. Quoiqu'elle tournait plus souvent la tête vers le ciel quand nous nous promenions ensemble. C'est moi qui regardais vers le bas, le trottoir ou mes pieds. Encore quelque chose qui agaçait Millicent. Je ratais le vol des papillons, les couleurs du crépuscule, disait-elle. Mais j'aimais bien voir mes grosses chaussures près de ses escarpins. Quarante-et-un et trente-quatre, elle faisait trois pas pendant que j'en allongeais un.
Ma belle-mère est morte un peu plus tard. Millicent ne m'a pas informé. J'ai lu le faire-part dans le journal. Je me suis rendu au cimetière, sans me montrer. Millicent était auprès de son frère, devant le cercueil. Il lui tenait les épaules. Je suis parti. C'était insupportable qu'un autre homme puisse la toucher. Même un membre de sa famille un jour d'enterrement. Elle est à moi. J'ai été le premier. C'était en Juin, sous un tilleul. Et je ne démêlais pas vraiment le parfum de l'arbre en fleurs de celui de sa peau. Elle gémissait doucement. Elle avait peur de salir sa robe. Elle a essayé d'enlever les taches au ruisseau. Mais sa mère a vu tout de même. Il a fallu se marier.
Et dix-huit ans ont passé, sans que je ne me lasse jamais ni du sourire, ni du parfum des beignets, ni du claquement des mules. J'ignore pourquoi Millicent veut divorcer. C'est pour lui faire plaisir que j'accepte cette idée. Je lui laisserai le bungalow. Nous avions fini de le payer ce trimestre. Je garderai la voiture, elle n'a pas son permis. Je prendrai la route, demain. Le pays est grand. Je n'ai jamais vu les Rocheuses. Ce sera l'occasion. Pour le moment, je respire encore le parfum du tilleul, en attendant l'heure du rendez-vous chez l'avocat. Je me suis installé face à l'arrêt du bus, de façon à voir Millicent arriver. Je reconnaîtrai son escarpin sur le marchepied, quand elle descendra
J'avais écrit cette nouvelle pour un concours régional dont l'intitulé était cette chanson célèbre : Quelque chose en nous de Tennessee. Je choisis de faire plus référence à l'univers de Tennessee Williams qu'à la chanson, et (pour cette raison ?), je gagnais ce concours, mon texte publié dans un journal local.

Après l'amour d'un mari abandonné, celui d'un jeune enfant :
L'ordre*
L' ordre avait été donné, péremptoire : va jouer dans le jardin. L'ordre incroyable, en contradiction complète avec tous les précédents : ne sors pas, reste ici, habille-toi, lave-toi les dents, viens saluer Granie, regarde tes albums, aide Mélanie à écosser les pois. En contradiction également avec l'inquiétude habituelle : il y a du vent, ferme ton col, mets ton foulard, n'ôte pas ta capuche, remonte tes chaussettes, tu n'avais donc pas de parapluie ? Cet enfant est trempé, il va attraper la mort, Mélanie, vite, des serviettes, du lait chaud, avec du miel, où est le thermomètre ? Qui est le médecin de garde ?
Un ordre sec, précipité, cinq petits mots, remplaçant l'ordinaire logorrhée dont sa mère espérait le protéger. Sa mère, son rempart. Ce n'était pas elle qui avait donné l'ordre. Elle était, ce matin-là, demeurée invisible. Et il régnait une grande agitation dans la vaste demeure, comme si le temps avait subi une distorsion : tous les adultes, si posés, si réfléchis, qui ne couraient jamais (au point que l'enfant les soupçonnait incapables de cet exploit), tous les adultes étaient pressés. Leurs gestes avaient montré une accélération jusqu'alors inconnue. Certains avaient claqué des portes au lieu de les refermer avec douceur sans lâcher les poignées. Le médecin lui-même, ce détestable homme en gris qui obligeait à se déshabiller et posait un stéthoscope froid sur la poitrine chaude, là où s'affolait le cœur tel une hirondelle entrée par mégarde dans une pièce close, le médecin lui-même avait pénétré dans la maison sans sonner préalablement la cloche du perron. Et l'enfant n'avait pu prononcer l'incantation magique : tire la chevillette et la bobinette cherra. Il était resté muet, figé, assis sur la troisième marche de l'escalier, sidéré de l'intrusion imprévisible. Le docteur s'était aussi arrêté net devant Camille. Ils n'avaient pas prononcé un mot, ni l'un ni l'autre, se mesurant seulement du regard. L'enfant défendait l'escalier, il était la sentinelle du royaume, le gardien de la reine ce matin invisible. L'ennemi ne passerait pas, ne sortirait pas ses armes de sa trompeuse serviette, ne ferait dénuder personne, n'inscrirait nul hiéroglyphe sur son bloc, n'obtiendrait aucun billet en échange de son départ. L'enfant, transpirant d'émotion, se sentait courageux, invincible. Son premier acte de résistance, son premier affrontement avec l'autre monde - celui des grands, aux comportements si étranges. Mélanie survint, donna l'ordre ; la citadelle tomba.
Délivré d'un rôle trop lourd pour lui, Camille se précipita sur la terrasse. La terrasse éblouissante, d'où le jardin semblait palpiter. Tant de couleurs frémissaient là, tant de formes s'y dessinaient, s'y dérobaient. Camille attendit, pour quitter la pierre blanche, chaude et stable, que son chavirement intérieur s'apaisât, que sa vue retrouvât son acuité, que le grésillement d'insectes remplaçât le battement du sang dans ses oreilles. Il descendit vers l'allée, s'imposant un rythme lent - on pouvait encore le voir, depuis les fenêtres, changer d'ordre, contredire la cuisinière, lui interdire de disparaître dans cet autre univers où l'animal, le végétal, si rassurants, remplaçaient l'inquiétante humanité. Quand il fut certain d'être hors de portée des regards, des voix, Camille se mit à courir, ne s'arrêtant que devant le très vieux cèdre, contre lequel il s'appuya, ses bras enserrant le tronc. L'écorce était rugueuse, hostile, ayant partie liée avec les habitants de la maison. Et l'écorce abritait des fourmis. Camille recula, hésitant, se souvenant que l'ordre contenait deux injonctions. Il n'avait obéi qu'à la seconde, celle du lieu, mais pas à la première, celle de l'action. Jouer, certes. Mais à quoi ? Il n'avait ni ses billes, ni ces soldats de plomb hérités du mari de Granie, ni le petit couteau volé en cuisine, pas même la ficelle du tiroir gauche. Et ce n'était pas la saison des feuilles mortes, des marrons tombés. C'était le printemps, ou l'été peut-être, cette division des années en quatre parties, encore mystérieuse pour Camille. Les adultes savaient toujours nommer, chiffrer, classifier. L'enfant soupira. Quand donc serait-il enfin grand ? Riche de mots, capable de compter, et de comprendre ces signes noirs, sous les images des albums ? Sa mère lisait souvent, des livres sans images, qui tenaient l'enfant à distance. Son père préférait les journaux. Et Mélanie elle-même, la moins savante des trois semblait-il, feuilletait parfois un gros volume à couverture bleue, tout en préparant les plats compliqués des jours de réception.
Réfléchissant à cela, dans ce désœuvrement inattendu, l'enfant sentait sa joie se ternir. Tout redevenait sombre en lui, comme à l'intérieur de la maison, comme dans le cercle d'ombre délimité par le cèdre. Il s'éloigna de l'arbre, pour s'approcher d'une plate-bande lumineuse. Un rectangle de fleurs dont le rouge était si intense qu'il semblait cligner, continuer dans l'air, envoyer des ondes, un appel aussi impératif que muet. Camille s'assit sur la pelouse, au plus près des fleurs. Ces fleurs dont il ne connaissait pas le nom. De rage devant son ignorance il lança un caillou vers le plus haut, le plus beau spécimen de cette variété. Le projectile atteignit son but. Un pétale tomba, goutte de sang vermillon sur l'herbe verte. L'enfant le ramassa, délicatement entre deux doigts, le posa sur sa paume pour l'examiner. Tout lui en parut magnifique : la forme, la texture, la couleur, le parfum. Il ferma la main, se leva, retournant vers la maison. Juste comme il y entrait, le médecin en sortait. Il sourit à Camille, lui caressa les cheveux, annonçant : tu as une jolie petite sœur. Il disparut. L'enfant monta l'escalier, dont il avait négligé la garde l'heure d'avant. Il se sentait vaguement coupable, et furieux contre la cuisinière. Elle semblait encore plus grande, plus large, sur le palier, devant la chambre de Maman. Elle mit un doigt sur la bouche, ajouta un index négatif quand il fit le geste de frapper à la porte maternelle. Elle l'entraîna au bout du couloir, dans sa chambre à lui, sur un nouvel ordre : ne les dérange pas maintenant, elles se reposent. Camille attendit un moment, pour être certain que Mélanie était de nouveau occupée à l'office. Il sortit sans bruit de la pièce où il venait d'être consigné, gagna la porte interdite, l'ouvrit sans la faire grincer, la referma de même. Il contempla sa mère endormie. Son visage était très pâle, avec des cernes bleus sous les yeux. Il écouta le souffle léger de son sommeil. Et il entendit l'autre respiration, celle venant du berceau sous le tulle. Il souleva une chaise, la porta doucement entre le lit et le berceau. Il se mit à genoux sur le velours du siège. Ayant ainsi gagné de la hauteur, il put découvrir cette nouvelle personne entrée dans la maison pendant qu'il était au jardin. Elle ne lui fit pas peur. Si petit sur l'oreiller brodé. Des cheveux si fins. Et une bouche minuscule, délicatement entrouverte. Il passa un doigt sur la joue rose. La dormeuse persista dans son sommeil. Camille se retourna vers sa mère, vraisemblablement obstinée à garder les yeux clos. Il tira de sa poche la boîte d'allumettes vide, où il avait rangé le pétale. Et il le déposa sur la belle endormie, juste à l'endroit du cœur.
Je suis souvent insomniaque. Et je décide alors d'écrire, dans le silence nocturne si propice. Mais il arrive que je n'ai pas d'idée. Alors, pour ne pas demeurer en panne, je démarre sur le réel le plus plat, le plus proche. Ce sont des départs à l'aventure, qui me ménagent autant de surprises que si j'étais la lectrice et non pas l'auteur de ces nouvelles. Quel plaisir, quel bonheur, de dérouler ces fils inconnus, qui paraissent se tisser sans moi, à partir du petit réveil bleu de mon chevet (voir la nouvelle portant ce titre dans la rubrique Repas de noces à Yport), les cris d'un bébé à l'étage en-dessous (Mots) , une plume sur le parquet, ou ce silence particulièrement ouaté d'une nuit de neige :
La Plume
Une plume sur le parquet, ça me parut étrange. Car les fenêtres étaient fermées, nul oiseau n'avait pu entrer chez moi pour l'y perdre. J'appuyais sur le bouton de l'aspirateur, pour le stopper. Et je ramassais la plume, pour la regarder, essayer d'identifier à quel oiseau elle avait pu appartenir avant d'échouer chez moi. Blanche, petite, cinq centimètres maximum. De celles que j'aurais négligées si je l'avais rencontrée sur la route, le trottoir, un chemin de forêt. Et pourtant, des plumes, j'en collectionne. Ca m'a pris dans l'enfance, comme tout le monde, avec les autres récoltes saisonnières : coquillages l'été, feuilles mortes et châtaignes en automne. Pour autant que je sache, mes amies ont arrêté d'emplir leurs tiroirs dans l'adolescence. Elles y ont remplacé ces trésors dérisoires par des journaux de leurs premières amours, des photos, des cartes postales. Après, elles ont parfois collectionné les enfants, mais pas dans les tiroirs. Moi, sans doute, j'étais inapte. Pour faire des enfants, il faut cesser d'en être une. J'ai voulu m'attarder, c'était si bon entre mes parents. A présent qu'ils sont morts, qu'il est trop tard, je ne regrette rien. Je suis libre. Libre comme un oiseau.
J'ai continué de collecter les plumes, partout où j'allais. Elles sont plantées dans mes bouquets secs, mes encriers, mes flacons, mes bois flottés. C'est un peu capharnaüm chez moi, nid à poussière. D'où mes fièvres de ménage, de temps à autre, quand je commence à éternuer. Et les prétextes pour stopper l'aspirateur car je déteste son bruit, sa violence. Il était d'ailleurs près de midi ce jour-là, l'heure d'arrêter : le facteur devait être passé. Les lettres aussi, je collectionne, depuis que je sais lire, écrire. Mais la lettre est un objet en voie de disparition, à cause du téléphone, de l'ordinateur. Et de la télévision, mon ennemie personnelle. Quand on s'abandonne quotidiennement devant le poste, on ne trouve plus le temps d'écrire, ni de lire. Parfois même on néglige de vivre.
J'avais une facture, un relevé bancaire, trois publicités. Mais c'était quelques jours avant l'arrivée de mon amoureux, et rien, alors, ne pouvait me décevoir, me troubler, m'alourdir. Les amoureux m'ont toujours moins duré que les plumes, les coquillages, les châtaignes. Ils fuyaient tous, plus ou moins rapidement. Je ne m'étais jamais habituée, mais j'avais appris à faire semblant, surface de gaieté, de rire, noir désespoir verrouillé à l'intérieur. Et puis, avec l'âge, je m'étais dit que ce serait fini, que je connaîtrai enfin cette paix misérable d'une vie sans trouble. Je ne me méfiais plus. Surtout d'un jeune homme aussi beau, fils d'une amie, qui avait failli être mon filleul. Il avait dû insister pour que je comprenne.
Nous avions vécu cinq jours merveilleux, inattendus pour moi, dans son pays d'étangs, juste à l'entrée de l'automne. A mon retour, j'en avais rédigé le récit, pour lui. J'ai oublié de dire : je suis un peu écrivain. Un peu seulement. Quatre romans parus, dont le dernier ne s'était vendu qu'à 546 exemplaires. Je connaissais déjà ce chiffre catastrophique quand mon amoureux est venu, dès novembre (il ne pouvait attendre la fin de l'année m'avait-il avoué), mais je m'en moquais. Je me moquais de tout ce qui n'était pas cet amour-ci. Le dernier de ma vie, je me répétais, en courant dans les escaliers, en dansant seule chez moi, en chantant faux des couplets que j'inventais et qui me tiraient des rires. Et quand je me regardais dans la glace de la salle de bain - cette glace immense que j'avais détestée à mon emménagement, la voilant au maximum - je riais encore, en m'apostrophant : regarde-toi bien, c'est ce corps-là, aux cheveux blancs, aux seins flétris, au pli sous le nombril, c'est ce corps-là qu'il a désiré, qu'il aime, n'est-ce pas incroyable, miraculeux ? Et je me répondais oui, je m'applaudissais, je remerciais Dieu. Parce que, forcément, ce beau jeune homme était un cadeau divin, le signe du Ciel dont je désespérais depuis longtemps... J'ai oublié de préciser que j'avais eu, aussi, des collections mentales, dans mon enfance : le Père-Noël, les fées, le P'tit Jésus et sa vie de famille plus compliquée que la mienne. Ce fut très douloureux de me séparer de ces collections-là. J'en gardais de terribles bouderies chaque 25 décembre, incompréhensibles à mes amis ; j'avais déposé ma dernière baguette magique dans le cercueil de ma mère ; et je n'entrais plus dans les églises, sauf pour les visiter, en admirer l'architecture, les tableaux, négligeant ostensiblement de tremper ma main dans le bénitier, de me signer devant le tabernacle.
Le jeune homme a beaucoup aimé le manuscrit, en novembre. Avant de le lui donner, je le lui avais lu, par tranches, entre l'amour et les petits-déjeuners, l'amour et les promenades. Il faisait ce qu'on appelle un temps pourri. Un temps idéal : nous avons eu la mer pour nous seuls. A Dieppe, à Varengeville, aux Petites-Dalles, dans la valleuse d'Elletot, à Etretat. C'est sur la plage des Petites-Dalles qu'il m'a portée, dans un passage délicat où il craignait que je me fasse mal en sautant de cinquante centimètres sur les galets. Les quelques secondes où j'ai été au bout de ses bras, ne touchant plus le sol, j'ai pensé à la plume trouvée chez moi, en octobre. J'étais légère comme elle, le jeune homme ne semblait fournir aucun effort pour me soulever. Mais où l'avais-je rangée, cette plume, après avoir lu mon courrier, rentré l'aspirateur dans la grotte noire du placard où j'aime tant l'oublier ? Je ne savais plus. C'était sans importance, ce matin de tempête où nous avons pris des photos, pour nous souvenir, comme si nous étions des personnes ordinaires et que nos mémoires aient eu besoin de ces béquilles d'images. Le jeune homme avait tenu à poser sur une seule jambe, les bras écartés, comme un oiseau prêt à l'envol. Un oiseau jaune, entre une falaise blanche et rouille, une mer verte, grise, écumeuse, roulant ses galets avec fracas. Nous n'avons trouvé aucun coquillage, pas un seul bois flotté, et nous sommes vite remontés dans ma voiture car nous avions froid. Mais j'ai fait agrandir la photo. Ce n'était pourtant pas la meilleure. A peine si on distinguait l'oiseau en ciré.
Après la solitude amoureuse des plages, et les fêtes chez les amis, j'ai remis l'oiseau dans le train, en direction de ses étangs. Nous n'avons pas plus pleuré qu'en septembre : dans quelques semaines nous serions de nouveau ensemble. Juste le temps pour moi de terminer mon costume mille et une nuits. Celui que je porterai à la saint Sylvestre, chez une amie où nous ferions encore la femme autour du jeune homme déguisé en Touareg. L'amie acheta alors un nouveau tapis, pour dîner comme au désert, dans les pays de rêves, de contes, assis en tailleur. Et je riais de cette idée :le bel homme bleu, et la petite danseuse du ventre, tout orange, tout pailletée, en lévitation sur un tapis volant, dans le ciel de Boos. Les chiennes de l'amie aboieraient en nous voyant passer au-dessus de leur chenil, et les radars de l'aéroport s'affoleraient.
Mon rire a failli être cassé net, à tout jamais, le 2 décembre. Je conduisais moins bien ma voiture que le tapis volant. Je l'ai fracassée juste avant la côte bucolique qui mène chez moi. Fracassée contre une autre. Nous aurions pu être trois à mourir ce jour-là, à l'heure du déjeuner . J'ai eu très peur à passer si vite du rêve au cauchemar. Quand je suis sortie de mon véhicule écrasé, fumant, je tremblais, je pleurais. La dame que j'avais failli tuer m'a prise dans ses bras. L'amie qui aime les tapis m'a hébergée une semaine. D'autres, encore, m'ont été secourables. Je collectionne également les amis. C'est même, de toujours, ma collection la plus réussie.
Et puis, un après-midi, je ne sais plus lequel dans ces semaines troublées, j'ai dû me rendre au cimetière. Pas celui où se sont dissous mes parents dans mon village natal : celui où ma voiture avait été emportée, entre beaucoup d'autres. Je voulais reprendre divers objets, laissés à l'intérieur le jour de l'accident. J'ai ouvert la seule portière qui fonctionnait encore, et le coffre. J'ai tout chargé dans une autre voiture. Et j'ai dit un adieu muet à celle qui m'avait si bien promenée pendant sept ans. J'ai eu le geste furtif d'un baiser, ma main sur mes lèvres. Et c'est alors que j'ai vu la petite plume blanche. La petite plume qui n'a jamais appartenu à aucun des oiseaux répertoriés dans mon dictionnaire - encore une de mes collections, les dictionnaires - la petite plume blanche qui s'était pourtant détachée d'une aile, une très grande aile : celle de mon ange gardien.
La petite plume sur le parquet a bien existé (me détournant probablement d'un ménage en cours !) ainsi que le jeune homme amoureux, et la voiture accidentée. Quant à mon ange gardien, la question de son existence demeure posée...
Sept poissons*
A la qualité du silence, nous avons deviné qu'il était trop tard. Plus personne n'était vivant dans le village. Ils avaient tué les hommes, les femmes, les enfants. Mais aussi les vaches, les chiens, les chats. Ils avaient même criblé les arbres, ce qui nous permit de répondre à une des questions de notre mission : ils disposaient bien d'un armement considérable puisqu'ils n'hésitaient pas à gaspiller leurs munitions. Leur passage était récent car les cadavres ne puaient pas encore. Ils avaient été abattus au hasard, sans être préalablement regroupés, et on pouvait quasiment lire l'histoire de chaque exécution. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ces habitants de Pompéi, surpris par le volcan, et que des moulages en plâtre, constitués autour de leurs squelettes par un archéologue inventif nous montraient tels qu'ils avaient été saisis par la mort. Ici, c'était pareil : famille tuée dans la cave où elle avait cru trouver refuge, femme protégeant vainement une jeune fille de son corps, fuyards cueillis aux limites du village, chien abattu au bout de sa chaîne. Nous les avons tous regardés. Nous sommes entrés dans chaque maison ; et aussi dans la mairie, l'église, le cimetière, les champs. Il y en avait partout. Nous n'avons pas prononcé une seule parole. Je faisais ce métier depuis une dizaine d'années, mais jamais je n'avais été confrontée à un tel massacre. L'incursion avait été rapide, car nous ne constatâmes ni viols ni pillages. Si ce n'était la présence des cadavres et les impacts de balles, les maisons racontaient ces histoires simples, ces bonheurs tranquilles des soirs d'été. Comme à Pompéi encore, le couvert était mis, la volaille avait continué à cuire dans le four, quelques dés ou osselets attestaient que des jeux venaient d'être interrompus.
Dans la dernière maison, nous vîmes l'unique objet brisé : un aquarium. Les poissons gisaient sur le sol. Les morts les plus infimes, les plus dérisoires. Ce furent pourtant ces petites taches rouges dans leurs flaques d'un parquet blond qui me firent craquer. Je me mis à pleurer nerveusement. Des années d'entraînement, de maîtrise soudain balayées. Logiquement, Ralf aurait dû me gifler, comme nous avait appris l'instructeur : couper court à toute émotion, incompatible avec notre singulier métier. Il me prit dans ses bras. Je pleurais jusqu'à hoqueter de douleur, étouffer de sanglots, être au bord de la syncope. Ralf me souleva, me porta jusqu'à un lit de l'étage, m'y déposa avec la plus extrême douceur, et me dit : « Si tu veux, je te fais l'amour. Il n'y a que ça de possible contre ce carnage. » Les pleurs me suffoquaient tant que je ne sus répondre, mais je tendis ma main vers lui, qui s'était sagement assis au bord du matelas, sans plus me toucher. Il commença par boire mes larmes et déboutonner lentement ma robe. Il embrassa mes seins, mon sexe, fut très doux, très lent, attentif à m'apaiser avant de me donner du plaisir. Un plaisir infini, qui nous tira de longs cris. Puis le silence du village vint nous reprendre. Nous étions arrivés trop tard et, cruellement, cela nous permettait un répit, un repos. Nous pouvions dormir là, dans un vrai lit, et pour une nuit entière, ce qui n'était jamais le cas lors de nos missions. Je tombais dans le sommeil encore accrochée au corps de Ralf.
Je fus réveillée juste avant l'aube, par le chant des merles. Et je compris que c'était ça, la nature du silence, la veille : l'absence des oiseaux. Ils avaient disparu. Le crépuscule n'avait pas été strié d'hirondelles. Aucun rapace n'avait tranché la nuit. Mais, dans ce jour nouveau, ils revenaient. Ils savaient l'ennemi parti. Ou peut-être - mais j'essayais de chasser cette supposition romantique - ils savaient la vie revenue, par deux corps un moment mêlés contre l'indicible. J'écoutais mieux. Et je crus entendre un autre bruit, à l'intérieur de la maison. Comme un sanglot étouffé. Ralf dut entendre également car il s'éveilla. Il se leva, prit son arme et descendit au rez-de-chaussée. Je le suivis, sans plus me vêtir que lui. Le bruit provenait du placard sous l'évier. Ralf baissa son arme et me chuchota : « Parle-lui. Rassure-le avant d'ouvrir. » Je dis, de cette voix douce que j'avais eue autrefois, que je croyais disparue : « Ne pleure pas. Ils sont partis. Nous sommes arrivés trop tard, mais nous allons t'emmener, très loin. Je m'appelle Noémie. » Spontanément j'avais donné mon vrai prénom, celui que ne connaissait pas Ralf, car nous avions l'un et l'autre des identités d'emprunt. Le silence se fit absolu à l'intérieur du placard, marquant une hésitation, puis la porte s'ouvrit et un petit garçon apparut. Il ne sembla pas remarquer nos nudités, ses yeux immédiatement rivés sur les poissons morts. Il dit : « Je les ai entendus casser l'aquarium. » Et il ajouta : « C'était le cadeau de mon anniversaire. » Je lui demandais son âge, puis lui posais une multitude de questions, toutes plus insignifiantes les unes que les autres, n'ayant que le souci de faire barrage à ses propres interrogations car je craignais de ne pouvoir répondre à la plus terrible, qui viendrait fatalement : « Où sont mes parents ? » il m'interrompit un moment, pour remarquer : « Je t'ai entendue pleurer devant mes poissons, hier soir. » Et il ajouta : « J'ai un peu faim. » Pendant notre conversation Ralf était remonté dans la chambre, s'était habillé. Quand il reparut, il me tendit mes sous-vêtements, ma robe. Il prépara du café. Le petit garçon ouvrit un buffet, pour en tirer une boîte métallique, des pots de confiture, du cacao en poudre. Nous nous assîmes autour de la table, de manière à ce que l'enfant tournât le dos à l'aquarium brisé, aux poissons morts. Alors qu'il mettait trois sucres dans son bol, il demanda à Ralf : « Et toi, comment tu t'appelles ? » Ralf répondit « Emmanuel ». Nous déjeunâmes en silence. Celui qui n'était plus Ralf devait réfléchir comme moi au moyen d'emmener l'orphelin jusqu'à notre voiture sans qu'il pût voir les cadavres de la rue. C'est l'enfant qui, involontairement, trouva la solution en exigeant d'enterrer ses poissons dans le jardin, derrière la maison. Le jardin que nous avions inspecté la veille, où nous savions qu'il n'y avait aucun mort. Emmanuel consentit à la cérémonie macabre, ajoutant : « J'irai vous attendre dans la ruelle au fond du jardin. » Il conclut pour moi : « Prenez votre temps. » Je compris qu'il parlait du temps nécessaire à son inspection de cette ruelle, car nous étions incapables de nous remémorer tous les lieux où étaient dispersés les cadavres. Thomas prit une boîte à chaussures, y déposa les sept poissons, et nous sortîmes tous les deux creuser un trou près de la glycine. L'enfant avait choisi l'endroit en précisant : « Ils seront à l'ombre. » Il accomplit tous les gestes nécessaires sans verser une larme, sans prononcer une parole. Quand ce fut terminé, il me demanda : « Je suis un grand garçon maintenant, n'est-ce pas ? » J'acquiesçais que sept ans était effectivement l'âge de raison. Il enchaîna : « Zoé est encore petite, elle n'a que six ans. » Je n'osais me faire préciser qui était Zoé, mais l'enfant poursuivit : « Quand ils ont cassé l'aquarium, elle était dans le jardin de la voisine, pour donner l'herbe aux lapins. » Il parut réfléchir à voix haute : « Elle y est peut-être encore ? Tu ne veux pas aller voir ? Il faut passer sous ce trou de la haie, là-bas. » Je consentis, rassurée qu'il ne voulût pas me suivre, et j'essayais de me souvenir si j'avais remarqué un cadavre de petite fille près de la femme tombée contre son puits. Je passais difficilement la haie, car le trou dans le feuillage n'était pas à la taille d'une personne adulte, mais, griffée aux bras, aux jambes, ma robe déchirée, je parvins tout de même de l'autre côté. J'allais vers les clapiers, et, me penchant à leurs grillages, je découvris que les lapins avaient été épargnés du grand massacre. Et je découvris, surtout, que Zoé était blottie contre eux, absolument coite, ses grands yeux terrifiés. Avant de la sortir de sa cachette, j'appelais son frère, afin qu'elle fût rassurée. Ce fut au moment où il la délivra que j'entendis l'avertisseur de notre voiture, signal convenu pour m'apprendre que la ruelle était dégagée, que nous pouvions rejoindre Emmanuel. Je pris la fillette dans mes bras car son corps était trop douloureux de son long enfermement dans un espace trop étroit pour qu'elle pût marcher immédiatement. Je me dirigeais vers le fond du jardin, quand elle parut retrouver l'usage de la parole : « Il ne faut pas abandonner les lapins. » Je n'eus pas le temps d'une hésitation que Thomas courait vers un bâtiment proche, en revenait avec un panier d'osier, à rabats, où il déposa les trois bêtes avec tendresse.
Nous sommes partis ensemble, l'homme et la femme ayant retrouvé leurs identités, les deux enfants, et les trois lapins rescapés. Thomas compta, avant de s'endormir contre sa sœur : « Nous sommes sept, comme mes poissons. » Emmanuel promit : « Et nous irons dans un pays où personne ne brisera notre aquarium. » Derrière nous, les pies et les corbeaux avaient succédé aux merles, et commençaient à attaquer les cadavres, par les yeux. Je n'osai poser ma terrible question : ce pays existe-t-il ?
Quel plaisir c'était, aussi, d'écrire au creux de mon lit, sur de vieux cahiers, armée d'un crayon et d'une gomme, ou de mon stylo empli d'encre Bleu des mers du sud. Mais le matin finissait par arriver, où je devais me lever pour me rendre à mon travail. C'était toujours un arrachement douloureux, une impression de me faire voler ma vraie vie : celle consacrée à l'écriture.
Ce matin-là
Je l'ai fait ! Je suis délivrée. Dieu est grand. Si seulement Il existait...
Je l'ai fait, ainsi que je l'avais vingt fois prédit. Personne ne m'avait crue. Comme dans la fable du berger criant au loup. Je dis tant de choses dépassant leur entendement. Et qui se réfère encore à La fontaine ou Esope, Charles Perrault, les belles conteuses et même Alphonse Daudet ? La chèvre blanche se battant contre le loup jusqu'au matin, ç'aurait pu être moi. Sacha fut un jour capable de nous réciter l'histoire qui me fit tant pleurer, enfant. Je me souviens. Je me souviens de tout, hélas. On me l'a assez reproché : vues vos capacités...
Laissez-moi vous raconter. J'ai tout le temps, à présent. C'était chez Musa, la belle Russe blanche. Blanche, blonde, grande, riche : tout ce que je ne serais jamais. J'étais à sa table, dans son vaste appartement clair dont les fenêtres ouvraient sur les jardins du Luxembourg. Son mari était là aussi, c'était lui qui détenait l'argent pour produire le film de Sacha. Le film qui serait tiré de mon premier roman, la chose semblait assez incroyable, et se construisait pourtant là, à ce déjeuner où figuraient également un directeur de la Gaumont, l'épouse de mon éditeur, Charles, Lévan. J'écoutais distraitement la conversation, qui avait pris un tour financier, ou technique peut-être. J'essayais de mettre de la distance, de me retirer de l'action, pour mieux mémoriser le moment, m'en souvenir à jamais : les images, les parfums, la musique des voix, la rumeur du jardin ; le petit œuf de Fabergé et l'icône dans la vitrine, l'insecte pris dans le rideau, un robinet qui fuyait dans la cuisine ; et Sacha récitant soudainement ce texte, appris dans sa jeunesse, au lycée français de Moscou. Moi, je n'avais connu que le lycée d'Evreux. Et encore : j'en avais été virée. Pour paresse. Fallait-il tant travailler pour devenir écrivain ? Je l'étais depuis ma huitième année, quand j'avais rédigé mon premier conte, pâle copie de ceux que je lisais, avec tous les ingrédients : princesse, marraine-fée, amours contrariées puis victorieuses. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Quelle nécessité, le nombre ? Comme si deux ne suffisaient pas au malheur des parents. Moi, j'avais beau faire, beau dire, écrire, écrire, être publiée, avoir ma photo dans le journal, ça ne consolait pas ma mère d'être mal aimée par son fils, mon grand aîné. Sacha me troubla avec sa chèvre blanche, et son regard douloureux d'alcoolique... Quinze ans ont passé. A-t-il vaincu le loup tapi au fond de la bouteille ?
J'aurais bien bu une coupe de champagne, moi, après avoir fait ce que j'ai fait, récemment. Mais je n'avais qu'une bouteille d'eau minérale sur le lieu où c'est arrivé. Je l'ai bue d'un trait. Ils ne m'ont pas interrompue. Ils n'osaient pas un geste. J'avais soif, et faim, envie de faire l'amour à nouveau. J'étais redevenue vivante. J'en riais de joie en lisant l'étiquette de la bouteille - source Roxane - et je demandais à ceux qui étaient accourus : vous souvenez-vous de l'épouse perse d'Alexandre ? Très mauvais de rire dans un pareil moment. Pourtant, dans ma vie d'avant - d'avant avant - c'était mon arme de séduction. Et j'en avais bien usé. Mon mari l'a souvent répété : je les entendais rire. Pluriel, nous étions deux : ma mère et moi. Son soixantième anniversaire sur les pentes du Vésuve, son étonnement joyeux d'être là ne cessait pas. Bientôt, j'aurai son âge. Elle ne rit plus jamais, au fond de son trou noir, par-dessus mon père, qui l'attendait depuis neuf ans - attendre est une façon de parler, car les morts ne sauraient plus rien espérer - Il ne vit pas le film de Sacha. Il mourut l'été suivant mon déjeuner chez Musa. Il n'a pas cessé de me manquer. Ma mère également. Ils viennent me visiter chaque nuit. Quel que soit le rêve, ils sont présents. Tous les trois nous nous retrouvons dans le ventre de ma maison natale. Mes chats y font également figures de divinités tutélaires. Et les hommes, les femmes de ma vie actuelle, que mes parents n'ont pas nécessairement connus, défilent dans mon sommeil. Les rêves se moquent de la chronologie. Mon frère paraît aussi, quelquefois. C'est alors que je me réveille. La douleur est trop vive, sans doute. On ne fait jamais le deuil des vivants.
Sera-t-il informé ? Demandera-t-on son témoignage ? Ridicule. M'a-t-il jamais connue ? Qui, d'ailleurs, connaît qui ? Les philosophes grecs ont dû débattre de la question. Il faudra que je les relise. J'aurai tout le temps. Quel bonheur : le reste de ma vie à lire. J'espère que le lit sera confortable. C'est toujours entre mes draps que j'ai lu, écrit. Je n'ai jamais osé l'avouer aux journalistes qui voulaient me photographier ine inspiration, derrière mon bureau, si beau trompe-l'œil entre la jungle de mes plantes vertes et l'armoire de mariage d'Esther, mon aïeule maternelle. J'avais déniché ce bureau en compagnie de ma mère, chez un brocanteur, exactement semblable à celui servant de décor à Gianni Esposito, dans le rôle de Maximilien de Habsbourg, fusillé au Mexique .
Qui se souvient de Gianni Esposito, chantant la mort du clown et le rossignol Ming ? Un rossignol est venu un temps, sous la fenêtre de ma chambre, la saison dernière, et son chant me réveillait la nuit, bien trop tôt pour écrire ou lire. Il était nécessaire que je dorme, pour être capable, quand il ferait jour, d'assurer tous les automatismes qu'on attendait de moi. Les insomnies sont néfastes pour la mémoire, la santé, l'équilibre mental, tout ce qui assure la cohésion sociale. Seule la mémoire m'importe. La mémoire affective. Pour les automatismes, voir une autre pièce, dans cette construction bizarre qu'est notre cerveau. Une pièce pauvrement meublée sous mon crâne, comme les fausses chambres funéraires des pharaons, destinées à égarer les pilleurs de tombes. J'ai revendiqué ce vide, cette différence. Mais on ne m'a pas crue. On ne me croit jamais, j'ai déjà dit. Un écrivain, ça exagère toujours. Pourtant, je me suis beaucoup documentée sur le cerveau, quand ma mère a été atteinte de la maladie d'Alzheimer. Je voulais savoir, comprendre, tenter de la maintenir vivante. Elle mourut par étapes, l'esprit d'abord, le corps ensuite. Mon père nous avait quittées encore assemblé, d'une crise cardiaque.
Je ne lis plus que des romans. J'espère que la bibliothèque sera bien fournie, là-bas. Concernant la pièce vide de mon cerveau, je suis persuadée de n'être pas unique. Mais il n'y a pas encore eu d'études, de statistiques, de thèse universitaire : les causes du handicap sont trop récentes. Alzheimer découvrit la dégénérescence qui porte son nom dès 1907 : six ans avant la naissance de ma mère. Maximilien était mort depuis quarante ans, debout contre le mur de Quérétaro. Sa veuve lui survécut soixante ans, rentrée en Europe mais ayant laissé sa raison contre ce mur. J'ai toujours aimé l'Histoire, cette mémoire collective.
Personne ne sembla se souvenir de Roxane ni d'Alexandre, quand je reposais ma bouteille vide, ce matin-là. Ils étaient tous concentrés sur le moment présent. Mais attentifs à ne pas me contrarier cependant. Ils semblaient attendre quelque chose, ou quelqu'un. Peut-être la suite du spectacle, qui rompait si brutalement la monotonie des jours gris. Alors j'ai continué, trop heureuse de les voir m'écouter, leur avouant mes regrets de n'être pas allée à Pella, si proche de Thessalonique. Pella, vous savez bien : où on a retrouvé la tombe de Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre ? Ils ne savaient pas, ou ne voulaient pas entrer dans mon jeu, comme ces spectateurs maussades d'être pris à partie dans les cabarets-théâtre. Ils m'ont agacée, par leur silence, leur immobilité. J'ai aboyé : à quoi donc vous ont servi toutes ces années entre ces murs si vous n'y avez pas ouvert les livres ? Quelqu'un a prié : calmez-vous. Le rire m'a reprit : c'est vous qui devriez vous apaiser, voyez comme vos mains tremblent. Les autres ont regardé les mains de la femme effrayée. Je jubilais de jeter l'opprobre sur elle, qui avait si bien ignoré mes difficultés. Il y eut quelques secondes de silence, brutalement déchiré par la sirène d'un véhicule. Le directeur à commenté : les voilà. J'ai vu un très joli pompier s'encadrer dans la porte. Il m'a demandé de poser le marteau. Le marteau avec lequel, enfin, ce matin-là, j'avais détruit l'ordinateur.

